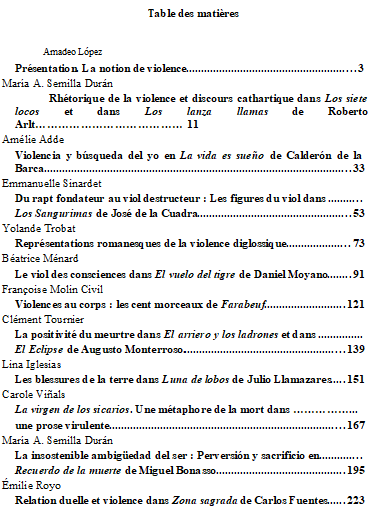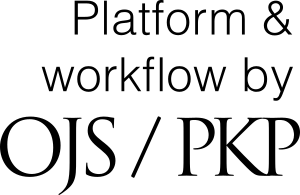No 3 (2002): Cahiers du GRELPP - Figures de la violence dans la littérature de langue espagnole (1)

Voici le troisième tome des Travaux et Recherches du GRELPP (Groupe de Recherches en Littérature, Philosophie et Psychanalyse). Il rassemble onze des communications faites et discutées, lors des séminaires du GRELPP des années 2000 à 2002, sur le thème “Figures de la violence dans la littérature de langue espagnole”. Comme dans les deux tomes précédents – consacrés à “L’image parentale dans la littérature de langue espagnole” –, les travaux ici publiés proposent une lecture des œuvres littéraires suivant une grille principalement psychanalytique et/ou philosophique.
Comme on pourra le constater à la lecture de ces textes, le thème de la violence ouvre à la critique littéraire des voies multiples. En même temps, il interroge sur la nature même de la violence, sur le processus de sa mise en scène littéraire, ainsi que sur les rapports de la fiction avec la réalité socio-historique et existentielle de référence.
Cette interrogation est sous-jacente dans les textes publiés, comme elle l’a été dans les débats lors de ces communications et dans ceux du cycle consacré à “L’image parentale”. Rien d’étonnant, car la notion de violence n’est pas aisée à cerner.
Le titre “figures de la violence” – au pluriel – porte la marque de la diversité des voies que les travaux du GRELPP tentent d’explorer, diversité dont le sommaire laisse entrevoir quelques-uns des principaux axes. Ce titre s’autorise, certes, de la spécificité interdisciplinaire du groupe. Mais il s’autorise également, et surtout, de la polysémie du terme “violence”, reflet des multiples visages que prend, dans les sociétés et chez l’individu, la réalité de l’objet que ce terme désigne.
Étymologiquement, “violence” vient du latin violentia, qui signifie “abus de la force”. La notion “d’abus” renvoie à celle d’un acte volontaire. Cependant, si les dictionnaires indiquent généralement le sens étymologique de “violence”, le rang qu’occupe, dans l’ordre des acceptions, la source volontaire de la force varie selon les dictionnaires. Ainsi, Le Petit Larousse ne fait apparaître la notion d’abus de la force qu’en 4e position – “Faire violence à : contraindre quelqu’un par la force”. Par contre, Le Petit Robert met l’accent, dans les deux premières acceptions – il en comporte quatre –, sur la notion d’abus de la force :
1. Agir sur quelqu’un ou le faire agir contre sa volonté, en employant la force ou l’intimidation. 2. Acte par lequel s’exerce cette force. 3. Disposition naturelle à l’expression brutale des sentiments ; cette expression. 4. Force brutale (d’une chose, d’un phénomène).
On remarquera que l’acception 4 du Petit Robert – qui correspond à la 1re du Petit Larousse – indique que la source de la “force brutale” peut ne pas être une volonté, ni un désir de jouissance en nuisant à autrui, mais “la démesure des phénomènes naturels, l’excès de certaines forces destructrices qui outrepassent l’ordre et la mesure habituelles”1, comme le souligne Hélène Frappat. Cette idée mérite d’être retenue, car on la rencontre en philosophie, déjà chez les Présocratiques2, et en psychanalyse. Les exemples du Petit Robert concernant “l’ordre psychologique”3 s’inscrivent dans le sens étymologique du mot “passion”, qui veut dire “pâtir”. Dans la passion, le sujet n’agit pas, il “est agi”.
C’est ainsi que l’on pourrait sans doute entendre la notion de “violence fondamentale” dont parle Jean Bergeret4, violence comme instinct de survie et d’autoconservation, sans intention de nuire. Cet instinct peut être rapproché du conatus (effort) dont parle Spinoza5.
Dans ce sens, la violence a une connotation positive, puisqu’elle est au service de la vie. C’est ce qui amène Claude Balier à parler “d’étrange paradoxe” de la violence, car elle est à la fois “nécessaire pour être et pour créer”6 et meurtrière sous de multiples formes extrêmes. L’article de Claude Balier, dont je viens de donner les références en note, ouvre des voies nouvelles et intéressantes à la réflexion sur l’ambivalence de la violence. L’auteur situe d’ailleurs explicitement sa démarche dans cette perspective :
[En explorant cet “étrange paradoxe”] nous nous inscrirons dans une nouvelle page de l’histoire de la psychanalyse, en abordant des thèmes jusque là peu étudiés dans leur concrétude et en accompagnant un certain “décentrement” qui va du princeps de la pulsion à l’importance attribuée au rôle de l’objet externe.1
L’article de Claude Balier aborde la violence à partir d’une étude métapsychologique du viol. L’auteur admet que ce choix puisse étonner. Il le justifie en soulignant que “viol” et “violence” ont la même racine.
Cet article introduit une lisibilité, parfois surprenante mais suggestive, de l’ambivalence de la violence. J’en soulignerai seulement deux points. Le premier concerne la priorité accordée à l’objet par rapport aux pulsions. C’est à partir de l’objet, tel qu’il se manifeste dans l’analyse clinique, que l’auteur identifie la raison du viol :
L’analyse du discours de nombreux sujets ayant commis un viol, de leurs cauchemars, de leurs angoisses, de leurs phobies intenses, m’ont convaincu que l’acte avait été déterminé par une peur panique d’intrusion dans le monde interne, réveillée par les traces d’un objet primaire pénétrant. Un clivage solide isole une zone fragile du reste de la personnalité qui se déploie selon des critères ordinaires, névrotiques ou pseudo-névrotiques, et donne l’apparence de la banalité.1
Cette approche du viol vise à faire disparaître la confusion entre pulsion sexuelle et pulsion violente. La raison de cette confusion tient au fait que l’on analyse le viol en termes essentiellement d’outrance pulsionnelle, au lieu de l’analyser à partir de l’objet.
Le deuxième point de l’article que je voudrais souligner, c’est le rôle positif que peut jouer la violence dans la structuration identitaire du sujet, à condition qu’il y ait une instance maternelle inébranlable face aux “assauts violents de l’enfant”. Si cela est, le rôle structurant de la violence peut se manifester. En voici les contours :
[La] valeur constructive de la violence consiste à détruire l’objet-chose afin que naisse la représentation, en retrouvant cependant l’objet externe intact, ce qui permet au mouvement agressif d’être perçu comme un fantasme. Ainsi naît l’objet psychique, et la solidité de l’identité.2
Dans sa forme négative, par contre, la violence est déstructurante et meurtrière :
La violence ne naît pas d’une réalité contraignante, ce serait alors de l’agressivité, elle effectue un travail de déshumanisation, par le meurtre effectif de l’objet psychique.3
On voit le parti que l’on peut tirer de cette approche pour une analyse de plusieurs figures de la violence. Le meurtre de l’objet psychique est l’un des points qu’il convient, sans doute, de prendre en considération. Comme il convient de prendre en considération le rôle que joue la carence des objets externes – notamment des instances paternelle et maternelle – dans “l’abolition des limites dedans-dehors”4 chez l’enfant et, conséquemment, les manifestations destructrices de la violence.
Ce qui précède indique que les figures de la violence sont multiples et qu’il n’est pas aisé de trouver des critères à la fois suffisamment concis et suffisamment amples pour subsumer sous le terme “violence” des manifestations brutales de la force, comme l’indique son étymologie, dans des champs très différents, comme l’histoire des sociétés, la vie sociale, la vie familiale ou l’individu lui-même, dont l’expression “se faire violence” annonce déjà la lutte qui s’y noue.
Du point de vue de sa définition, la violence se présente donc comme objet protéiforme, toujours fuyant par sa proximité avec d’autres concepts, dont les contours sont en osmose avec ceux de la violence, comme force, pouvoir, autorité, contrainte, oppression, transgression, instincts, agressivité, conflits, etc.
Ce caractère protéiforme se nourrit sans doute de cette “part de nuit”1 en l’homme et autour de l’homme dont parle Michel Foucault. Nuit des origines des peuples et des individus qui pourrait expliquer la présence de la violence dans les “mythes fondateurs” de tous les peuples et son caractère “indicible”, comme dit Hélène Frappat :
La violence relève de l’histoire des peuples : c’est un instrument qui, comme tel, est indicible, insondable ; elle fait partie de ces “choses cachées depuis l’origine et la fondation du monde”, pour reprendre l’expression de René Girard. C’est pourquoi on la retrouve parmi les mythes et les récits fondateurs, tous ces apologues dans lesquels ce moyen de l’évolution historique et de la fondation des États a droit de cité.2
Nul doute que “ces choses cachées” ne jouent un rôle important dans les manifestations de la violence au niveau individuel. La psychanalyse a sans doute beaucoup à nous apporter sur ce terrain, comme elle l’a fait sur celui de l’image parentale, thème du précédent cycle du GRELPP.
Au sens précis du terme, la violence n’est pas un concept psychanalytique classique, même si dans les écrits de Freud, notamment à partir de 1920, on la voit sourdre avec le concept des pulsions instinctives – pulsion de mort (Thanatos), de destruction et d’agressivité, antithétiquement inséparable de la pulsion de vie (Éros). Mais elle sourd voilée, tantôt comme manifestation des pulsions, tantôt comme leur ressourcement, sans que Freud ne l’ait jamais conceptualisée.
Actuellement, cependant, la notion de violence est en train d’émerger, en tant que telle, dans le champ de la psychanalyse. C’est ce que font ressortir, par exemple, les auteurs de Le mal-être (angoisse et violence), dont la
lecture me semble très éclairante. L’article cité de Claude Balier nous a permis, déjà, d’en entrevoir l’intérêt.
Réfléchissant sur la généralisation accentuée du mal-être et de la violence sous des formes diverses dans les sociétés actuelles, André Green fait cette constatation concernant la présence de la violence dans l’espace de l’analyse psychanalytique :
On ne saurait nier qu’ici encore, la violence pulsionnelle a envahi le cadre psychanalytique. Non qu’elle en fût absente dans le passé, mais elle est devenue aveuglante derrière les manifestations qui ont étendu le spectre du mal-être individuel [...] Il sourd de ce que l’on entend en analyse une violence latente qui couve à longueur de séances, risquant d’exploser à tout moment et de mettre en péril l’organisation psychique. Elle se manifeste tantôt par un passage à l’acte hors séance, tantôt par la menace d’un accident somatique imprévisible, ou par une implosion psychotisante plus ou moins irréversible.1
André Green souligne le rôle déterminant joué par les médias dans l’excitation de l’expression pulsionnelle et dans le déclenchement des “signaux d’alerte du Moi. Parfois leur défaillance met leur valeur protectrice en question”2.
S’interrogeant sur les causes des blessures du Moi, André Green en impute la responsabilité à la causalité psychique qui résulte de l’interaction de deux autres causalités, la causalité sociale et la causalité biologique :
[La causalité psychique] émerge comme une création originale spécifique, irréductible à chacune des deux autres et habitée par une violence potentielle dont le déferlement paraît ne pas pouvoir être endigué lorsqu’elle se trouve activée.3
L’auteur soutient que la violence s’enracine dans les pulsions dont il constate l’efficience, ou, comme il dit, la “dure réalité”4.
Parmi les figures de la violence où la causalité psychique, dont parle André Green, révèle sa force destructrice et les profondes blessures du Moi, le sadisme occupe une place de premier ordre. Cette figure de la violence est très présente dans la littérature de langue espagnole – comme elle l’est dans la réalité historique, politique et sociale, aussi bien dans le domaine public que privé. Je n’insisterai pas ici sur l’importance que cette notion a dans la pensée de Freud. Je voudrais plutôt reprendre, succinctement, quelques réflexions que j’ai développées plus longuement ailleurs5 pour les verser au
débat, réflexions qui s’inscrivent, me semble-t-il, dans la logique de l’instinct de mort.
Dans le sadisme, dit Gilles Deleuze, le Surmoi introduit une dynamique de destruction sans cesse reprise et à reprendre, parce que l’instance du Surmoi ne peut tolérer de voir son interdit enfreint1. Dynamique de destruction que Georges Bataille met magistralement en évidence en analysant les héros de Sade dans leur rapport à la sexualité. “La négation des partenaires [dit-il] est […] la pièce fondamentale du système”2. Et c’est bien ce mouvement qui caractérise le sadique dont la volupté devant ses victimes appartient à ce monde “de déchéance et de ruine“3 qui, selon Georges Bataille, est la vérité de l’excès érotique. C’est là une idée visible dans de nombreuses œuvres du champ littéraire sur lequel portent les travaux du GRELPP. On en trouvera la confirmation dans la lecture de certains des travaux ici présentés.
La jouissance sadique se nourrit de son propre tourment, révélant ainsi à la conscience l’abîme qui la sépare de l’objet du désir ou, en d’autres termes, son échec indépassable. La voie de la violence sadique amène à constater, avec Georges Bataille, que “seule la voracité d’un chien féroce accomplirait la rage de celui que rien ne limiterait”4. Le sadique, porté par sa “voracité”, par le principe négateur qui l’habite, n’aura de cesse qu’il n’ait réalisé l’image de soi en tant que conscience souveraine reconnue par le regard atterré de la victime, image de soi posée comme idéal d’apathie. Or, l’apathie, dit Maurice Blanchot à propos de Sade, “est l’esprit de négation appliqué à l’homme qui choisit d’être souverain. C’est, en quelque façon, la cause ou le principe de l’énergie”5. En cela réside le paradoxe de la souveraineté de l’homme énergique au sens où l’entend Sade : “il est l’homme de toutes les passions et il est insensible”6. C’est pourquoi Maurice
Blanchot dit, avec raison, que, au centre du monde sadique, se dresse “l’exigence de la souveraineté s’affirmant par une immense négation”1.
Nous atteignons ici la cime de la négation d’autrui, qui est sans doute aussi une manifestation de la négation de soi. Manifestation délicate, tant il est vrai que, dans son principe, la négation d’autrui est d’abord essentiellement – Hegel l’a montré – affirmation de soi. Cette négation est poussée à cette limite extrême où la conscience de la victime disparaît en tant que possibilité de tout regard positionnel. Ce qui signifie que la violence du mouvement négateur rend la conscience de la victime inapte, aussi bien à être conscience de soi, qu’à poser le bourreau dans sa transcendance.
De ce fait, le processus de violence déclenché par le bourreau lui échappe. Car la violence obéit à des lois qui se situent en dehors de l’individu. Et c’est en cela justement que la négation à l’extrême d’autrui devient négation de soi, car la conscience sadique y découvre son impuissance à se maintenir comme essentialité. La furie destructrice de la conscience sadique se retourne alors contre soi, creusant ainsi encore davantage son manque-à-être. La loi de la jouissance sadique, prenant l’apathie pour axe, comporte en soi la dissimulation et la perte de l’objet fondamental du désir, autrement dit, la reconnaissance de l’autre. C’est ce qui fait dire à Sartre que le sadisme porte en soi sa propre contradiction. Le chapitre III de la troisième partie de L’être et le néant – dont le titre est “Les relations concrètes avec autrui” – est, sur ce point, particulièrement éclairant. Sartre y fait apparaître que la violence sadique – comme la violence masochiste qui n’est qu’une violence sadique inversée – révèle un vertige de la conscience en face de son manque d’être, vertige qui l’amène à des conduites répétitives, ce en quoi elle creuse davantage son manque-à-être, son malheur.
En guise de conclusion provisoire sur la notion de violence, il me semble important de souligner deux points. D’abord, la grande profusion des figures que peut prendre la violence – profusion qui tient à son caractère intrinsèquement protéiforme – constitue une réelle difficulté pour en saisir les contours de manière univoque. Ensuite, le champ vaste et complexe dans lequel se meut la violence – dans la littérature, comme dans la réalité socio-historique et dans la structure psychique de l’être humain – ouvre à la recherche des voies inédites et fécondes. Certaines de ces voies sont amorcées dans les travaux ici rassemblés, travaux qui, à bien des égards, prolongent ceux du cycle précédent sur l’image parentale, tout en y introduisant une nouvelle lisibilité. Beaucoup d’autres restent à explorer. Si le lecteur repère dans ces textes des raisons de poursuivre la quête, cet ouvrage aura apporté sa contribution à la recherche.
Amadeo López