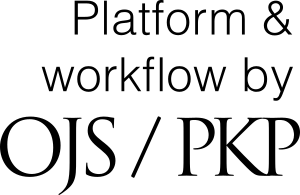No 5 (2006): Cahiers du GRELPP - Figures de la mort dans la littérature de langue espagnole (1)
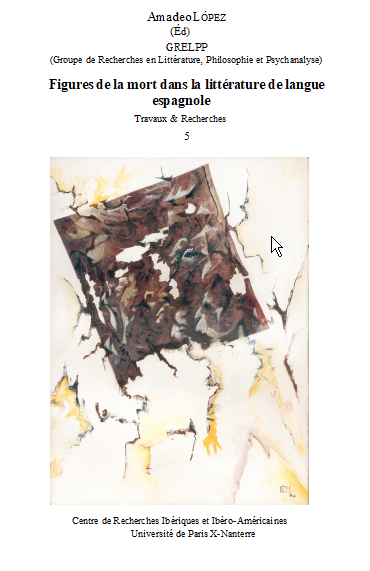
Ce 5e tome des Travaux et Recherches du GRELPP – Groupe de Recherches en Littérature, Philosophie et Psychanalyse – rassemble treize des communications présentées et discutées lors des séminaires du troisième cycle – 2003-2005 –, dont le thème a été « Figures de la mort dans la littérature de langue espagnole ». Ces travaux, comme ceux des cycles précédents1, constituent une approche des œuvres littéraires à la lumière de la psychanalyse et/ou de la philosophie.
Les figures de la mort sont multiples, comme sont multiples les attitudes des civilisations et des individus à son égard. Mais toutes indiquent que l’image de la mort s’emplit de celle de la vie qui fuit. Non pas que la mort soit contenue dans la vie, comme un corps dans un autre corps, mais parce que, comme le souligne Jankélévitch :
La vie est à la fois habillée de mort et pénétrée de mort ; enveloppée par elle d’un bout à l’autre, imbibée et imprégnée par elle. C’est donc pour une lecture superficielle et toute grammatique que l’être parle seulement de l’être et la vie seulement de la vie. La vie nous parle de la mort et en même temps elle ne parle que de cela. […] La mort est l’élément résiduel de tout problème.2
Si tout dans la vie parle de la mort, la mort en soi est insaisissable, parce que, en tant que telle, elle est impensable. On ne peut penser ni l’avant-la-mort, ni l’instant létal, ni l’après-la-mort. On ne peut qu’en constater le résultat, toujours en troisième personne – la mort de l’autre –, jamais directement en première personne. En ce sens, la mort est un problème dont l’objet s’évapore à l’instant même où l’on tente de le cerner. D’où, sans doute, cette profusion de métaphores, de périphrases, de subterfuges de langage auxquels on fait souvent appel – en philosophie, en littérature, dans les religions, dans les sciences humaines, dans les médias – pour la configurer comme objet compréhensible, réduite à un être-de-langage métastable. La mort devient alors simple éventualité extérieure. C’est le « on meurt » dont parle Heidegger. « On » n’est personne. La mort arrive à « On » et non pas à moi. Elle est banalisée, mise à distance. Banalisation et mise à distance dans lesquelles les médias jouent un rôle de premier ordre dans les sociétés modernes. Certes, lorsque la télévision montre – par exemple, suite à une catastrophe ou à une guerre – des espaces couverts de corps morts, on peut éprouver un sentiment de frayeur, voire de compassion. Mais il s’agit d’un sentiment de spectateur dans lequel l’individu ne lit pas l’inéluctabilité de sa propre mort à venir. Sentiment au demeurant éphémère, d’autant que l’accumulation et la surabondance – pratiquement
quotidiennes – de ce type d’images favorisent, chez le spectateur, la tendance à « dépouiller la mort de tout caractère de nécessité, à en faire un événement purement accidentel »1, comme dit Freud, en réfléchissant sur « notre attitude à l’égard de la mort ». La mise en scène des images accentue ainsi ce caractère d’extériorité du « on meurt » dont l’individu revêt, spontanément, la mort de l’autre :
Le fait est qu’il nous est absolument impossible de nous représenter notre propre mort, et toutes les fois que nous l’essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. C’est pourquoi l’école psychanalytique a pu déclarer qu’au fond personne ne croit à sa propre mort ou, ce qui revient au même, dans son inconscient chacun est persuadé de sa propre immortalité.2
D’après Freud, cette négation de la mort remonte à la nuit des temps. On comprend alors pourquoi la mort est déniée, néantisée magiquement. Elle devient un simple épiphénomène qui ne concerne pas l’individu en première personne. Il s’agit d’une stratégie spontanée de l’être humain pour apaiser l’angoisse de mort qui sourd en lui comme son devoir-être ultime.
La question de la mort est inséparable de celle de la temporalité. Le concept de temporalité est récent dans l’histoire de la pensée philosophique. On le doit à Husserl. Mais c’est surtout Heidegger qui en a montré l’importance pour comprendre le statut ontique et existentiel de l’homme. Ce concept signifie que l’homme existe en se temporalisant, c’est-à-dire, en se faisant temps. Si le concept de temporalité est récent, la méditation sur le temps, par contre, est ancienne. On connaît la célèbre maxime d’Héraclite : « Tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi »3. La vive conscience de la fugacité du temps qu’exprime ici Héraclite donne la mesure de la fragilité de l’être. Que le temps soit conçu de manière linéaire ou comme un éternel recommencement, il affecte l’homme, comme toute chose, par son perpétuel mouvement. Dans les doctrines de l’éternel retour – dont les fondements s’inspirent, sans doute, du cycle des saisons –, le rapport de l’homme au temps et, par conséquent, le rapport de l’homme à la mort, n’a pas ce caractère visiblement tragique qu’exprime la maxime d’Héraclite. Ce qui ne signifie pas que dans les doctrines de l’éternel retour, comme dans celles qui professent une vie au-delà de la mort, l’homme n’éprouve pas dans sa chair et sa conscience la morsure douloureuse du temps et de l’incertitude sur
l’après-la-mort. Cette question mériterait une analyse sans doute nuancée et approfondie, notamment à la lumière de la psychanalyse, ce qui, à l’évidence, dépasserait le cadre de cette présentation.
Le caractère irréversible du temps frappe du sceau de l’échec toute tentative d’avoir prise sur le passé. Spinoza a souligné combien le passé est hors de portée du repentir. Il en est de même du souvenir. Proust en fait l’amère expérience dans la quête du temps perdu. Amère expérience également – et davantage tragique – que celle du personnage du film de Max Ophüls, Le Plaisir, ce vieux qui s’obstine à retenir le temps, à revenir en arrière. Sous le masque de sa jeunesse, il s’élance dans une course effrénée pour être le premier sur la piste de bal, mais il étouffe en voltigeant sur la piste. On ne revient pas en arrière, pas plus l’homme que la nature.
L’homme existe en se temporalisant, disais-je en me référant à Heidegger. Mais la temporalisation1 comporte, dans sa structure ontique, l’être-pour-la-mort comme son pouvoir-être le plus propre, indépassable. Aussi l’homme est-il, dès sa naissance, souligne Heidegger, livré à sa mort, non pas comme « une chose-non-encore-donnée »2, mais comme une « imminence spécifique »3, et non pas extérieure, pouvant survenir quelque part dans le monde environnant. Exister, c’est être déjà « jeté » dans cette possibilité. Et le fait de ne pas en avoir une conscience claire ne change rien au fait d’être-pour-la-mort, pas plus que la question de l’existence ou de la non-existence d’une autre vie au-delà de la mort.
Cette dernière question relève de la théodicée et peut, certes, modifier l’attitude existentielle devant la mort comme révélation du non-sens ou, au contraire, comme révélation d’une survie, mais elle ne modifie en rien le statut ontologique de l’homme en tant qu’être-pour-la-mort. Karl Jaspers dit que :
Dans les situations-limites, on rencontre le néant ou bien on pressent, malgré la réalité évanescente du monde et au-dessus d’elle, ce qui est véritablement. Le désespoir lui-même, du fait qu’il peut se produire dans le monde, nous désigne ce qui se trouve au-delà.1
Il a sans doute raison, mais il reste que, même dans une perspective de foi chrétienne, la mort est à ce point le devenir de l’homme qu’il a fallu que Dieu lui-même meure pour qu’une victoire sur la mort soit possible. De ce point de vue, la religion chrétienne se présente, suivant le mot de Jean Lacroix, « comme une sorte de psychanalyse intégrale, qui veut régler la fonction temporalisante en la liant à l’éternité »1. Le négatif, l’échec qu’est la mort, est intégré dans la positivité, mais non sans avoir d’abord bu le « calice jusqu’à la lie ». Le Christ, c’est-à-dire Dieu lui-même, fait ainsi l’expérience de la déréliction en tant qu’être-pour-la-mort.
Ce Christ agonisant, esseulé, clamant sa souffrance dans la solitude radicale, ontologique, « terriblement tragique », selon le mot d’Unamuno dans L’agonie du Christianisme, témoigne de l’acuité de l’angoisse face à la mort et met en question la possibilité d’intégrer la mort dans la positivité. Autrement dit, il semble difficile d’échapper aux affres de la déréliction quand on prend conscience de l’imminence de la mort.
Heidegger montre que la déréliction de la réalité-humaine est dévoilée dans la mort sous une « clarté plus primitive et plus pénétrant »2 que dans la connaissance théorique. Il précise que l’angoisse ainsi révélée signifie, non pas une simple dépression de l’humeur de l’individu, mais, au contraire, « une situation-affective fondamentale de la réalité-humaine »3, qui consiste dans le fait d’être dans la déréliction la plus totale dans son devoir-être-pour-sa-fin. Cela explique les tentatives de l’homme pour se cacher à soi-même cette inexorabilité à travers le « on meurt » de la banalité de la vie quotidienne. C’est ce que Sartre appelle la mauvaise foi en tant que « mensonge à soi »4. On se masque à soi-même la vérité. Ce qui ne signifie pas qu’il s’agit d’une conduite réfléchie et volontaire, car, dit Sartre, « on se met de mauvaise foi comme on s’endort et on est de mauvaise foi comme on rêve »5.
Aussi, pour Sartre, « l’acte premier de mauvaise foi est pour fuir ce qu’on ne peut pas fuir, pour fuir ce qu’on est »6. Il en est de même quand on se réfugie dans le « on meurt » pour se mettre à l’abri de l’angoisse qu’implique le fait de savoir que la mort nous concerne dans la totalité de
notre être. Dans l’angoisse devant la mort, en effet, la réalité-humaine est mise en présence d’elle-même, comme livrée à sa possibilité indépassable. C’est pourquoi le « On », dit Heidegger, « prend soin de convertir cette angoisse, d’en faire une simple crainte devant un quelconque événement qui approche »1.
Mais cette tentative pour échapper à sa condition n’est pas moins révélatrice de cette condition même. En effet, la tentative de fuir son être-pour-la-mort plonge l’homme dans ce que Heidegger appelle « l’inauthentique », c’est-à-dire dans la non-vérité. Mais cet inauthentique ne confronte pas moins l’homme à chaque instant avec la réalité qu’il se voile.
De même que la mauvaise foi est sous-tendue par la bonne foi, de même la fuite devant la mort, à travers la banalité quotidienne, se manifeste comme un être-inauthentique-pour-la-mort. Car, ici encore, nous sommes en présence d’un mode d’être parmi d’autres. On n’y échappe pas. Plusieurs des travaux ici présentés en témoignent.
Ces travaux font apparaître, on en conviendra, que les stratégies du « on meurt », mises en scène, sous des figures différentes, par maints auteurs de référence, aboutissent toutes au même constat d’échec. Les efforts des personnages – souvent des auteurs – pour se voiler la réalité de leur être-pour-la-fin ne résistent pas longtemps à l’angoisse de « mort, d’annihilation » qui, rappelle Anna Potamianou, « est au noyau de l’être »2.
Cette conception de l’angoisse de mort diffère de celle qu’exprime Freud, en 1915, dans Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, conception qu’il a maintenue par la suite :
L’angoisse de la mort […] dont nous subissons l’empire plus souvent que nous ne le croyons, est quelque chose de secondaire et résulte le plus souvent du sentiment de culpabilité.3
On a beaucoup discuté, et l’on discute encore, les textes de Freud qui excluent l’idée que l’angoisse de mort se situe dans l’inconscient. Il n’est pas question ici d’entrer dans ce débat. Car, que l’angoisse de mort soit une élaboration de l’angoisse de castration, comme l’affirme Freud, ou qu’elle soit une angoisse primaire, selon l’hypothèse de Mélanie Klein, elle est toujours là, prête à jaillir :
Sourde et permanente alerte, l’angoisse de mort peut surgir chez n’importe qui, quand la connaissance affective du destin inéluctable de notre mort nous effleure, lors de l’imminence d’un danger de mort, réelle ou imaginaire, concernant nous-mêmes et nos objets signifiants.1
Dans le même sens, Françoise Ellien précise qu’il y a une prise de conscience de l’angoisse de mort « tout à fait précoce puisqu’elle questionne et taraude les enfants âgés à peine de quatre ou cinq ans »1, comme elle questionne et taraude l’homme jusqu’au dernier instant, quels que soient ses efforts pour l’occulter.
J’ai dit plus haut que la stratégie du « on meurt » vise à banaliser la mort en la considérant comme un simple problème qui ne concerne pas l’individu en première personne.
Mais lorsque le « On » prend le visage du corps-mort du proche, la mort cesse d’être problème et devient questionnement et surtout question.
Questionnement sur l’unicité du proche-mort. Son corps est là, nous l’accompagnons et l’entourons de rites, nous assistons à sa transformation, mais qu’en est-il de sa personne ? Quelle est la nature de son absence ? C’est dans ce questionnement que Freud situe l’origine de la croyance aux esprits et à la survie chez l’homme primitif :
C’est devant le cadavre de la personne aimée qu’il [le primitif] imagina les esprits et, comme il se sentait coupable d’un sentiment de satisfaction qui venait se mêler à son deuil, ces premiers esprits ne tardèrent pas à se transformer en démons méchants dont il fallait se méfier. Les changements qui suivent la mort lui suggèrent l’idée d’une décomposition de l’individu en un corps et en une (primitivement en plusieurs) âme. Le souvenir persistant du mort devint la base de la croyance à d’autres formes d’existence, lui suggéra l’idée d’une persistance de la vie après la mort apparente.2
Ainsi seraient nées, selon Freud, les doctrines de la métempsychose, la croyance en une multiplicité de vies avant la vie présente, et la foi des religions en une vie meilleure après la mort. L’ensemble de ces croyances « a pour but de dépouiller la mort de toute valeur, de lui refuser le rôle d’un facteur opposé à la vie, destructeur de la vie »3.
Question, car quelle que soit la nature et la force de ces croyances, l’absence du proche crée une béance dans notre être-au-monde qui met en péril l’ancrage référentiel inscrit dans la durée. Notre propre devenir
apparaît, nocturne, sur fond d’une absence-présente. Absence-présente, car il est difficile, au moins dans un premier temps, d’imaginer – et d’accepter – l’absence définitive de l’être cher.
L’image crue de notre finitude, réfléchie dans l’absence du proche, nous met brutalement devant cette alternative : accepter la perte de l’objet, au sens psychanalytique d’objet d’amour, ou sombrer dans la mélancolie. C’est la phase du deuil qui commence. Phase cruciale, car s’y joue la capacité de l’individu à surmonter la douleur de la perte et à restructurer son être-au-monde en y intégrant la réalité de l’absence.
Freud, dans Deuil et mélancolie, considère le deuil comme une « maladie naturelle » par laquelle passe l’endeuillé. Maladie qui met le sujet à l’épreuve singulière de la réalité, comme l’indiquent ces lignes tirées de Métapsychologie, sous forme, il est vrai, d’hypothèse :
Sur chacun des souvenirs et des situations d’attente qui montrent que la libido est rattachée à l’objet perdu, la réalité prononce son verdict : l’objet n’existe plus ; et le moi, quasiment placé devant la question de savoir s’il veut partager ce destin, se laisse décider par la somme des satisfactions narcissiques à rester en vie et à rompre sa liaison avec l’objet anéanti.1
Cette rupture suppose un processus psychique long, un travail de deuil, de nature à surmonter la douleur et à intégrer la perte dans le moi. Dans le travail de deuil normal, précise Freud, « le respect de la réalité l’emporte », mais il l’emporte au terme d’un laborieux travail, « d’une grande dépense de temps et d’énergie d’investissement, et, pendant ce temps, l’existence de l’objet perdu se poursuit psychiquement »2. Elle se poursuit et s’accomplit à travers le détachement progressif de tout souvenir et de toute représentation de l’objet disparu sur lesquels était investie la libido. C’est alors que le moi « redevient libre et sans inhibitions »3. Autrement dit, le travail de deuil accompli, libérateur, implique le maintien de l’amour pour l’objet et l’amour pour la vie.
Mais si le travail de deuil échoue, le sujet s’en va à la dérive sur les pentes de la mélancolie, dont Freud précise ainsi les contours :
La mélancolie se caractérise du point de vue psychique par une dépression profondément douloureuse, une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d’aimer, l’inhibition de toute activité et la diminution du sentiment d’estime de soi qui se manifeste en des auto-reproches et des auto-injures et va jusqu’à l’attente délirante du châtiment.1
Force est de constater que la presque disparition des rituels de deuil, dans les sociétés occidentales, ne favorise guère le travail de deuil de l’individu. Lorsque ces rituels sont pris en charge par la collectivité, l’individu peut plus facilement renoncer à l’objet et sauvegarder l’amour pour l’objet et l’amour pour la vie. C’est le cas dans les sociétés tribales. C’était le cas, naguère encore, dans nos campagnes. La codification, par le groupe, de la durée et des modalités des rituels transforme le deuil en rite de passage. Le groupe prend ainsi en charge, symboliquement, le travail de restructuration psychique individuelle, célèbre dans la solidarité la vie et joue un rôle déculpabilisant pour les proches du défunt.
L’escamotage de ces rituels, par contre, rend plus difficile le travail de deuil individuel. Si ce travail échoue, le sujet se retrouve aux prises avec la béance de l’absence et l’éventualité de sa propre chute dans l’épaisseur de la nuit, dans le néant.
***
On le voit, la question de la mort est intrinsèquement liée à celle de la temporalité. Si ce dernier concept est récent, son contenu renvoie à la méditation de l’homme sur ses rapports au temps, méditation ancienne, dont témoignent aussi bien les conceptions linéaires du temps que celles de l’éternel recommencement. Le temps coule, ou plutôt, c’est nous qui coulons, faute d’un point stable où nous agripper. Le passé absorbe l’avenir et l’avenir est l’estuaire de l’homme qui ouvre sur l’opacité de la fin. C’est du sentiment – ou de la prise de conscience – que la mort est notre propre avenir, en tant qu’être-pour-la-mort, que surgit l’angoisse. Angoisse qu’aucune stratégie pour dénier la mort ne parvient à occulter longtemps. On pourra en avoir confirmation en lisant le présent ouvrage. Plusieurs des travaux ici publiés ont, en effet, pour toile de fond, explicite ou implicite, la problématique de l’être-pour-la-mort. Écrire et/ou décrire la mort constitue, pour un certain nombre des auteurs analysés, au-delà de la création littéraire, un questionnement angoissé sur l’être-pour-la-fin de l’auteur lui-même. L’angoisse de mort y est souvent configurée comme angoisse du néant.
Amadeo López
Sommaire Amadeo López - Présentation. Être-pour-la-mort et angoisseMaría Angélica Semilla Durán - La Muerte. Proliferación y vértigo en El desbarrancadero de Fernando Vallejo
Nathalie Lalisse-Delcourt - Les trompe-la-mort dans Altazor et Temblor de cielo de Vicente Huidobro
Clément Tournier - Le sexe et la mort dans La secta del Fénix de Jorge Luis Borges.
Lina Iglesias - Figures de l’enfant et de la mort dans l’œuvre poétique de Leopoldo María Panero
Béatrice Ménard - Tiempo, muerte y poesía en los sonetos de Jorge Cuesta
Amadeo López - El rostro anonadador de la muerte en « el Cristo yacente de Santa Clara de Palencia » y otros textos de Miguel de Unamuno
Sylvie Turc-Zinopoulos - El árbol de la ciencia de Pío Baroja et la mort : une approche schopenhauerienne
Florence Olivier - Entre la vie et la mort : du simulacre à l’identification dans …« Notas de un simulador » de Calvert Casey
Jaime Céspedes - Función ideológica de la muerte en Veinte años y un día de Jorge Semprún
Monique Plâa - L’écriture de la mort dans Palinuro de México de Fernando del Paso
Yolande Trobat - La menace de mort cortazarienne
Christina Komi-Kallinikos - Le Lance-flammes arltien : entre le non-sens et le non-être, un voltigeur aux bords du Néant
Françoise Moulin Civil - La mort et le vide : Pájaros de la playa de Severo Sarduy