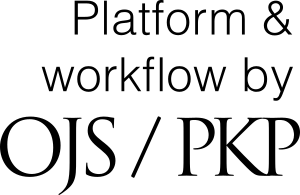Archives
-
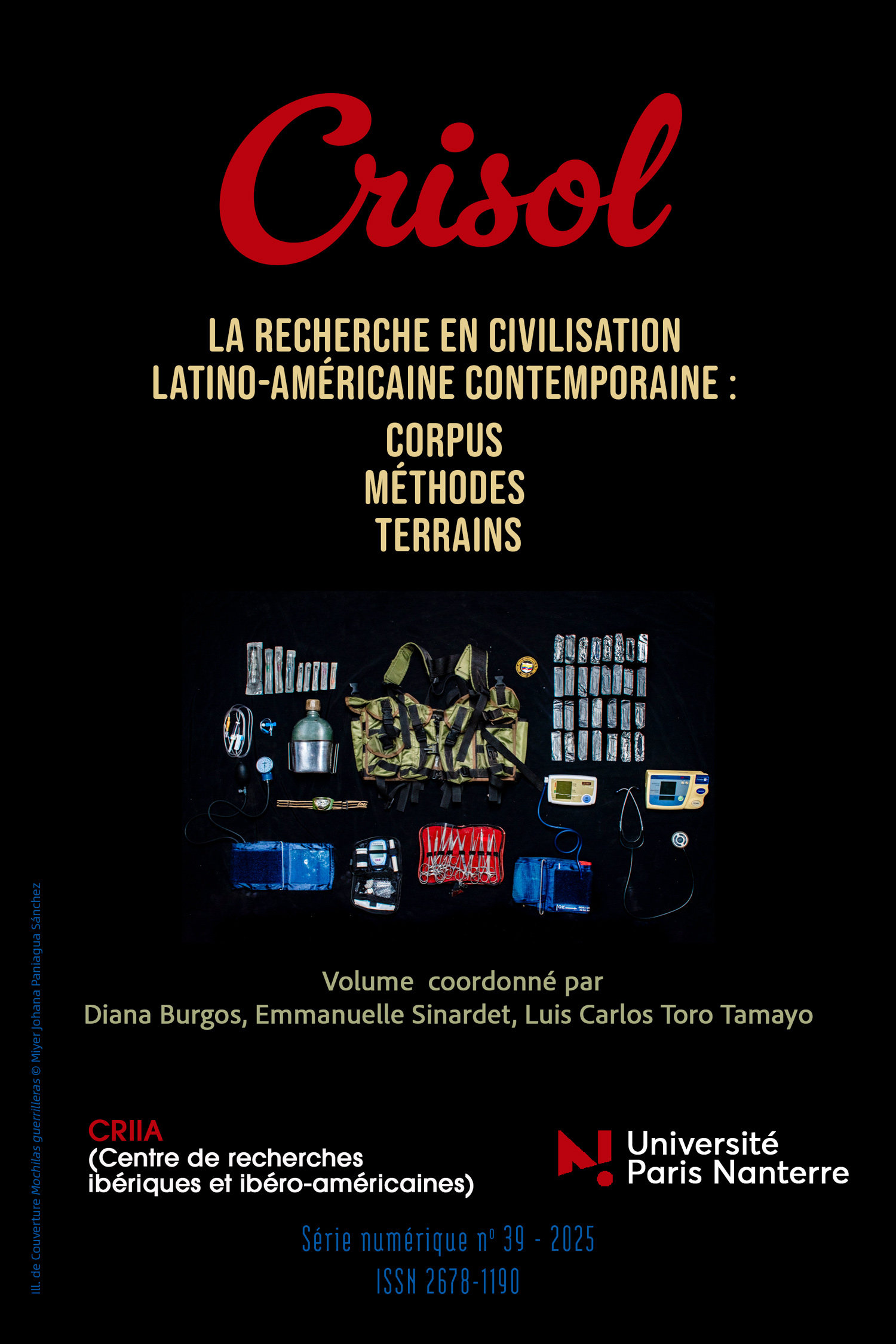
La recherche en civilisation latino-américaine contemporaine: corpus, méthodes, terrains
No 39 (2025)América Latina es un espacio de estudio complejo, marcado por desigualdades estructurales y dinámicas culturales innovadoras. Las transformaciones digitales han modificado no solo la circulación del conocimiento, sino también los enfoques metodológicos en las ciencias sociales y humanas. En este contexto, el presente dossier reúne a investigadores de Europa y América Latina para debatir sobre memoria, arte, prácticas sociales y el impacto de lo digital en la investigación. Las discusiones prolongan un ciclo de seminarios previos del GRECUN centrados en la epistemología de la civilisation latino-américaine, abordando preguntas clave sobre objetos de estudio y enfoques metodológicos. El dossier busca consolidar un diálogo académico transatlántico, cuestionando las posiciones de los investigadores en un campo atravesado por tensiones disciplinares y asimetrías de poder. Presenta una diversidad de enfoques y objetos que enriquecen el campo de los estudios latinoamericanos y recoge experiencias de investigación en el marco del enfoque de civilisation, abordando temas como el patriotismo mexicano, las identidades autóctonas o los museos inmateriales. Estas contribuciones destacan la riqueza de la interdisciplinariedad y la necesidad de cuestionar los marcos epistémicos heredados, invitando a pensar la civilisation como un proyecto colectivo en constante construcción.
L’Amérique latine constitue un espace d’étude particulièrement complexe, marqué à la fois par des inégalités structurelles persistantes et par des dynamiques culturelles innovantes. Les transformations numériques ont profondément modifié non seulement les modes de circulation du savoir, mais aussi les approches méthodologiques en sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, le présent dossier réunit des chercheurs et chercheuses d’Europe et d’Amérique latine autour de thématiques telles que la mémoire, l’art, les pratiques sociales et l’impact du numérique sur la recherche. Ces réflexions prolongent un cycle de séminaires antérieurs du GRECUN, centré sur l’épistémologie de la « civilisation latino-américaine », en abordant des questions fondamentales relatives aux objets d’étude et aux cadres méthodologiques. Ce dossier vise à consolider un dialogue académique transatlantique, en interrogeant les positionnements des chercheurs dans un champ traversé par des tensions disciplinaires et des asymétries de pouvoir. Il met en lumière la diversité des approches et des objets qui enrichissent les études latino-américaines, tout en rendant compte d’expériences de recherche menées dans le cadre de l’approche « civilisationniste », autour de thématiques telles que le patriotisme mexicain, les identités autochtones ou encore les musées inachevés. Ces contributions soulignent la richesse de l’interdisciplinarité et la nécessité de remettre en question les cadres épistémiques hérités, en invitant à concevoir la « civilisation » comme un projet épistémologique collectif, en perpétuelle construction.
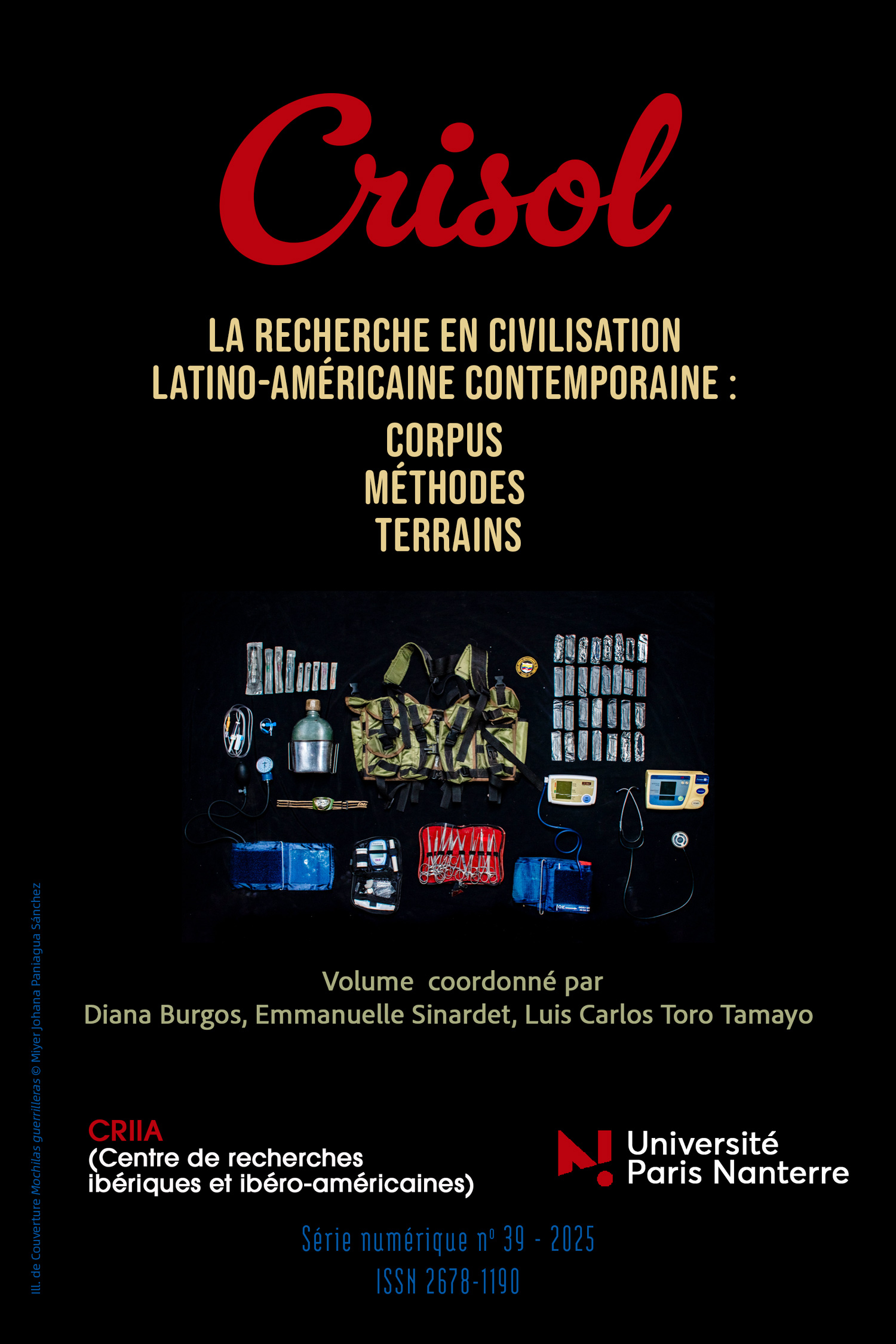
SOMMAIRE
Préface
Catherine HEYMANN, «Des lettres, des couleurs et des sociétés humaines: jalons d’un parcours amazonien»
Texte introductif
Diana BURGOS, Emmanuelle SINARDET, Luis Carlos TORO TAMAYO, «Corpus alternativos y metodologías híbridas para estudiar procesos socioculturales en América Latina»
1. Nouvelles approches pour la recherche en civilisation latino-américaine
Enrique FERNANDEZ DOMINGO, «Los relatos y las guías de viaje como fuentes para una historia cultural latinoamericana en el siglo XIX»
Laura LEMA SILVA «Pour une théorie de la contrebande dans l’étude des savoirs et des productions culturelles autochtones en Colombie»
Luis Carlos TORO TAMAYO et Miyer PANIAGUA SÁNCHEZ, «Memorias de la guerra. Mochilas portadoras de recuerdos»
Juliana MARÍN-TABORDA, «Fabuler des corps-événements comme résistance à la mort»
2. Carnets de terrains civilisationnistes: quels objets, avec quels outils?
Dalila CHINE LEHMANN, «Le sentiment patriotique au Mexique comme objet de recherche : outils, défis et perspectives scientifiques»
Morgana HERRERA MICLEA, «Les spectres de musées, de l’Amazonie à la Caraïbe»
Marie LECOUVEY, «À la croisée de l'histoire de l'art et de l'histoire politique mexicaines»
Maud YVINEC, «Autochtonie, culture et politique en perspective transdisciplinaire: quelles sources et quelles méthodes pour analyser des processus d’affirmation ethnique? Quelques réflexions sur l’étude de l’identité chanka à Andahuaylas (Pérou)»
En guise de conclusion
Emmanuelle SINARDET, «Essai de caractérisation de la (très inconfortable) “civilisation”: réfléchir en transdisciplinarité?»
-
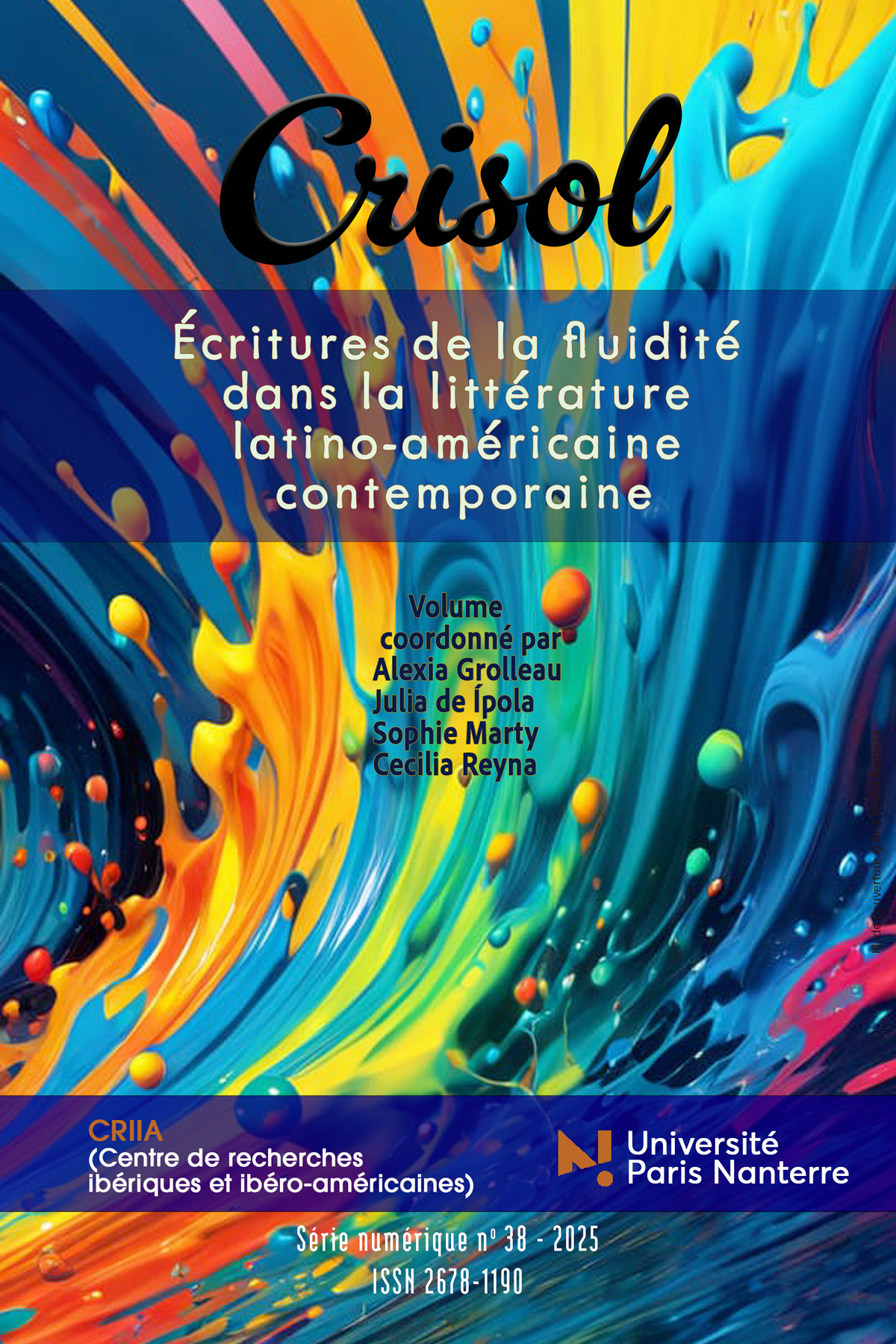
Écritures de la fluidité dans la littérature latino-américaine contemporaine
No 38 (2025)El volumen de Crisol “Escrituras de la fluidez en la literatura latinoamericana contemporánea” se propone pensar las convergencias temáticas y formales de una serie de preocupaciones actuales en la literatura y la crítica latinoamericanas que pueden entenderse conjuntamente a través de la noción de fluidez. A partir de esta última, hemos invitado a lxs autorxs a indagar en imaginarios de líquidos que fluyen, así como en su traducción –o no– en manifestaciones formales –un estilo fluido, una poética de la fluidez– y en los acercamientos críticos –la ecocrítica, los estudios sobre la corporalidad, los estudios de género– que han buscado dar cuenta de este fenómeno en sus distintas declinaciones. El número cuenta con contribuciones que abordan textos de autorxs oriundxs de distintos países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, Uruguay…), y cuya producción se extiende sobre un siglo: La vorágine, de José Eustasio Rivera –el texto abordado en el artículo de Luengas–, es de 1924, y el conjunto de cuentos Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero –estudiado en la contribución de Velecela, se publica en 2021.
Constatamos asimismo que la fluidez, como prisma para pensar la literatura contemporánea, lleva la marca de su propio significado: se trata de una noción que acusa en sí misma una versatilidad singular, que permite tanto dar cuenta, transversalmente, de nuevas tendencias en la literatura latinoamericana actual –como lo son la preocupación por el medioambiente o la estética queer– como releer desde un ángulo crítico novedoso obras ya instaladas en el canon regional.
Estas contribuciones, si bien aportan cada una mirada singular sobre la noción de fluidez –pensando incluso, en ocasiones, con razón, los límites de esta última–, convergen en distintos planos: destacamos un interés, a nivel temático, por los fluidos corporales (Velecela Chacón; Ibáñez), por las identidades fluidas y los personajes queer (Albertini; Peña) o por los fenómenos naturales –y en particular los ríos (Luengas; Koch)– y la ecología; en cuanto a la dimensión formal, los artículos indagan –y dialogan fecundamente entre sí– en torno a las nociones de flujo textual (Desmas) o de flujo de consciencia (Albertini), por ejemplo.
Los puntos de contacto entre los artículos de este número nos han demostrado, al mismo tiempo, el interés de la noción de fluidez como enfoque para el análisis: lxs autorxs se han apropiado de la noción de fluidez y han hecho de ella una herramienta que habilita una serie de operaciones críticas cuyos contornos se perfilan a lo largo de los artículos.
Primero, la fluidez ha permitido facilitar un diálogo entre disciplinas –la literatura y las artes visuales en el caso de Moctezuma, que realiza un estudio comparativo de las obras de Teresa Margolles y de Fernanda Melchor– y epistemologías –la cosmovisión del ecologista y líder indígena Krenak y la teoría del antropólogo Gilbert Durant en el caso de Koch–, propiciando una reflexión transdisciplinaria que articula distintas perspectivas para abordar los fenómenos contemporáneos.
Por otra parte, la noción de fluidez, con sus resonancias postmodernas, es hábilmente implementada para repensar obras canónicas como La vorágine, de José Eustasio Rivera, desplazando el foco de la selva hacia los ríos, como lo hace la contribución de Luengas. La fluidez aparece entonces como un y, así, como un principio del trabajo crítico, capaz de renovarse, en una postura dinámica y plural, a contrapelo de lecturas estáticas y fijadas –carentes de fluidez.
Por último, el foco puesto en los fluidos se revela pertinente para el estudio de fenómenos de violencia en la literatura contemporánea –problemática central en aportes como el de Velecela Chacón, el de Moctezuma, y que aparece en filigrana en otros como los de Koch, Luengas o Peña–. Los artículos en cuestión llevan a postular en última instancia la fluidez como una noción dual, en tanto actúa tanto como un símbolo de violencia –al aludir al derrame de fluidos como la sangre– como un principio de resistencia, que –como bien muestran los análisis en torno al cuerpo abyecto en la literatura de María Fernanda Ampuero (Velecela Chacón), o al cuerpo enfermo en la obra de Armonía Somers (Ibáñez)–, a través del derrame o el desbordamiento, desafía fronteras, límites preestablecidos y habilita formas radicales de rebeldía.
Para cerrar, este número tiene el privilegio de contar asimismo con una entrevista realizada con Gisela Heffes, que ofrece una mirada sobre la ecocrítica situada siempre entre la creación, la crítica y la teoría, y que resulta particularmente enriquecedora para pensar el fluir –precisamente– de los conocimientos en este campo.
***
Agradecemos a lxs colaboradores de este número por sus valiosos aportes: sus contribuciones no solo enriquecen el debate, sino que invitan a una reflexión sobre las múltiples formas en que la fluidez permea la literatura y la cultura latinoamericanas. El presente volumen es un número abierto, que será progresivamente alimentado con las próximas contribuciones. Esperamos que esta primera serie de artículos estimule la llegada de otros que –si se nos permite la metáfora– sigan irrigando el volumen.
Julia de Ípola, Alexia Grolleau Sophie Marty, Cecilia Reyna
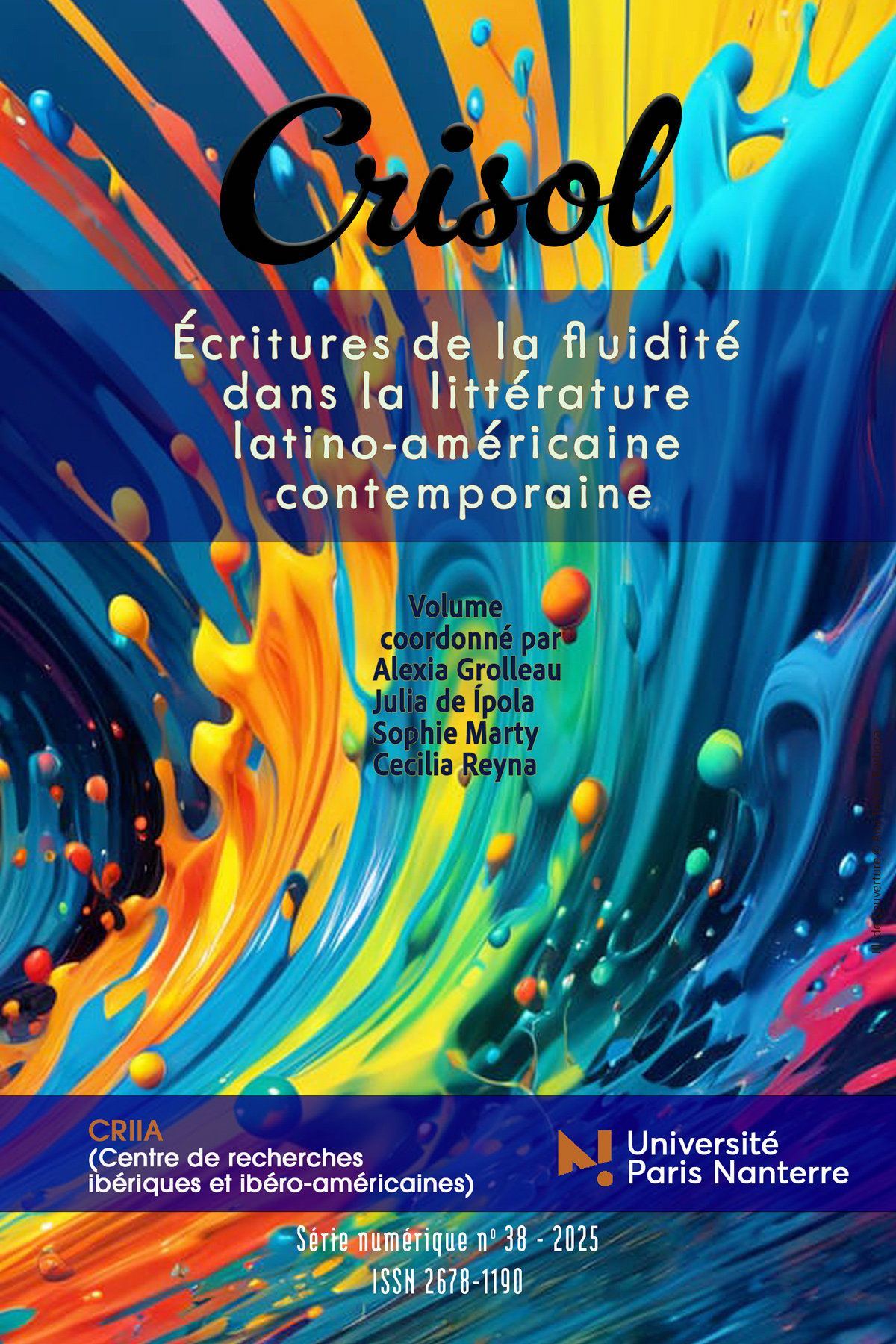
SOMMAIRE
Juan Salvador Velecela Chacón (Sorbonne Université), «Misterios gozosos y misterios dolorosos: fluidos y supervivencia en los cuentos de María Fernanda Ampuero»
Manuela Luengas (Columbia University), «Líneas fluidas: ríos y mapas en La vorágine de José Eustasio Rivera»
Nayeli Moctezuma Moreno (Centre de Recherches Ibériques et Ibero-americaines,Université Paris-Nanterre / Groupe d'Histoire Actuelle, Université de Cadix), «Fluidos de la Vida y la Muerte: hacia un diálogo entre Fernanda Melchor y Teresa Margolles en la representación de la violencia en México»
Eduardo Peña Cardona (Université de Bretagne Occidentale, «Flux et fluides dans le roman trans hispano-américain»
Felipe Koch (Université Paris-Est Créteil - Centre de recherche interdisciplinaires sur le monde lusophone), «Fluidez simbólica: um diálogo entre Ailton Krenak e Gilbert Durand»
Thomas Albertini (AMERIBER – Université Bordeaux Montaigne), «Une petite fille prénommée César : fluidité, genre et filiation dans Cómo me hice monja de César Aira»
Agustina Ibañez (Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) Centro de Investigación sobre Archivos y Lenguajes (CIAL) Instituto de Investigaciones sobre Sociedades Territorios y Cultura (ISTeC), «Flujos y reflujos: cuerpo enfermedad y linfa en Armonía Somers»
Davy Desmas-Loubaresse (Université Toulouse Jean Jaurès (CEIIBA) / INU Champollion / CEIIBA), «Paradoxes de la lecture chez Ariana Harwicz et Gabriela Cabezón Cámara: heurts et obstacles par-delà le flot du texte»
David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre / CRIIA), « Entrevista a la profesora Gisela Heffes (John Hopkins University)»
-
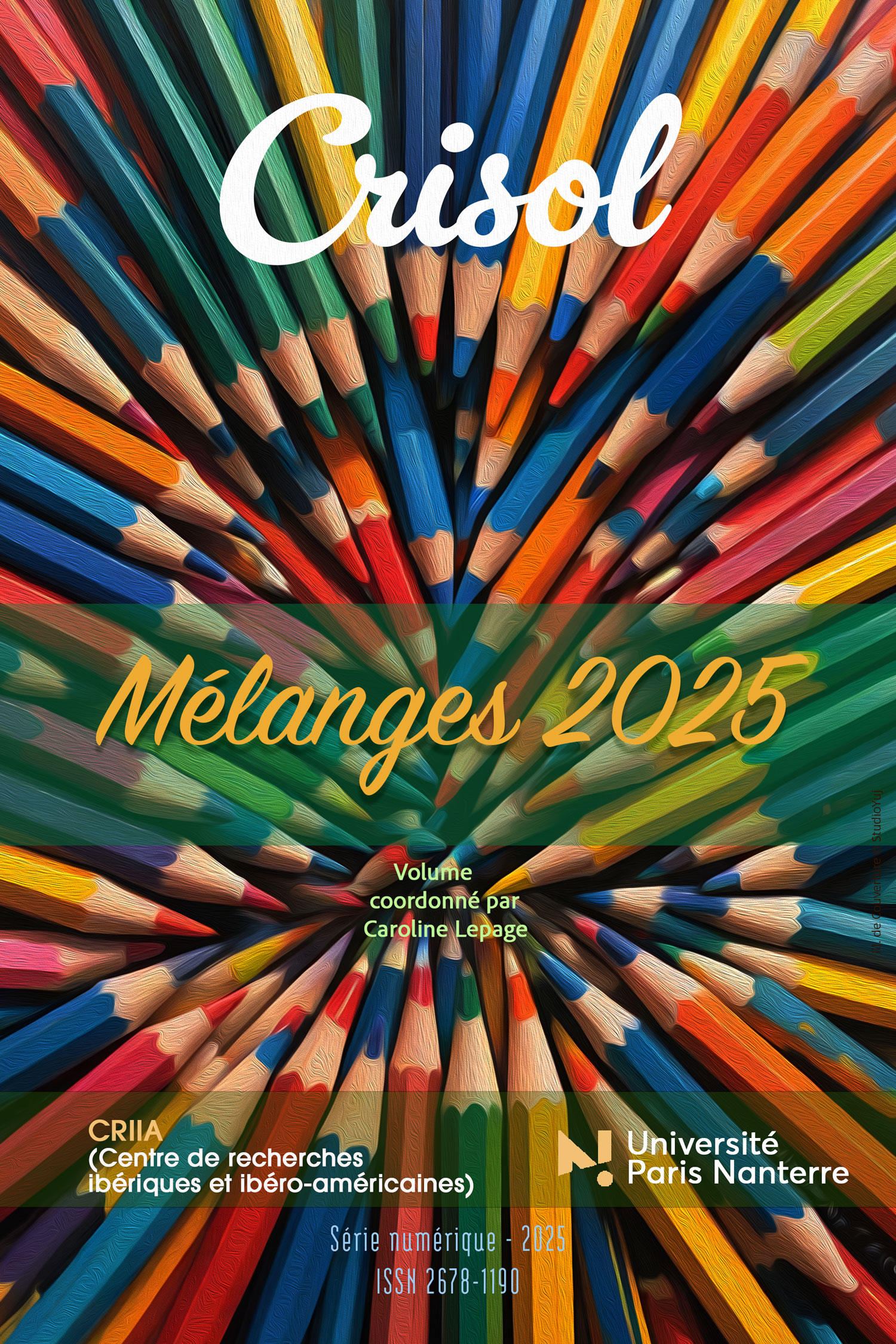
Hors série 2025
No HS (2025)Ce numéro est le quatrième des Hors série «Mélanges». De nouveau, il s'agit ici de rassembler des textes portant sur des thèmes, des époques et des zones géographiques très variés. Les chercheurs·euses invité·e·s à y participer ont en effet reçu carte blanche pour produire un travail sur le sujet de leur choix, depuis les méthodologies adaptées et, surtout, sans limite en terme de longueur pour leur permettre de véritablement prendre le temps d'approfondir leur réflexion.
Le volume s'enrichira de nouvelles contributions tout au long de l'année 2025.
Bonne lecture!
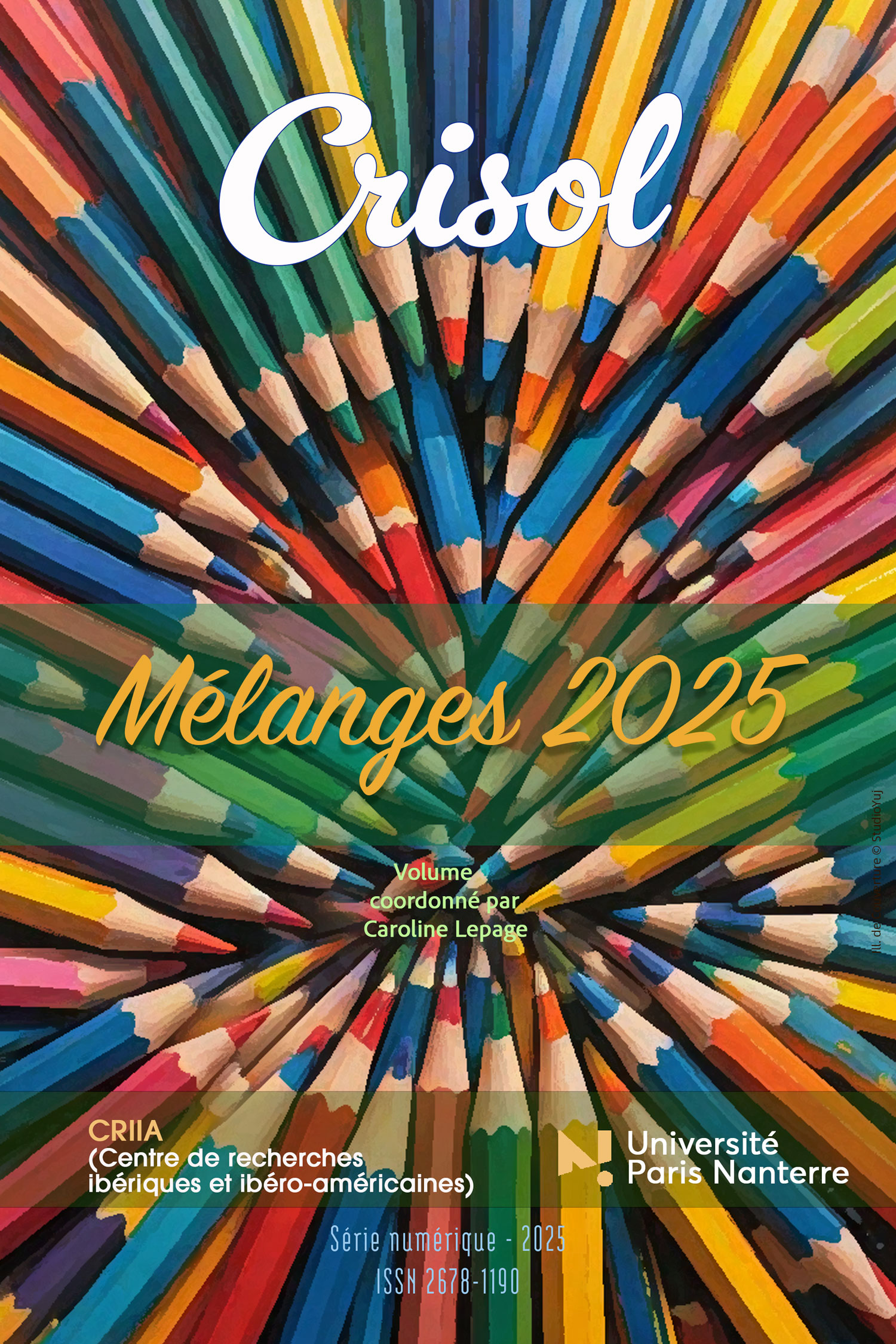
SOMMAIRE
Murielle Borel (Aix Marseille Université, CAER), «Les mécanismes mémoriels de l’autofiction dans La loca de la casa de Rosa Montero»
Kassandre Aslot Université (Sorbonne-Nouvelle, CRES-LECEMO), «Les Comunidades de Castille dans l’historiographie aragonaise au regard des soulèvements de 1591»
Yannick Llored (Université de Lorraine /UR LIS), «Trajectoires d’une affinité intellectuelle: Juan Goytisolo et Francisco Márquez Villanueva»
Sophie Large (Université de Tours | ICD (EA 6297) Institut universitaire de France (Iuf), «Réécriture(s) et mise en récit de mythes et légendes taïnos: de la mémoire (dé)coloniale à l’ineffable»
Anne Mathieu (Université de Lorraine; membre de Plurielles –Bordeaux-Montaigne), «Marguerite Jouve reportrice en Espagne de la victoire du Frente popular aux premiers mois de la guerre – Stéréotypes envers les Espagnols et posture de la journaliste»
Dorothée Chouitem Sorbonne (Université – CRIMIC / EA 2561), «Mémoire de la répression dictatoriale: le cas de la ville de Montevideo»
Comptes-rendus
David Fernando Endara-ibarra (Universidad Tecnológica Indoamérica), «La imaginación patriarcal. Emergencia y silenciamiento de la mujer escritora en la prensa y literatura ecuatorianas, 1860-1900 de Juan Carlos Grijalva»
Mercedes Brouste-Blanc, «Bernard Sesé, L’aventure mystique de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix / Sylvie Sesé-Léger (avant-propos), Agathe Bonnin et Marc Zuili (éd.) Publication en ligne de la SoFHIA, Hors-série 6, 2024»
Sylvie Turc-Zinopoulos (Université Paris Nanterre / CRIIA), «365 relojes. La Baronesa de Wilson (c. 1833-1923) de Pura Fernandez (2022) / Presentación paso por paso»
Agnès André (Université d'Orléans), «Juan A. Godoy Peñas Memoria, identidad y literatura del yo - Narrativas de la segunda generación de escritores exiliados por la guerra civil española, Editorial Renacimiento (Sevilla) Biblioteca del exilio, 2021»
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, CRIIA - UR Études Romanes), «Geneviève Verdo, Des peuples en mal d’union. Aux origines de l’Argentine»
Yves Macchi (Université de Lille-SHS – ULR 4074 CECILLE), «Élodie Blestel, Discrimination linguistique, sociale et raciale. Une approche énactive en Caraïbe colombienne»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-

Savoirs et pratiques de l’écologie dans l’aire hispanophone
No 37 (2025)Ce numéro de Crisol est en grande partie issu des communications et échanges qui eurent lieu à Paris à l’automne 2021 dans le cadre des journées d’étude Discours sur l’environnement dans l’aire hispanophone, dont l’intention première était de réparer une relative invisibilité de l’aire hispanophone dans la réception française des débats théoriques sur l’écologie. Si les questions écologiques occupent, ces dernières années, une part grandissante dans les études hispaniques et ibéro-américaines, l’écologie semble encore trop souvent être un ensemble de discours qui s’énonce essentiellement en anglais, en français et en allemand. Pourtant, le monde hispanophone, qui a été confronté très tôt aux logiques extractives, est, depuis le début du XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui, un espace de pratiques de résistance tout autant qu’un espace de pensées écologistes. Ce numéro tente de faire dialoguer des expert·es de champs disciplinaires distincts pour contribuer à la connaissance des savoirs et des pratiques de l’écologie dans l’aire hispanophone, à travers l’anthropologie, l’histoire et la géographie, mais aussi à travers la littérature et les arts plastiques. Il est dédié à la mémoire d’Anne-Laure Bonvalot, pionnière de l’introduction en France des théoricien·nes de l’écologie politique et décoloniale d’Amérique latine.
David Castañer, Canela Llecha Llop, Maud Yvinec
.jpg)
SOMMAIRE
David Castañer (Université Paris 1 / HiCSA), Canela Llecha Llop (Université Paris 1 / SIRICE), Maud Yvinec U(niversité Paris 1 / Mondes Américains), «Savoirs et pratiques de l’écologie dans l’aire hispanophone / Introduction»
David Castañer (Université Paris 1 / HiCSA), «Ana Teresa Barboza: les fils au-delà du paysage1 (à propos de l’illustration de couverture)»
Alexis Sierra Sorbonne Université, Laboratoire Médiations, «Penser les catastrophes «naturelles»: l’approche sociale d’une communauté épistémique latino-américaine»
Diego Orihuela Ibañez (Pontificia Universidad Católica del Perú), «Racialidad del Poder: Raza y trabajo en la minería peruana del siglo XX a través de un análisis desde la colonialidad del poder»
Pablo Corral-Broto (Espace-Dev, Univ Réunion, IRD, La Réunion, France Ettis-Inrae, Bordeaux, France), «Historia de la contaminación del agua en la España contemporánea (siglos XIX y XX)»
Mélanie Lercier Castelot (Université Rennes 2 – ERIMIT), «“Tienes que tomar para que no se seque el agua”. Analyse d’un rituel propitiatoire dans un village des Andes péruviennes»
María Gabriela Merlinsky (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), Paula Serafini (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Queen mary University of London), «Arte, ecología política y conflictividad ambiental en América Latina»
María Josep Balsach (Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis. Universitat de Girona), Saray Espinosa (Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis. Universitat de Girona), «Cecilia Vicuña. Del arte precario a las heridas del río Mapocho»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
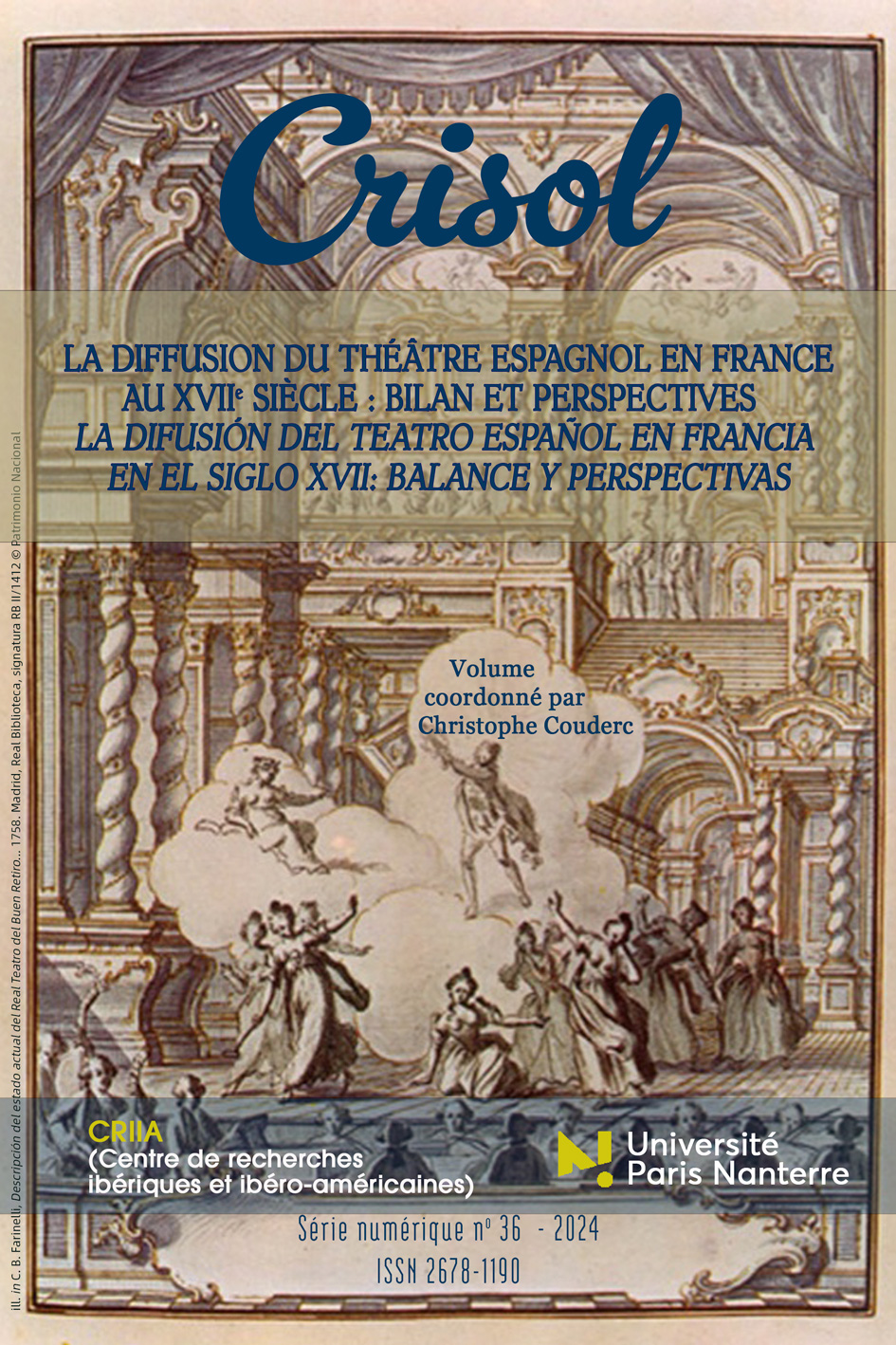
La diffusion du théâtre espagnol en France au XVIIe siècle: bilan et perspectives / La difusión del teatro español en Francia en el siglo XVII: balance y perspectivas
No 36 (2024)Pour Jean Canavaggio, in memoriam
Les articles réunis dans ce dossier procèdent d’un colloque international qui s’est tenu à l’université de Nanterre les 27 et 28 septembre 2022. Organisée par le Groupe de Recherches sur l’Espagne de l’Âge classique (GREAC) –l’un des groupes composant le Centre de recherches ibériques et ibéroaméricaines (CRIIA) au sein de l’unité de recherche Études Romanes–, cette rencontre relevait de la politique scientifique mise en œuvre par ladite unité de recherche, dont le périmètre géographique et culturel singulier facilite le travail conjoint des hispanistes, des italianistes et des lusistes qui en sont membres. À ceux-ci se sont associés, pour l’occasion, des collègues en provenance d’universités françaises, espagnoles, suisses ou italiennes.
Ce colloque s’inscrit dans une série commencée en 2009 par une première manifestation, déjà consacrée à l’étude de la circulation des formes et des modèles d’écriture théâtrale, et à l’insertion de la Comedia espagnole dans son contexte européen: ‘La Comedia espagnole du Siècle d’Or en France : Lecture, adaptation, mise en scène’. En janvier 2013 fut organisé, en collaboration avec le CRES-LECEMO (Université de Paris III), ‘La formation du théâtre tragique dans l’Europe méditerranéenne. Adaptation, circulation et renouveau des modèles (XVIe et XVIIe siècles)’, suivi en avril 2015 d’un nouveau colloque, ‘La circulación de los modelos teatrales: Italia, España y Francia (siglos XVI-XVIII), influencias, contaminaciones, adaptaciones’, célébré à Vercelli et fruit d’une collaboration avec l’université du Piémont Oriental (1).
La diffusion en France du théâtre espagnol du Siècle d’or, qui relève de ce que Roger Chartier nomme la mobilité textuelle, confronte qui veut s’y intéresser à des difficultés certaines, qui font aussi tout l’intérêt de son étude. Parmi ces difficultés, la première est sans doute de devoir se placer à cheval sur une frontière, géographique et culturelle, mais qui est aussi bien souvent d’ordre académique. Les comparatistes sont d’ordinaire les mieux rompus à la franchir ou en faire fi, mais ils ont depuis longtemps pu être rejoints dans cet exercice par les dix-septiémistes français, et aussi par les hispanistes. Parmi ces derniers, les hispanistes de France disposent d’une compétence et d’un positionnement dans le champ des savoirs qui devraient a priori leur faciliter la tâche. Mais force est de constater qu’ils ont été rejoints et supplantés, dans un passé récent, par des hispanistes d’Espagne, lesquels se sont intéressés au devenir international, c’est-à-dire, de façon plus générale, à la fortune des œuvres des dramaturges dont l’édition critique des œuvres complètes a été entreprise de façon collective au cours des dernières décennies: il en est ainsi pour Lope de Vega, Calderón de la Barca, Moreto, Pérez de Montalbán ou d’autres encores. Dans ce cadre, nombreux sont les travaux parcellaires (notamment à l’occasion de l’édition critique de telle ou telle comedia) qui ont pu mettre en évidence combien pouvait être enrichissant, pour les hispanistes eux-mêmes, de prendre en considération la postérité de ces textes dramatiques outre-Pyrénées.
Les textes rassemblés ici peuvent globalement être classés en deux catégories, non nécessairement exclusives. D’un côté, des études qui, sans laisser d’analyser des textes français et espagnols placés en regard les uns des autres, traitent de questions relevant de la poétique du théâtre, mais aussi de la théorie littéraire –ou plutôt des jugements de goût qui en tiennent lieu au XVIIe et au XVIIIe siècles– ou d’une certaine construction idéologique. D’autre part, des contributions (les plus nombreuses) qui font la part belle à la comparaison, ce qui démontre la fécondité intacte de cette approche, toujours stimulante pour les spécialistes. Il peut s’agir d’une comparaison limitée à un texte et sa source, supposant aussi bien l’établissement d’une influence précise qu’un éclairage singulier, à rebours, sur l’hypotexte; la perspective peut être élargie à une série de textes ayant un motif en commun, ou aborder un corpus de vastes proportions. Disposés par commodité selon l’ordre alphabétique du nom de leurs auteurs, nous présenterons pour finir en quelques mots les travaux qui composent ce dossier.
Miguel Betti («Lope et Rotrou à la carte. Analyse cartographique des adaptations françaises de la Comedia Nueva») se propose d’étudier un double corpus, constitué par les adaptations réalisées par Rotrou de comedias de Lope de Vega et par ces mêmes sources, à l’aide des outils qu’offrent aujourd’hui les humanités numériques. Celles-ci lui permettent d’établir la cartographie des lieux mentionnés dans les textes français et dans leurs sources espagnoles. Le travail présente d’abord la méthode suivie pour collecter les données (grâce notamment à un machine learning) puis avance quelques propositions (destinées à prendre place dans un travail de plus grande ampleur) afin de corréler cette analyse de la géographie littéraire à l’épineuse question de la taxinomie du vaste répertoire de la Comedia espagnole. Mais la cartographie obtenue révèle également d’intéressantes constantes dans l’adaptation réalisée par Rotrou, comme sa préférence pour «un certain déplacement des pièces vers l’Ouest» et le fait non moins évident qu’il utilise beaucoup moins d’indications géographiques que Lope dans son texte. L’abondance des références géographiques se révèle être ainsi une «une marque de style chez Lope» et pourrait être le signe d’une écriture fortement tournée vers la mise en espace du texte sur la scène.
La contribution de Jean Canavaggio («La redécouverte de l’Arte nuevo de hacer comedias dans les premiers temps du Romantisme en France») porte sur ce qui constitue la première traduction de l’Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo de Lope de Vega: la version qu’en proposa Victor Laurent Angliviel de la Beaumelle qui publia en 1822 dans la Collection des chefs d’œuvre des théâtres étrangers quatre volumes de pièces espagnoles traduites, soit 15 comedias de Lope de Vega et de Calderón. L’étude préliminaire que La Beaumelle consacre au premier comporte, en plus d’une introduction biographique et d’une version de l’Arte nuevo une «Poétique de Lope de Vega». C’est ce texte que Jean Canavaggio choisit de publier en appendice de son article, après en avoir proposé une analyse. De celle-ci, il ressort que La Beaumelle, qui a lu avec perspicacité le texte de Lope, a sur la poétique du théâtre espagnol un point de vue équilibré, plus équilibré par exemple que celui de Victor Hugo ou de Mérimée, dans ces années où les esprits en France s’échauffent autour des questions touchant à l’esthétique théâtrale.
Christophe Couderc («Invention et disposition: la question du rapport à la source dans les paratextes des adaptateurs du théâtre espagnol au XVIIe siècle») tente une sorte d’étude génétique de l’apparition et de l’évolution d’un lieu commun de l’histoire de la littérature, bien repéré par la critique comparatiste: celui selon lequel les Espagnols –en général, mais, bien sûr, surtout quand ils sont écrivains– seraient remarquablement dotés en matière d’imagination. Cette capacité d’invention qui leur est prêtée, et qu’on trouve exprimée dans des textes le plus souvent parafictionnels, leur est d’autant mieux réservée en France que le processus d’adaptation de sources espagnoles ferait apparaître la supériorité française dans l’ordre de la disposition. Malgré une certaine polysémie du terme ‘invention’, on peut ainsi voir, en l’espace de quelques décennies, comment ce poncif se solidifie, et relève d’une construction idéologique au moins autant qu’esthétique visant le plus souvent à affirmer et défendre la supériorité du génie français.
C’est un constat très proche que l’on retrouve dans la contribution de Céline Fournial («La hiérarchisation des sources et des modèles: variations des jugements critiques sur le théâtre espagnol en France»), qui analyse comment l’évolution des références à la Comedia espagnole permet de voir l’émergence «d’un topos rhétorique qui exprime plutôt une conception du théâtre français lui-même qu’une véritable connaissance du théâtre espagnol par les auteurs français». Ce sont des raisons contextuelles qui expliquent la précoce disqualification en France d’un théâtre dont on reconnaît qu’il plaît, et dont on s’inspire massivement, mais que l’on considère injustifiable sur le plan de la théorie qui s’impose dans le champ intellectuel français au XVIIe siècle. La référence à la source espagnole échappe néanmoins le plus souvent au manichéisme, et relève plutôt d’un mélange d’éloge et de blâme : le dosage est souvent subtil car il s’agit pour le dramaturge français de tirer parti de la popularité de la littérature espagnole pour les lecteurs français et, en même temps, de mettre en évidence, à l’issue d’une ébauche de comparaison, sa propre supériorité dans le traitement du sujet que lui propose sa source.
Comme celui de Betti et celui de Reyrolle, l’article de Delia Gavela («La elección de las fuentes lopescas de Rotrou: ¿una cuestión de género?») porte sur Rotrou, peut-être le dramaturge français qui, au long de sa carrière, a développé avec la Comedia espagnole le rapport le plus constant et le plus fécond. Gavela observe que les choix opérés par Rotrou, parmi les dizaines de pièces de Lope qu’il a pu avoir entre les mains, révèlent une prédilection pour des comédies palatines sérieuses, où le comique est de basse intensité, et qui développent un conflit opposant un poderoso aux personnages qui l’entourent. Ayant par là même choisi d’aborder la question générique (ou taxinomique) –question complexe s’il en est, mais qui continue de passionner les spécialistes du théâtre espagnol– D. Gavela centre son analyse sur deux pièces du dramaturge de Dreux: la première et la dernière de ses adaptations les plus fidèles d’un original espagnol, à savoir La bague de l’oubli et Cosroès. Deux pièces pour lesquelles Rotrou utlilise des sources lopesques certes différentes, mais qui ont en partage de ressortir au sous-genre de la palatine. L’étude s’attache à démontrer comment Rotrou, en dépit de caractère génériquement hybride des sources qu’il choisit d’adapter, moyennant en particulier une simplification de ce que l’espagnol désigne comme “hibridismo genérico”, propose une réécriture qui tend à renforcer la qualité comique de la première pièce, tandis que la seconde est tirée vers une gravité et une dignité s’accordant mieux à un propos général où domine une réflexion morale et politique excluant le rire.
La contribution proposée par María Luisa Lobato, quoique centrée dès son titre sur l’auteur du Tartuffe («La invención de lo cómico verosímil: Molière en el fluir del motivo del ascenso social»), s’attache en réalité plus largement au motif de l’ascension sociale par le mariage. Ce motif est présent dans la production théâtrale des deux côtés des Pyrénées et il est ici étudié dans un corpus comprenant quatre comédies espagnoles et trois françaises. Le contexte socio-historique n’est pas le même dans les deux pays et peut expliquer les différences, mais en ce qui concerne le théâtre espagnol, la comedia de figurón constitue indéniablement un sous-genre de prédilection pour son exploration, liée à son tour au genre de l’entremés dans lequel la présence du motif est remarquable. Du côté du théâtre français, le changement le plus remarquable concerne le système des personnages puisque ce n’est plus un personnage masculin, le figurón, qui générera le rire, mais le type féminin de la précieuse, présent notamment dans Le Cercle des femmes de Chappuzeau, et, naturellement, dans Les Précieuses ridicules de Molière. En dépit des disparités constatables dans le traitement de la situation, la question des inégalités et des rigidités sociales propres à l’Ancien régime est présente dans les différents textes examinés, qui proposent une action dramatique structurée par une bourle salutaire.
Comme M. Betti et D. Gavela, c’est également à Rotrou que s’intéresse Séverine Reyrolle, et plus spécifiquement à sa stratégie hispanophile, voire «vegaphile» («Sacrifices en faveur du théâtre à son miroir: Rotrou devant Lo Fingido Verdadero»). Reprenant à nouveaux frais la comparaison entre la célèbre tragédie de martyr du Français et la comedia lopienne qui constitue l’une de ses sources, l’autrice s’attache à analyser trois catégories de «sacrifices dramaturgiques» opérés par Rotrou: la première concerne la structure de la pièce et, en particulier, le traitement du procédé de l’enchâssement, simplifié par le dramaturge de Dreux (qui sacrifie l’histoire d’amour) dans le cadre de ce qui peut être considéré comme une stratégie de perfectionnement et de régularisation du procédé. La seconde a trait au personnel dramatique, objet d’une réduction drastique par rapport à la source, au service d’une intensification du conflit tragique centré sur les personnages de Genest et de l’Empereur. La troisième est liée au traitement différent du merveilleux chrétien; là encore dans le but d’épurer et d’anoblir la structure du théâtre à son miroir, les modifications touchent autant aux conventions scénographiques (avec la suppression du procédé de la apariencia) qu’à l’esthétique théâtrale qui lui est liée. De ces multiples modifications, révélatrices, hors du champ du théâtre à proprement parler, de conceptions différentes de la foi de part et d’autre des Pyrénées, S. Reyrolle veut retenir un «double travail d’hommage et de magnification», manifestation d’un singulier rapport à sa source de la part du dramaturge français.
Salomé Vuelta García («El repertorio español de la Comédie-Italienne en tiempos de Luigi Riccoboni (1716-1729)») part du constat qu’il est nécessaire d’étudier les pièces jouées par la Nouvelle Troupe Italienne du point de vue de l’hispanisme, en raison de l’importance des hypotextes espagnols dans le répertoire que Riccoboni choisit de représenter devant le public parisien. Les sources de ces canevas de la commedia all’improviso comme de comédies plus écrites (commedia premeditata) sont encore souvent mal identifiées. Le travail de clarification, sur ce point, est d’autant plus nécessaire que, pour s’assurer les faveurs des spectateurs français, Riccoboni semble faire le choix de pièces où l’influence espagnole est patente. Dans le cadre d’un travail de plus grande ampleur dont sont données ici les prémisses, plusieurs questions devront être traitées, comme l’identification des types de textes qui ont véhiculé l’influence de la Comedia, la prise en compte des différents auteurs imités et de leur importance respective, le problème taxinomique inhérent au vaste répertoire théâtral espagnol, ou l’identification précise de la source de telle ou telle pièce.
Marc Vuillermoz («Le théâtre espagnol du Siècle d’or vu par les voyageurs français») propose d’étudier plus particulièrement quatre récits rédigés par des voyageurs français de retour d’Espagne. Malgré leurs disparités, ces témoignages ont en partage une vision qui, loin de donner lieu à une description objective des représentations, insiste sur ce que les auteurs considèrent comme des «‘curiosités’, que les voyageurs mettent en rapport avec les mœurs d’outre Pyrénées et jugent à l’aune des règles du goût français». Tous tendent également à considérer que leur théâtre reflète le mode de vie et le caractère des Espagnols, même si –et c’est en quelque sorte la manifestation du pouvoir de la fiction– les voyageurs français projettent sur la réalité dont ils sont censés rendre compte de première main des motifs et des biais directement générés par leur familiarité avec les pièces que les dramaturges français ont tiré de la Comedia au long du XVIIe siècle.
L’article d’Enrica Zanin clôt cet ouvrage avec une proposition légèrement décalée puisque, comme l’indique son titre («Traduire, transformer, adapter: quand en changeant de pays, le théâtre change aussi de genre») il s’agit d’y étudier la transmodalisation intermodale (comme disait Genette) que suppose de transposer une source espagnole dramatique en nouvelle (française). Un double processus de transformation, donc, bien moins courant que le processus inverse, largement documenté (le passage de la nouvelle au drame), mais qui a cependant intéressé au moins deux comedias, de Calderón et de Tirso de Molina, adaptées et nouvellisées par Boisrobert et par Scarron. Après avoir mis en évidence les diverses sortes de modifications apportées aux sources dramatiques, E. Zanin rassemble –les auteurs français n’ayant pas accompagné leur réécriture de paratextes explicatifs– un faisceau d’explications possibles à ce choix singulier et rappelle notamment la proximité, aux yeux des lecteurs de la première modernité, de la comédie et de la nouvelle, qui «sont deux genres de la performance rhétorique».
Je souhaiterais enfin terminer cette présentation en saluant la mémoire de Jean Canavaggio, dont on trouvera ici l’un des tout derniers articles. Jean Canavaggio n’avait pu participer à notre rencontre, mais, toujours disponible lorsque ses collègues nanterrois le sollicitaient, il avait cependant tenu à apporter sa contribution au présent volume, exprimant par là une fois de plus (et une dernière fois) la générosité et la confiance dont le signataire de ces lignes eut tant de preuves au fil des ans. Une fois qu’avait été lancé le processus d’édition des actes du colloque, il avait été, comme à son habitude, le premier à envoyer son texte, un peu plus de six mois avant sa disparition en août 2023. Ceux qui l’ont côtoyé à Nanterre, collègues, thésards ou anciens étudiants, n’oublieront pas les talents exceptionnels de professeur et de chercheur, mais non plus les qualités personnelles qui lui valaient l’affection et le respect de tous.
Christophe Couderc
(1) Les Actes de ces différentes rencontres sont disponibles : Le théâtre espagnol du Siècle d’Or en France (XVIIe – XXe siècles). De la traduction au transfert culturel, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, collection Littérature et Poétique comparées, 2012 (consultable en ligne à l’adresse : http://books.openedition.org/pupo/3049); La tragédie espagnole et son contexte européen. XVIe-XVIIe siècles. Circulation des modèles et renouvellement des formes, Ch. Couderc et H. Tropé (dir.), Paris, PSN, 2013, 269 p.) ; Paradigmas teatrales en la Europa moderna: circulación e influencias (Italia, España, Francia, siglos XVI-XVIII), Ch. Couderc et Marcella Trambaioli (dir.), Toulouse, PUM, col. Anejos de Criticón n° 21, 2016.
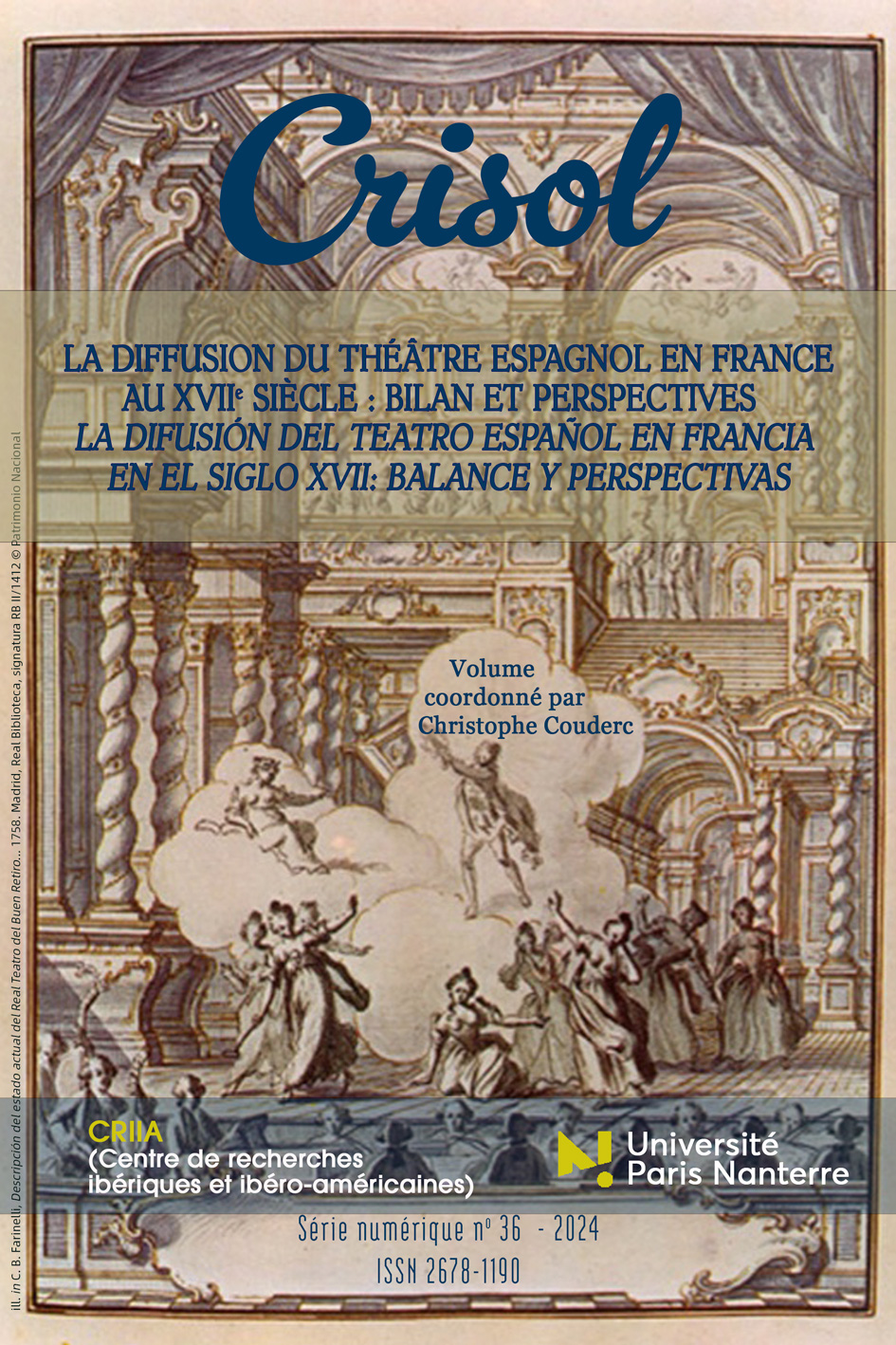
SOMMAIRE
Miguel Betti Université de Genève, «Lope et Rotrou à la carte. Analyse cartographique des adaptations françaises de la Comedia Nueva»
Jean Canavaggio (Université Paris Nanterre), «La redécouverte de l’Arte nuevo de hacer comedias dans les premiers temps du Romantisme en France»
Christophe Couderc (Université Paris Nanterre), «Invention et disposition: la question du rapport à la source dans les paratextes des adaptateurs du théâtre espagnol au XVIIe siècle»
Céline Fournial (Université Clermont Auvergne), «La hiérarchisation des sources et des modèles: variations des jugements critiques sur le théâtre espagnol en France»
Delia Gavela (Universidad de La Rioja), «La elección de las fuentes lopescas de Rotrou: ¿una cuestión de género?»
María Luisa Lobato (Universidad de Burgos), «La invención de lo cómico verosímil: Molière en el fluir del motivo del ascenso social»
Séverine Reyrolle Université (Reims Champagne Ardenne CRIMEL EA3311), «Sacrifices en faveur du théâtre à son miroir: Rotrou devant Lo Fingido Verdadero»
Salomé Vuelta García (Università degli Studi di Firenze), «El repertorio español de la Comédie-Italienne en tiempos de Luigi Riccoboni (1716-1729)»
Marc Vuillermoz (Université Savoie Mont Blanc), «Le théâtre espagnol du Siècle d’or vu par les voyageurs français»
Enrica Zanin (Université de Strasbourg), «Traduire, transformer, adapter: quand en changeant de pays, le théâtre change aussi de genre»
**
Compte-rendu
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, CRIIA - UR Études romanes), Centre d’études équatoriennes, «Le malheur est dans le pré: Compte rendu d’Un amour d’Isabel Coixet»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
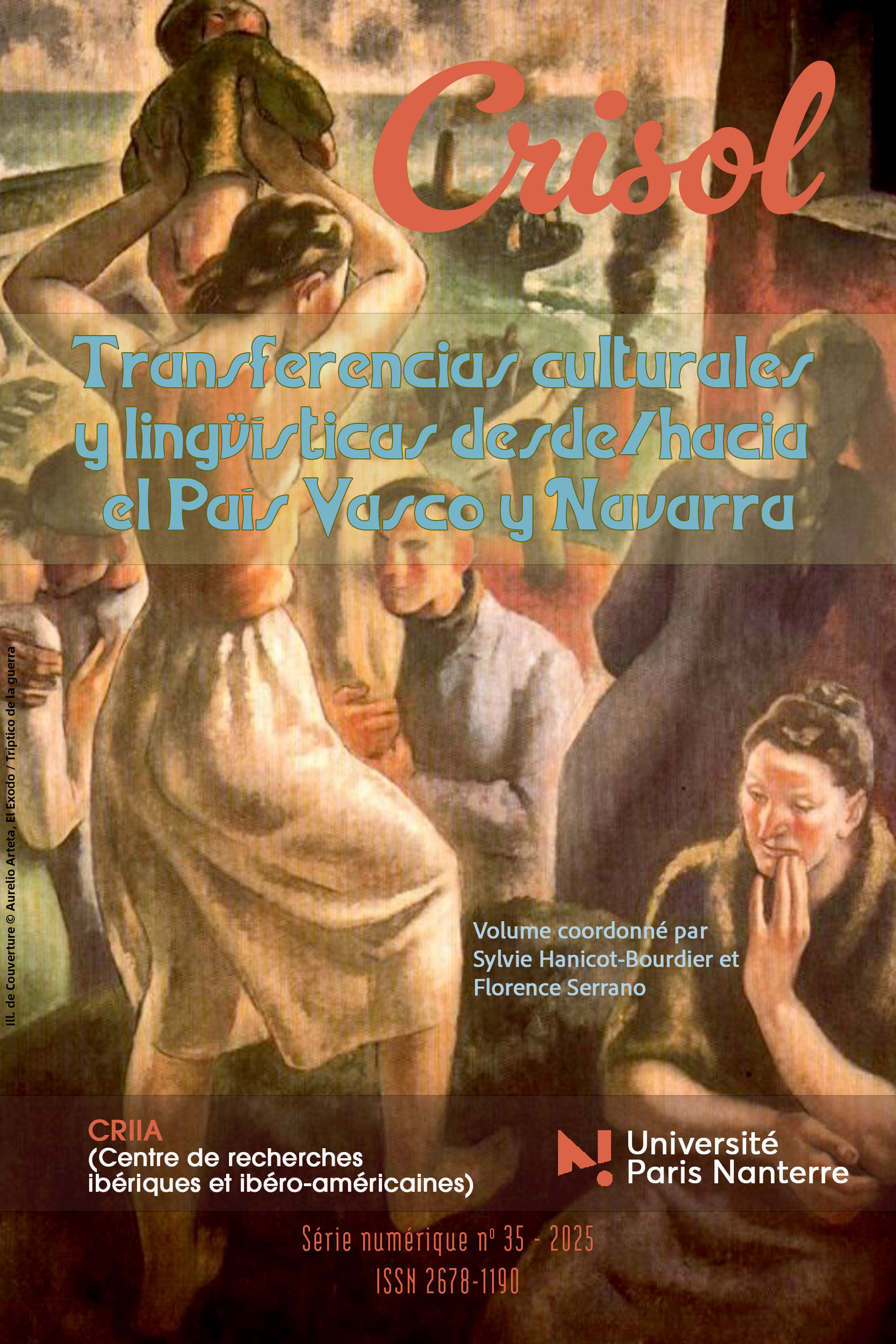
Transferencias culturales y lingüísticas desde/hacia el País Vasco y Navarra
No 35 (2024)Ce volume de la revue Crisol explore les multiples échanges culturels et linguistiques qui ont façonné le Pays basque espagnol et la Navarre à travers les siècles. Issu d’un colloque international tenu en septembre 2023, réunissant des enseignants-chercheurs d’horizons variés, il adopte une approche interdisciplinaire pour analyser les circulations d’idées, de langues et de pratiques entre ces territoires et le reste du monde hispanique, qu’il s’agisse de l’Espagne ou de l’Amérique latine.
Loin d’une vision figée ou réductrice, les auteurs réunis dans cette publication interrogent les dynamiques politiques, sociales et culturelles qui ont marqué ces quatre provinces. Leurs travaux abordent des thématiques variées, telles que le rôle des fueros dans la structuration juridique et identitaire locale, les enjeux de la diglossie espagnol-euskera, les migrations transatlantiques, ainsi que la transmission culturelle et linguistique au sein de la diaspora basque et navarraise. L’ouvrage met en lumière la façon dont ces territoires, souvent considérés comme périphériques, ont pourtant joué un rôle central dans l’histoire et la culture du monde hispanique.
En croisant perspectives historiques, linguistiques et littéraires, cette réflexion collective interroge également les tensions entre autonomie régionale et intégration nationale, entre préservation des traditions et adaptation aux transformations politiques et économiques. Les contributions rassemblées ici offrent ainsi un regard renouvelé sur l’évolution de ces régions, mettant en évidence leur capacité à évoluer tout en conservant une identité propre.
Destiné aux spécialistes en histoire, en linguistique et en études hispaniques, cet ouvrage s’adresse aussi à tout lecteur curieux de mieux comprendre les dynamiques profondes qui sous-tendent l’évolution culturelle et politique du Pays basque et de la Navarre, inscrites dans le contexte plus large de l’histoire ibérique et transatlantique.
Sylvie Hanicot-Bourdier et Florence Serrano
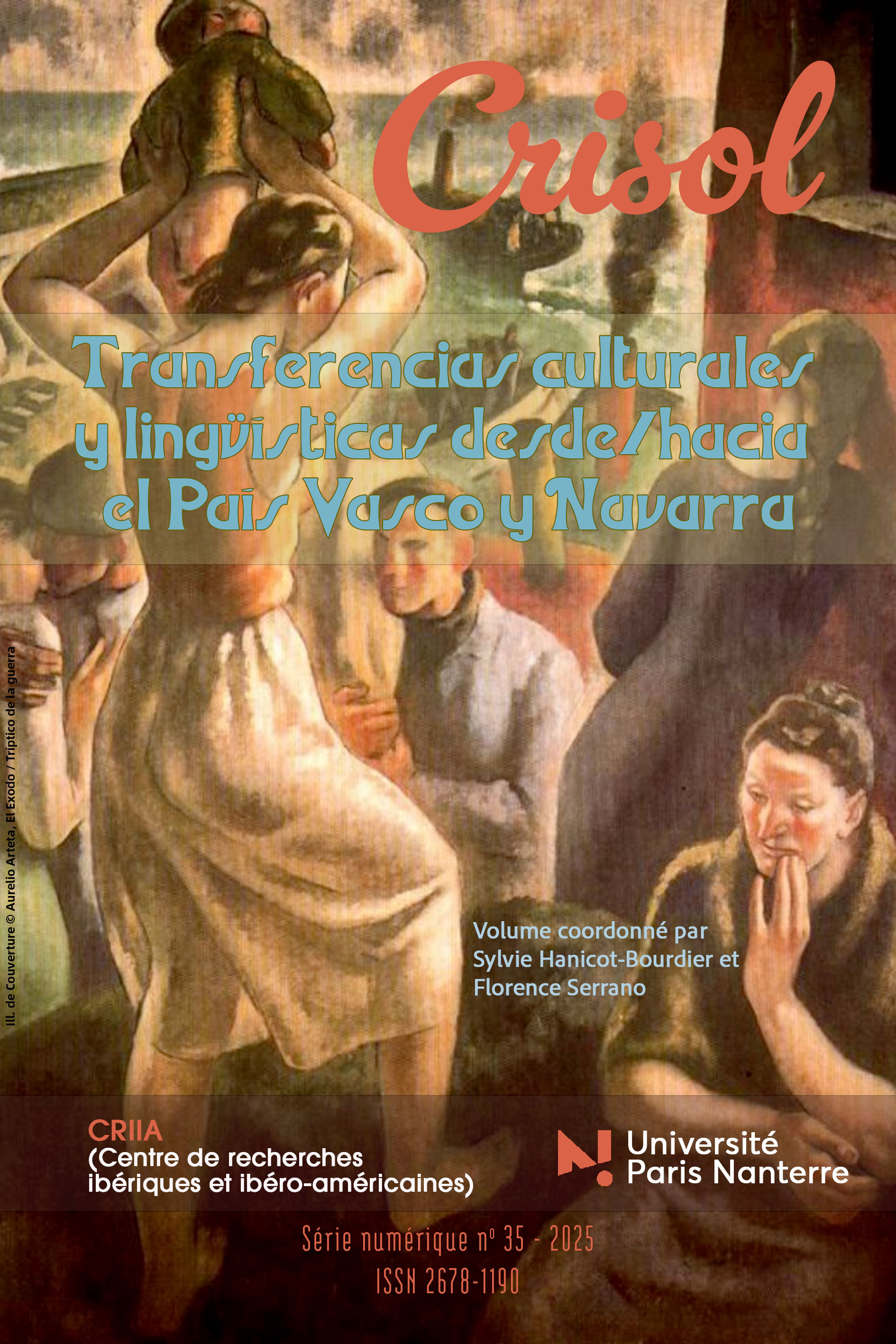
SOMMAIRE
Sylvie Hanicot-Bourdier (Université de Lorraine), Florence Serrano (Université Lumière Lyon 2), “Introducción. Transferencias culturales y lingüísticas desde/hacia el País Vasco y Navarra”
Nere Jone Intxaustegi Jauregi (Universidad de Deusto), “Los fueros vasco-navarros: usos, instituciones y peculiaridad jurídico-culturales”
Florence Serrano (Université Lumière Lyon 2), “El concepto fuero y su terminología: las transferencias lingüísticas con base en un culturema de la historia jurídica de España”
Linde Brocato (University of Arkansas, Fayetteville), “El Entremés del Príncipe de Viana: la Rebelión Toledana de 1449 y Juan II de Navarra”
Amaia Rojo Sierra (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea), “La “identidad” y el carácter identificativo del euskera entre los mercaderes vascos de Sevilla en el siglo XVI”
Sylvie Hanicot-Bourdier (Université de Lorraine), “La herencia familiar entre tradición y modernidad: fueros y sensibilidad familiar en Vizcaya, siglo XIX”
Jokin Lanz Betelu (Universidad Pública de Navarra), “Gipuzcua-tarren condaira Erroma-tarren demboran. Algunas anotaciones sobre la transmisión de la tradición de los Caballeros Transtiberinos a través de los bertsopaperak”
Marina Hansen (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea), “El rol del euskera en la prensa vasca de Argentina. El caso de La Baskonia, 1893-1899”
Carlos Estela-Vilela (Université Bordeaux Montaigne), “Imágenes vascas en el Perú a finales del siglo XIX”
Raquel Idoate Ancín, “De Navarra a América en el siglo XIX : historia de una emigración”
Gemma Piérola Narvarte (Universidad Pública de Navarra), “Cuando las palabras y el lenguaje sirven para reprimir y controlar: ser mujer en el franquismo”
Sara Álvarez-Pérez (Université Paris-Dauphine), “Más allá del Bidasoa: el papel de los refugiados políticos militantes de ETA y de la OAS en las relaciones binacionales franco-españolas durante los años sesenta”
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
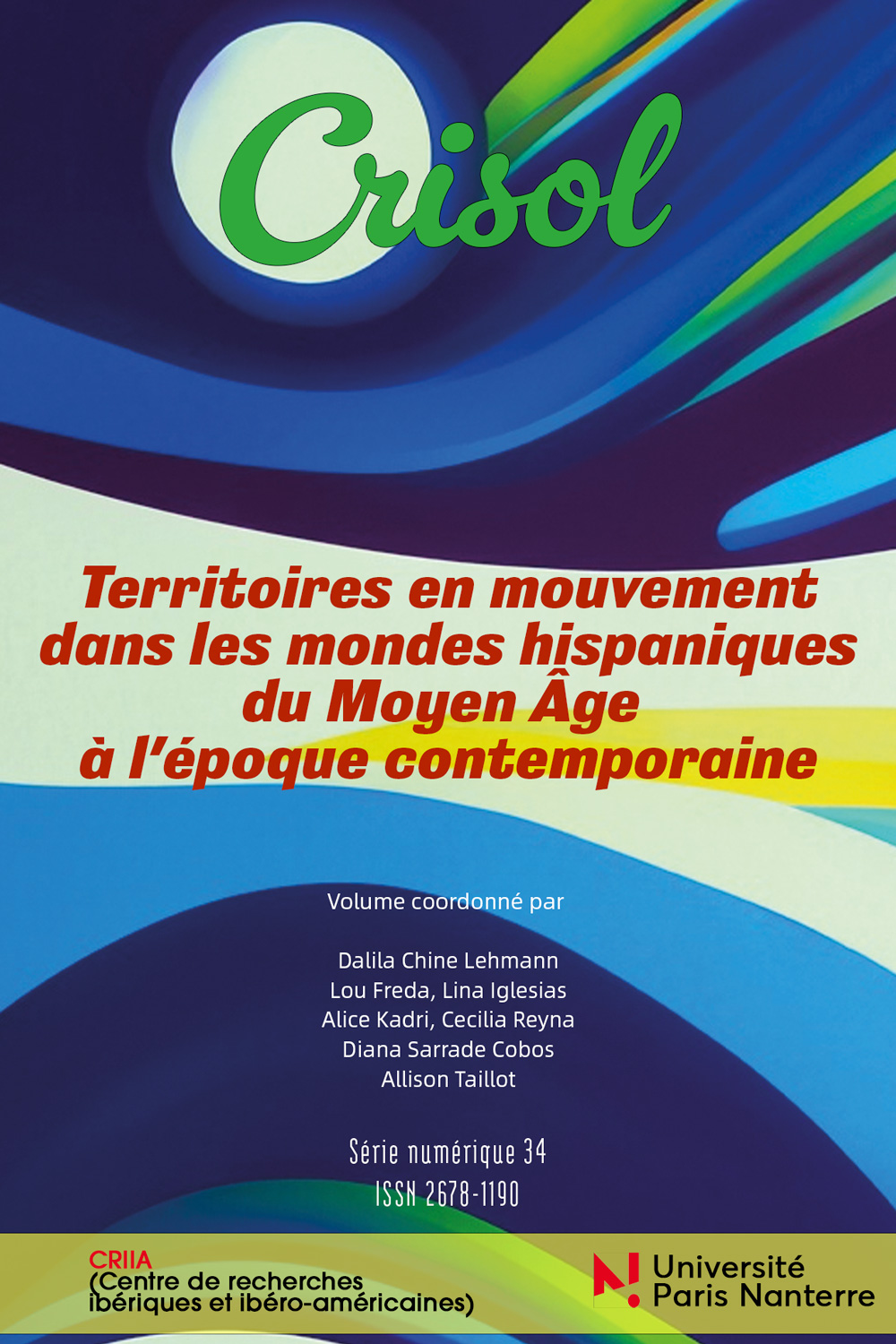
Territoires en mouvement dans les mondes hispaniques du Moyen Âge à l’époque contemporaine
No 34 (2024)Ce volume de la série numérique de la revue Crisol, intitulé « Territoires en mouvement dans les mondes hispaniques du Moyen Âge à l’époque contemporaine » marque, tout d’abord, l’aboutissement du projet quinquennal engagé au Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines (CRIIA) de l’Unité de Recherche Études Romanes de l’Université Paris Nanterre. Depuis 2018, plusieurs séminaires transversaux ont permis de mener une réflexion interdisciplinaire sur le(s) territoire(s) dans les mondes hispaniques en les appréhendant comme construction politique, économique, juridique, sociale, littéraire, culturelle et linguistique. Les échanges ont été l’occasion d’interroger, dans une perspective comparatiste, les différentes facettes des constructions identitaires, qu’elles soient nationales (construction d’une communauté imaginaire collective), groupales (identification à une « appartenance ethnique », évolutions et nouvelles représentations linguistiques) ou individuelles (traces de mémoires familiales, voyages, etc.). Tout en examinant les notions de frontières, de déplacements ou de circulations, ces rencontres ont visé à comprendre aussi bien les différents processus de déterritorialisation et de reterritorialisation, les formes de « travestissement » (ambivalences, résistances et dérives) des territoires que les phénomènes d’hybridations linguistiques, et les conséquences de ces déplacements.
Ce numéro est, ensuite, le fruit d’un colloque international organisé les 11 et 12 janvier 2024 réunissant une vingtaine de spécialistes de champs divers et d’horizons variés (universités françaises, européennes et américaines). Les articles rassemblés ici poursuivent ces explorations et étudient les différentes formes de territorialité qu’elles soient géographiques (Europe ibérique/États-Unis/Amérique latine), historiques (Europe ibérique/Amérique latine) ou linguistiques (variétés diatopiques de l’espagnol, espagnol en contact avec d’autres langues ibériques et amérindiennes).
Dans la première section de ce numéro, nous nous interrogeons sur le lien entre « Territoires et (re)création de récits nationaux ». En privilégiant la transversalité entre l’Espagne et l’Amérique latine, nous regroupons trois études qui mettent au jour des processus contemporains de (re)configuration de récits territoriaux à des fins institutionnelles, mémorielles ou encore culturelles. La production de récits et de contre-récits, l’élaboration d’imaginaires collectifs et l’émergence de nouvelles identités sont autant d’opérations envisagées, au fil de la section, au prisme du territoire, un territoire dont la mise en récit constitue, en définitive et selon les auteurs ici réunis, un vecteur d’affirmation identitaire.
Dans son article « La “République catalane” : entre construction identitaire et communauté politique », Alexandra Palau revient sur les stratégies politiques et communicationnelles mises en œuvre pour consolider et légitimer la construction d’une République catalane lors du cycle indépendantiste des années 2010. Sa réflexion repose non seulement sur l’analyse diachronique des discours d’investiture des présidents de la Generalitat entre 2015 et 2022 mais également sur la mise en lumière des modalités de la mobilisation citoyenne qui a abouti à la configuration de ce que l’auteure présente comme un « espace social militant ». Elle aborde également une autre facette du projet indépendantiste : l’instauration de nouveaux espaces numériques et médiatiques participatifs tels que Diplocat, organisme de diplomatie publique créé par le gouvernement catalan en 2012 et qui s’est converti en instrument de légitimation du projet de création d’une République catalane.
À sa suite, Maud Yvinec poursuit la réflexion dans son article « “Espinar, cuna de la nación K’ana” y “Challhuahuacho, capital histórica de la nación Yanawara” : desterritorialización minera y reapropiación étnica del territorio en los Andes del sur peruano » en se penchant sur l’émergence de nouvelles identités ethniques dans le sud des Andes péruviennes. En se concentrant plus particulièrement sur l’identité « K'ana » - dans la province d'Espinar - et sur l'identité « Yanawara » - le district de Challhuahuacho -, elle met en évidence comment ces processus constituent depuis la première décennie du XXIe siècle une stratégie de réappropriation territoriale face à l’essor de l’extractivisme. Après avoir analysé les réactions apparues localement face à ce qu’elle présente comme un « phénomène de déterritorialisation minière », l’auteure s’intéresse à la configuration de nouveaux récits territoriaux et à la façon dont ces discours émergents (re)signifient l’espace. Enfin, elle s’interroge sur la portée et les limites de la reterritorialisation ethnique actuellement à l’œuvre dans le contexte extractif spécifique des Andes péruviennes.
Le troisième article de cette section, « Las noches de la “heroica Valladolid” (Yucatán) : entre reescritura de la historia y búsqueda de una nueva identidad », écrit par Diana Barreto et Manfredi Merluzzi, questionne l’instrumentalisation du territoire local à des fins mémorielles à la lumière d’une célébration mexicaine, La Heroica Ciudad de Valladolid (État du Yucatán, Mexique). Tout en insistant sur les aspects performatifs de la mise en scène de la reconstruction historique de la ville, les auteurs montrent en quoi cette célébration contribue à la reconstruction d’un imaginaire collectif d’intégration territoriale et culturelle qui se base tant sur la réinterprétation des frontières raciales et coloniales que sur l’invisibilisation de certains épisodes traumatiques de l’histoire régionale maya.
La deuxième section se penche sur les relations entre « Territoires, langue et enjeux identitaires ». En effet, les mouvements de création et recréation de récits nationaux passent évidemment par la mise en avant de certains faits et de leurs représentations. Or, dans cette entreprise, la langue s’avère une véritable cheville ouvrière car elle est elle aussi un territoire travaillé par des enjeux identitaires. C’est ainsi que le doctorant sociolinguiste, Antoine Brahy, étudie la langue comme création identitaire transnationale dans son article « Le rôle de la langue dans la construction de l’Hispanidad ». Après avoir précisé l’origine et les contours de ce concept, l’auteur analyse la façon dont les institutions normatives (telles que la RAE) et les gouvernements nationaux utilisent la continuité linguistique de l’espagnol comme « levier identitaire » pour créer une communauté transnationale et la consolider. Ce sont ensuite les représentations individuelles que se font les locuteurs hispanophones des différentes variétés de l’espagnol qui intéressent ce jeune chercheur. Il met dans ce sens en lumière les hiérarchies, l’évolution des pratiques discursives dans la migration, qui sont autant de rapports de pouvoir généralement hérités de l’époque coloniale. L’étude s’achève sur la nouvelle grande préoccupation des institutions régulatrices de la langue : la création du panhispanisme, avec toutes les difficultés que suppose d’établir une norme sans écarter ses multiples fluctuations.
Parmi ces fluctuations, Ana Ramos Sañudo examine plus particulièrement celle de l’espagnol d’Andalousie dans son article « Représentations de l'identité linguistique des locuteurs de l'espagnol en Andalousie ». Rappelant la difficulté pour le linguiste de déterminer des frontières nettes lorsqu’on évoque des variations diatopiques, elle présente néanmoins plusieurs marqueurs discursifs propres et observe les appréciations - positives ou négatives - qu’ils engendrent, tant chez des auditeurs internes (i.e. andalous) qu’externes, et notamment dans la culture populaire contemporaine. Elle remarque ensuite que les stéréotypes moqueurs, longtemps véhiculés sur la variété andalouse de l’espagnol, ont abouti à une prise de conscience par les Andalous de leur spécificité linguistique. Aussi, ceux-ci tendent-ils aujourd’hui à renverser la vapeur et à revendiquer fièrement l’emploi de cette modalité comme un marqueur de leur identité propre, comme en attestent - notamment - plusieurs opérations publicitaires et marketing récentes citées par la chercheuse.
Une troisième section est consacrée aux « Territoires, circulations et (ré)appropriations ». Il s’agit de voir comment des réseaux et des dynamiques d’échanges se mettent en place dans les espaces, comment ces derniers les structurent et, dans le même mouvement, s’en emparent.
Dans ce sens, dans leur article « Migrations, empoderamiento et citoyenneté. Le cas des employées de maison latino-américaines à Madrid », Karine Bergès et Diana Burgos-Vigna insistent sur les liens entre le statut de femmes migrantes et l’existence d’un tissu associatif dynamique leur permettant de devenir des citoyennes à part entière dans leur pays d’accueil et de faire valoir leurs droits politiques, sociaux et économiques. Dans une première partie, les auteures exposent la situation de précarité, de vulnérabilité et d’infra-valorisation des travailleuses du secteur domestique. Grâce à une étude de terrain et des témoignages, elles expliquent ensuite comment le réseau associatif constitue un espace de solidarité et de défense de et pour ces femmes. L’analyse s’intéresse finalement à la relation entre citoyenneté, empoderamiento et féminisme. Au travers d’exemples précis, les auteures démontrent comment l’engagement collectif et la présence dans l’espace public représentent des moyens efficaces pour la participation politique de ces travailleuses migrantes.
À cette étude fait suite celle de Rocío Fuentes qui traite dans son article « Puentes interculturales: Los hablantes de herencia del español » la question de l’enseignement de l’espagnol auprès des élèves qui le pratiquent comme langue maternelle (ou langue d’héritage). Après avoir identifié les particularités des locuteurs des langues d’héritage (principalement la maîtrise de l’oral, la connaissance culturelle de premier ordre, la faiblesse de l’écrit), elle décrit les politiques éducatives développées par les États-Unis à destination de ces publics spécifiques et les allers-retours qui s’établissent entre la norme enseignée à l’école et la variante dialectale pratiquée en-dehors. Soulignant que la recherche pédagogique s’est concentrée jusqu’à maintenant sur des problématiques linguistiques (gestion des variantes diatopiques et diastratiques), Rocío Fuentes insiste sur l’importance d’une pédagogie basée sur les compétences interculturelles de ces élèves, notamment en tant que médiateur culturel. Elle expose ainsi l’intérêt d’utiliser une pédagogie différenciée en classe où les hispanophones d’héritage pourraient présenter des thématiques en lien direct avec leur trajectoire et leur communauté, pour en discuter avec les apprenants anglophones : ils deviendraient de ce fait des passeurs de culture, et permettraient d’enrichir l’ensemble des élèves en faisant circuler les savoirs d’un territoire à l’autre.
À la perspective sociale du premier article et à l’approche linguistique du deuxième s’ajoute une vision historique des phénomènes propres au territoire. Jules Rodrigues, dans son travail sur « Territoire, armée et défense nationale. De la territorialisation à la projection de forces de l’armée de Terre espagnole, XXe-XXIe siècles. », explore le lien qu’entretient l’armée de terre espagnole avec le territoire national. En fondant sa réflexion sur l’analyse diachronique des réformes opérées dans le domaine des forces armées entre 1893 et 2003, il met au jour les enjeux et les défis qui ont jalonné l’histoire de l’implantation territoriale de l’armée de terre en Espagne et revient sur les grandes étapes qui ont marqué l’évolution de la structure et des fonctions depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à l’époque actuelle. Sa contribution met en évidence la nécessité de penser les relations entre armée et territoire dans toute leur historicité pour saisir pleinement les dynamiques qui ont mené, en Espagne, d’une conception très territorialisée de la défense nationale à la déterritorialisation des forces armées.
Si ces derniers articles font référence à des études qui s’inscrivent dans la période contemporaine, le texte de Valentina Emiliani invite à aborder la question dans un temps plus lointain, puisqu’il propose une réflexion sur : « El barrio del nuncio. La relación de la nunciatura apostólica con la villa de Madrid en el siglo XVII ». Elle se concentre sur le territoire de la nonciature de la ville de Madrid et cherche à analyser les réseaux culturel, légal et économique qui se tissent dans l’espace territorial qui lui est attribué dans la capitale espagnole et la périphérie de celui-ci. Pour ce faire, elle accorde une place importante à la figure de l’ambassadeur, ainsi qu’à la législation particulière à ce quartier qui confère à ses résidents des privilèges et, pour le diplomate italien, l’immunité diplomatique. Valentina Emiliani poursuit par l’étude d’une série de cas de conflits (en particulier économiques et juridiques) que peut supposer la présence du représentant papal à Madrid. Après avoir exposé les différents types de résidents et acteurs du quartier de la nonciature à Madrid, l’auteure se penche non seulement sur les cas d’échanges culturels, les spécificités économiques et juridiques (concernant les réfugiés ou les criminels par exemple) mais aussi sur les prérogatives (« dispensa » et « bottigliera ») qui caractérisent cet espace particulier.
La dernière section du volume, intitulée « Territoires poétiques, itinéraires et résistances », examine la création littéraire afin de réfléchir aux rapports dynamiques qui existent entre la littérature et le territoire. Les articles qui la composent questionnent les liens entre représentation, langue et identités, en plaçant l'errance et l'étrangéité au cœur de leurs analyses. Que ce soit parce qu’ils luttent contre la langue, parce qu’ils démantèlent ses frontières pour permettre l'avènement d'une nouvelle manière d'habiter le territoire, ou parce qu’ils s'affranchissent des attentes de la couleur locale, voire de l'authenticité du regard sur son propre territoire en tant que critère de légitimité, la poésie et le roman sont définis dans ces études comme des alliés indispensables pour résister à l'enfermement et à la sclérose des identités et de l’écriture.
Dans son article, « Le territoire au prisme de la disparition. César Vallejo ou l’invention d’une langue transfrontalière », Jordana Maisian parcourt l'itinéraire biographique de César Vallejo en révélant comment le déplacement vers d'autres espaces entraîne une réactivation de son territoire et de sa langue, créant des “effets de territoire” qui suscitent une “langue transfrontalière” au cœur de sa poésie. Quant à Leonardo Valencia, dans « Aquí tampoco, allá también. Mapa roto de la novela latinoamericana », il se propose de sonder la portée et les possibilités de la déterritorialisation du roman latinoaméricain contemporain. Pour cela, ses réflexions s'appuient sur l'analyse de l’œuvre de deux écrivains argentins. Quelques romans de César Aira permettent de concevoir une littérature - représentée par la métaphore du castrat - qui ne cherche pas à fonder des nations à travers sa descendance, mais qui se veut une performance produisant des sens qui ne la précèdent pas. La référence à l’essai Exotismo approfondit cette réflexion tout en établissant un lien avec l'œuvre de Jorge Luis Borges, qu'Aira et Valencia revisitent tous deux. En sillonnant les essais de Discusión, notamment « El escritor argentino y la tradición », l'auteur de cet article revendique la liberté thématique totale rendue possible par la « mort du roman », ainsi que la pudeur, condition indispensable à l’imagination.
En conclusion, les réflexions publiées dans ce volume viennent clore une étape de réflexion collective et confirment l’intérêt de la transdisciplinarité pour penser les “Territoires en mouvement dans les mondes hispaniques du Moyen Âge à l’époque contemporaine”. Puissent-elles encourager des chercheurs et chercheuses à poursuivre dans cette voie et à en explorer d’autres dimensions.
Dalila Chine Lehmann, Lou Freda, Lina Iglesias, Alice Kadri, Cecilia Reyna, Diana Sarrade Cobos, Allison Taillot.
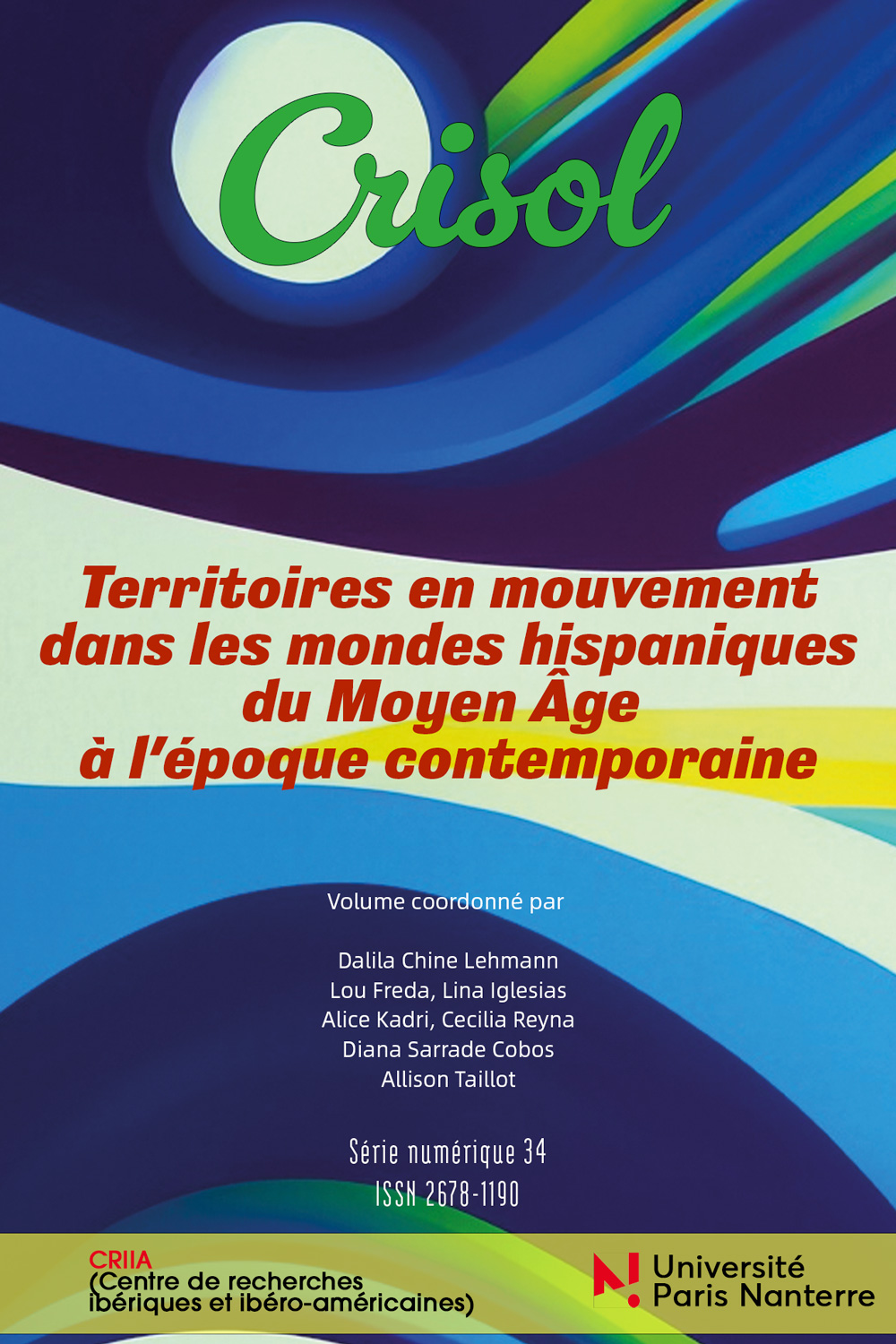
SOMMAIRE
1. Territoires et (re)création de récits nationaux
Alexandra Palau (Université de Bourgogne, Centre Interlangues - TIL) : “ La “République catalane” : entre construction identitaire et communauté politique”
Maud Yvinec (Université Paris 1- Panthéon Sorbonne et membre de l’UMR Mondes Américains) : ““Espinar, cuna de la nación K’ana” y “Challhuahuacho, capital histórica de la nación Yanawara” : desterritorialización minera y reapropiación étnica del territorio en los Andes del sur peruano”
Diana Barreto (UNAM, México) - Manfredi Merluzzi (Università di Roma Tre, Italia) : “Las noches de la “heroica Valladolid”(Yucatán): entre reescritura de la historia y búsqueda de una nueva identidad”
2. Territoires, langue et enjeux identitaires
Antoine Brahy (Université de Lorraine, ATILF/CNRS) : “ Le rôle de la langue dans la construction de l’Hispanidad”
Ana Ramos Sañudo (Université Paris Nanterre, CRIIA) : “Représentations de l'identité linguistique des locuteurs de l'espagnol en Andalousie”
3. Territoires, circulations et (ré)appropriations
Karine Bergès (Université Paris Est - Créteil, Imager) et Diana Burgos-Vigna (Université Paris Nanterre, CRIIA-GRECUN) : “Migrations, empoderamiento et citoyenneté. Le cas des employées de maison latino-américaines à Madrid”
Rocío Fuentes (Central Connecticut State University) : “Los hablantes de herencia como puentes interculturales: consideraciones para el desarrollo de un marco pedagógico intercultural.”
Valentina Emiliani (Università degli studi Roma tre, Italia – Universidad de Cantabria, España) : “El barrio del nuncio. La relación de la nunciatura apostólica con la villa de Madrid en el siglo XVII”
Jules Rodrigues Rodrigues (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Laboratoire 3L.AM - Langues, Littératures, Linguistique des Universités d’Angers et du Mans) : “Territoire, armée et défense nationale. De la territorialisation à la projection de forces de l’armée de Terre espagnole, XXe-XXIe siècles.”
4. Territoires poétiques, itinéraires et résistances
Jordana Maisian (ENSA Paris-Malaquais, Laboratoire Architecture, Culture, Sociétés/UMR AUSser CNRS 3329) : “Le territoire au prisme de la disparition. César Vallejo et l’invention d’une langue transfrontalière”
Leonardo Valencia (Universidad Andina Simón Bolívar, Équateur) : “Aquí tampoco, allá también. Mapa roto del paisaje histórico en la novela latinoamericana”
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
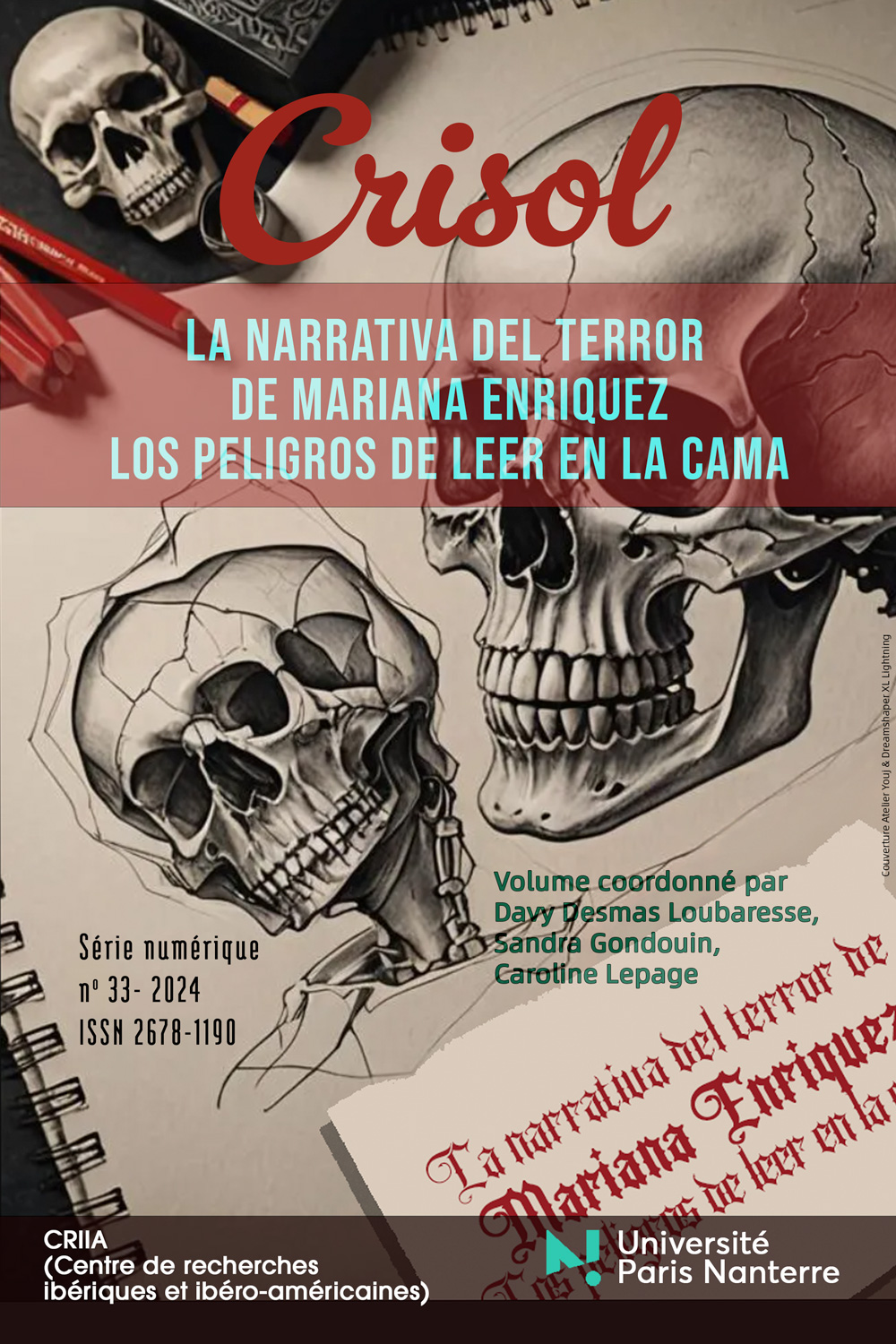
La narrativa del terror de Mariana Enriquez – Los peligros de leer en la cama
No 33 (2024)Ce 33e volume de Crisol est entièrement consacré à l’auteure argentine Mariana Enriquez. À l’occasion de son inscription au programme de l’Agrégation externe d’espagnol pour les deux prochaines années universitaires (2025-2026), avec Los peligros de fumar en la cama (2009) et Las cosas que perdimos en el fuego (2016), nous avons en effet décidé de lui témoigner notre admiration en invitant une large palette de ses lecteurs·rices à parler de son œuvre. Elles et ils ont eu carte blanche pour écrire sur le thème et sur le ton de leur choix.
Voici donc, nous l’espérons, de quoi nourrir la réflexion des étudiants, de nos collègues enseignants-chercheurs et, plus largement, des amatrices et amateurs de la «Reina del terror».
La narrativa del terror de Mariana Enriquez – Los peligros de leer en la cama est un numéro ouvert; nous y intégrerons les textes à mesure que nous les recevrons.
Davy Desmas Loubaresse, Sandra Gondouin, Caroline Lepage
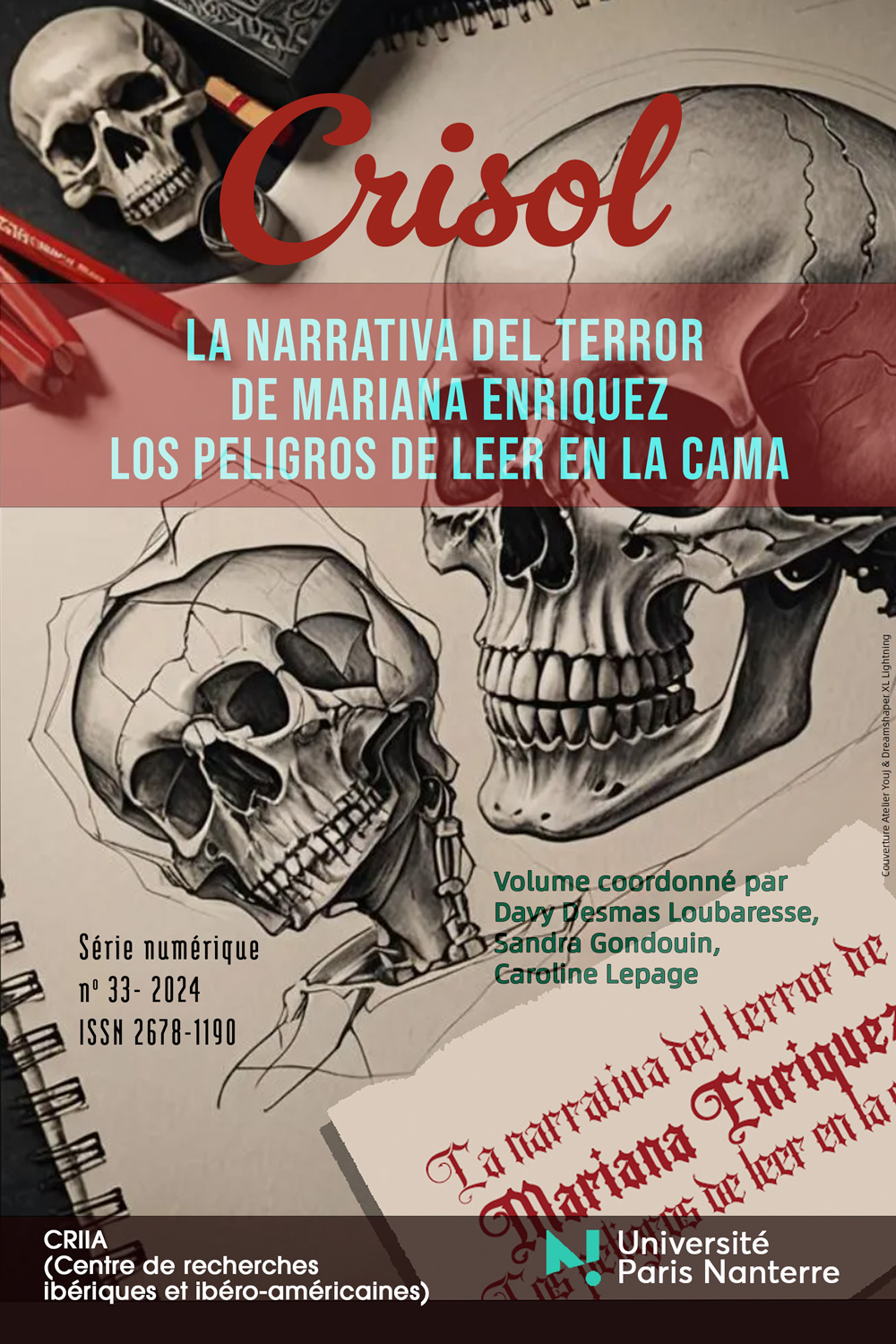
SOMMAIRE
Cecilia Katunaric (Docteure en Études Hispaniques et Études de Genre), «Parole d’auteur – Entretien avec Mariana Enriquez»
Elena Geneau, Julia de Ípola Université, Marisol Martini, Cecilia Reyna, Sheila Siguero Université (Paris Nanterre/ CRIIA), «La humareda de la impunidad – Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enriquez (2016)»
Agustina Bazterrica, «“Chicos que vuelven” de Mariana Enriquez: Onda expansiva»
José Amícola (Universidad Nacional de la Plata -Argentina), «El aljibe como sitio de auto-reconocimiento (gótico)»
Caroline Lepage et Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre / CRIIA), «Lectures / Lecturas de Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez», 1 («El desentierro de la angelita» – «La virgen de la tosquera»)
Caroline Lepage, Julia de Ípola et Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre / CRIIA), Sophie Marty (Université de Bourgogne), «Lectures / Lecturas de Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez», 2 («El carrito»)
Caroline Lepage, Julia De Ípola et Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre – CRIIA), «Lectures / Lecturas de Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez» / 3 («El aljibe»)
Salomé Dahan (Université de Strasbourg), «L’écriture des marges dans quelques contes de Mariana Enriquez»
Mónica Velásquez Guzmán (Universidad Mayor de San Andrés), «Daño transferible e im-potencias masculinas en “Diferentes colores hechos de lágrimas” de Mariana Enriquez»
Sandra Gondouin (Université de Rouen Normandie – ERIAC / CRIIA), «Lire Mariana Enriquez à la lumière des symbolistes français – des nouvelles sur le fil de la beauté corrompue»
Ixchel Marcos (Universitat de València), «Liminalidad en lo insólito. La mujer migrante en la narrativa corta de Mariana Enríquez y M.ª Fernanda Ampuero»
Lorena Amaro Castro (Pontificia Universidad Católica de Chile), «“¿Dónde estará mi imagen?” Muertos y no muertos en dos cuentos de Mariana Enriquez»
María A. Semilla Durán (Université Lyon 2), «Huellas, marcas, restos. La descomposición política y social en la narrativa de Mariana Enríquez»
Vanessa Rodríguez De La Vega (Missouri State University), «‘Cuando los muertos hablan’, recuperación de la memoria en Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enriquez»
Selma Rodal Linares (Universidad de las Artes de Yucatán), «Un fantasma indócil para gente odiosa: los fantasmas como dispositivo crítico de la economía afectiva del odio en Mariana Enriquez»
Roberto Ibáñez Ricóuz (Cornell University), «Riachuelo, río menor: “Bajo el agua negra”, de Mariana Enriquez»
Julien Roger (Sorbonne Université – Crimic /UR 2561), «“Tela de araña”: du texte au métatexte»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
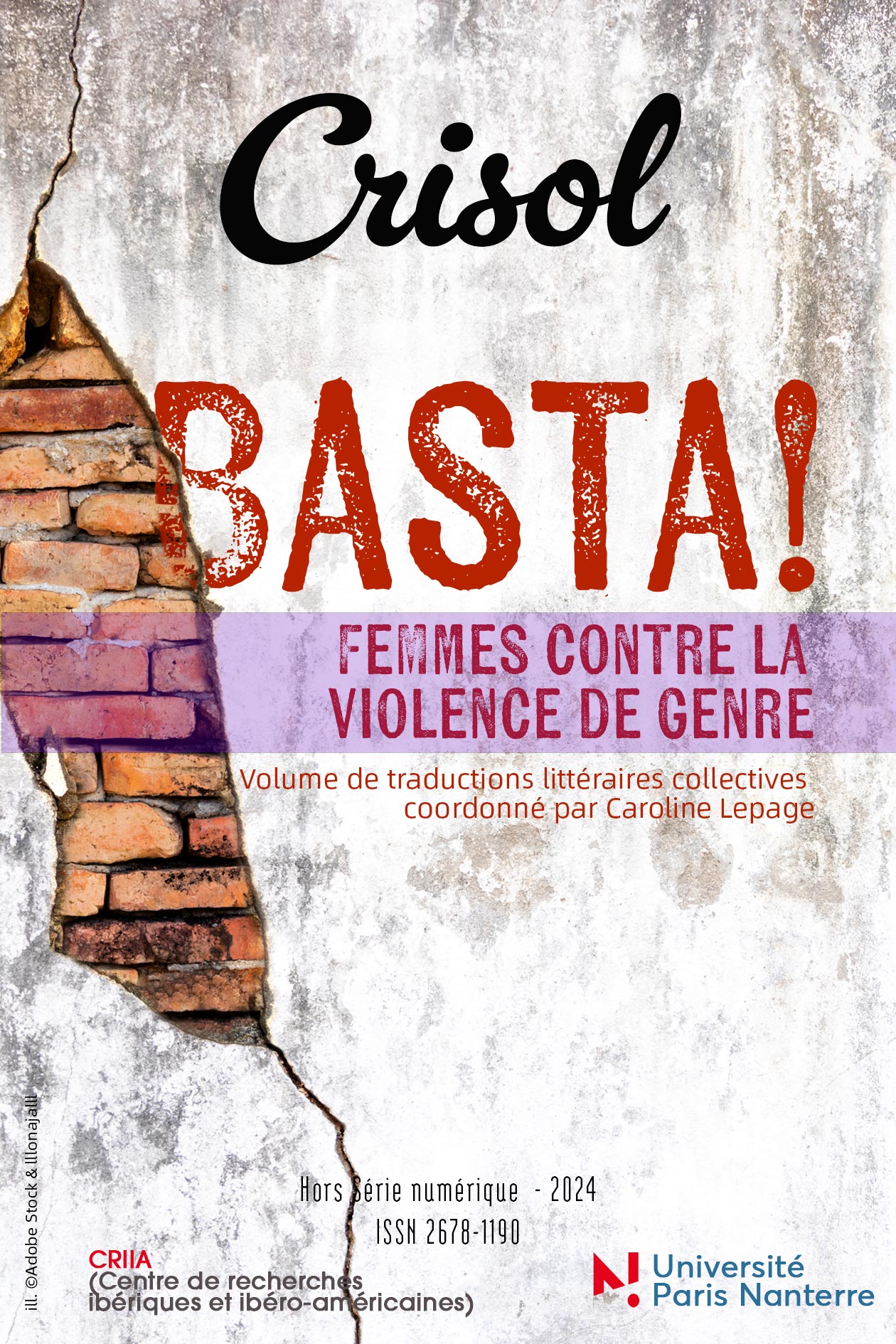
Basta! Femmes contre la violence de genre
No HS (2024)C'est avec joie et émotion que je rassemble aujoud'hui les traductions de plusieurs des anthologies ¡Basta! Mujeres contra la violencia de género –les versions chilienne (2011), péruvienne (2012), argentine (2013), bolivienne (2014) et colombienne (2015)– sous l'égide de la revue Crisol du Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines de l'Université Paris Nanterre.
Ce projet de traduction collective est né il y a maintenant 9 ans, avec une poignée de collègues et, surtout, avec mes étudiant·e·s de l'époque, de l'Université de Poitiers et de l'Université Bordeaux Montaigne, où j'assurais encore des cours de traduction dans le cadre du «Master Professionnel Métiers de la traduction», puis s'est poursuivi avec mes étudiant·e·s de Nanterre, des Master recherche Études Romanes et du Master Parcours International. Ce sont des heures intenses de discussions et de débats passées autour de ces textes puissants et importants de femmes témoins, de femmes créatrices… vis-à-vis desquelles nous avons compris que nous avions une grande responsabilité en mettant leurs mots, leurs douleurs silencieuses et, souvent, leurs cris de révolte dans notre langue. Il ne s'agissait ni de les forcer, ni de les édulcorer. Il y a dans notre démarche bien plus qu'un «simple» travail; il faut y voir aussi notre engagement… notre volonté de contribuer à cette immense et incroyable projet qu'est ¡Basta!, lancé au Chili par l'infatigable et admirable Pía Barros pour Ediciones Asterión, poursuivi au Pérou par Cucha del Águila et Christiane Félip Vidal, en Argentine par Amor Hernández, Fabián Vique, Leandro Hidalgo, Miriam Di Gerónimo et Sandra Bianchi, en Bolivie par Gaby Vallejo C., en Colombie par Yanneth Peña, Nathalie Pabón Ayala, Nally Mosquera, Carlos Medina et Amor Hernández.
Je les remercie toutes et tous pour leur travail et leur générosité au moment de nous autoriser à traduire ces textes dans un projet de traduction qui est d'ailleurs loin d'être bouclé puisque nous avons encore sur notre table de travail les versions mexicaine, vénézuélienne et panaméenne de ¡Basta! C'est en cours… et nous les ajouterons progressivement à ce volume Hors série de Crisol.
Je tiens ici également à remercier Virginie Cazeaux. Engagée depuis un an dans un projet de thèse sur ¡Basta!, elle m'a en effet donné l'impulsion et l'énergie qu'il me manquait pour reprendre ces traductions inachévées et pour sortir d'un cadre de publication « privé » celles réalisées (jusque-là, ces traductions avaient été mises en ligne sur la plateforme Calaméo, sous le label de Lectures d'ailleurs), au bénéfice de ce cadre universitaire qui, nous l'espérons l'une et l'autre, lui assurera la diffusion qu'il mérite. Et c'est aussi avec elle que nous avons lancé l'idée folle de lecture de l'intégralité des textes en version originale de ¡Basta! dans le cadre de capsules mises en ligne sur la chaîne YouTube du CRIIA, dans une playlist dédiée: Lisons Basta! Mujeres contra la violencia de género. Nous en sommes à bientôt 150 textes lus par 150 lectrices et lecteurs différent·e·s. Merci à elles et eux d'avoir accepté de nous prêter leur voix pour porter la voix de ces femmes…
Merci, enfin, à mes collègues (Marie-Ella Briand, Davy Desmas, Elvire Díaz, Erich Fisbach, Sandra Gondouin, Marie-José Hanaï, Hélène Roy-Labbé, Emmanuelle Sinardet, Chloé Tessier, Eva Touboul, Graciela Villanueva) et aux dizaines d'étudiant·e·s qui ont contribué à la réalisation de ce projet de traduction.
Bonne lecture!
Caroline Lepage
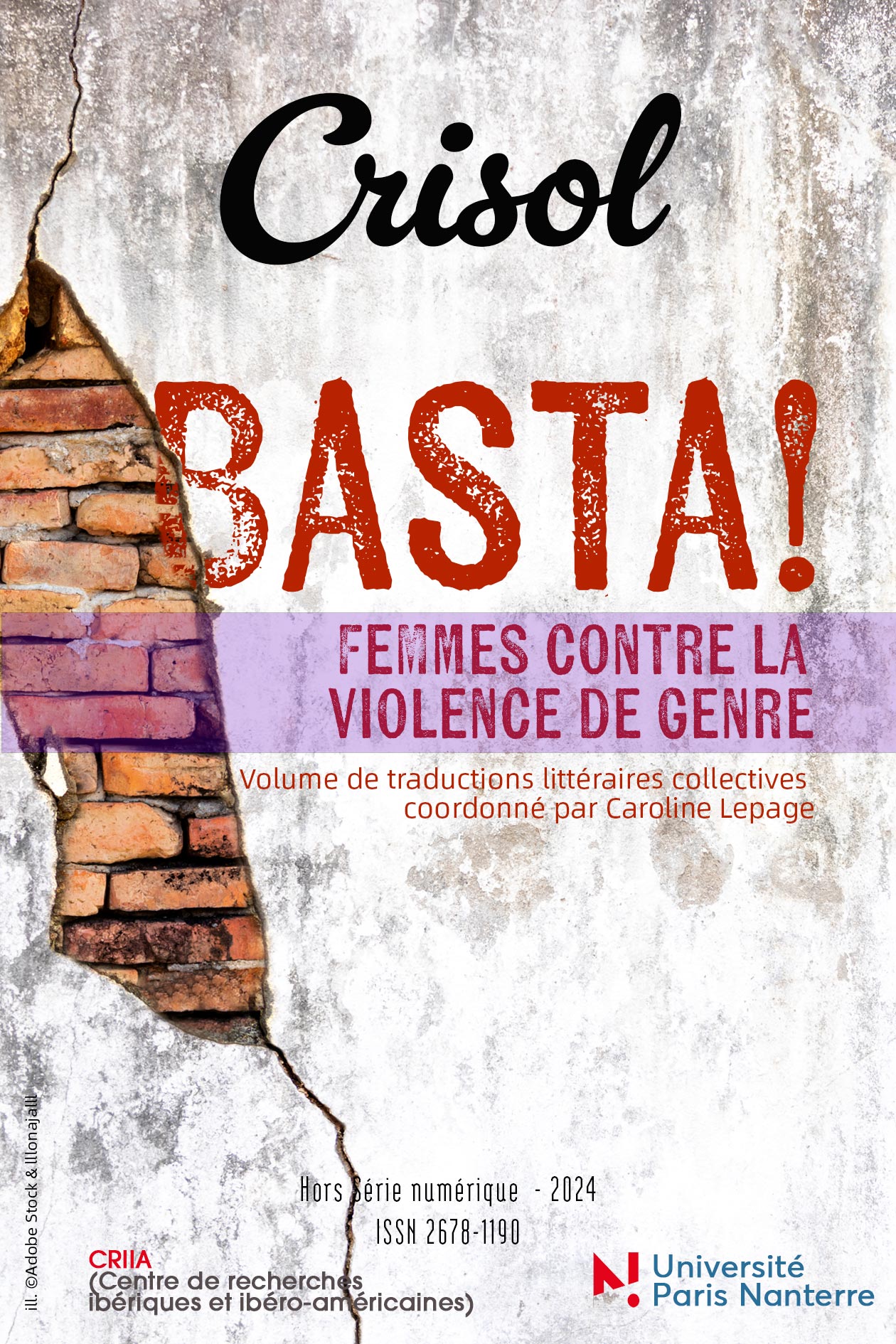
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
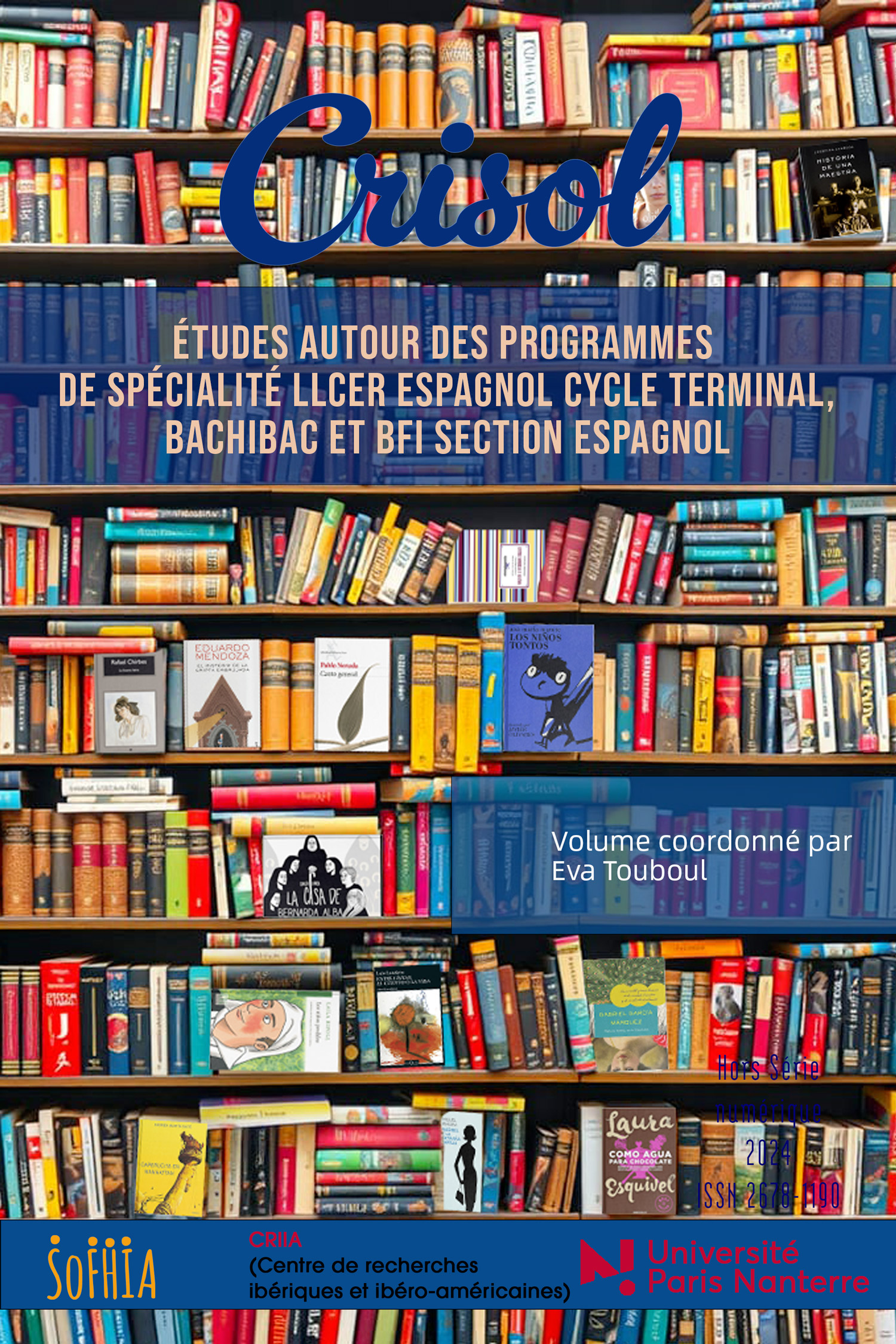
La littérature en espagnol au lycée. Programmes de spécialité LLCER Espagnol cycle Terminal, Bachibac et BFI section espagnol
No HS (2024)Depuis la mise en place de la réforme du Lycée général, en 2019, et dans la perspective du continuum bac -3/bac +3, il existe en Cycle terminal une spécialité Langue, Littérature et Civilisation Étrangère et Régionale Espagnol, qui comprend, en Première, deux thématiques, et trois en Terminale.
À ces thématiques spécifiques est rattaché un programme limitatif différent pour chacune des deux années, composé de 4 œuvres littéraires et un film. Ces programmes sont renouvelés tous les deux ans, en alternance.
Par ailleurs, l’enseignement de littérature des sections binationales de Baccalauréat franco-espagnol, dites Bachibac, s’inscrit dans un thème d’étude renouvelé tous les deux ans, reposant là encore sur deux œuvres intégrales.
Enfin, l’enseignement d’approfondissement culturel et linguistique en espagnol pour le Baccalauréat Français International (BFI) prévoit, pour la Terminale, un programme limitatif de trois œuvres de la littérature espagnole et hispano-américaine du XXe et du XXIe siècles.
Ce sont donc 13 œuvres intégrales et 2 films que les enseignants d’espagnol du secondaire en charge de classes d’approfondissement culturel et linguistique de BFI, de Bachibac ou de la spécialité LLCER Espagnol sont amenés à préparer tous les ans.
Consciente de l’importance de ces programmes, la SoFHIA, avec l’appui du CRIIA, se propose d’organiser à chaque début d’année scolaire une journée d’études sur les œuvres au programme, mettant ainsi à profit les compétences de ses membres spécialistes de littératures espagnole et hispano-américaine, ainsi que du cinéma hispanophone des deux continents, qui sont donc à même de proposer aux enseignants de lycée des outils d’analyse et des approches originales sur les différentes œuvres au programme, afin de les accompagner dans la préparation de leurs cours.
Ce volume hors-série de Crisol offre les articles tirés des communications présentées lors de cette journée d’études, et sera donc amené à être enrichi de nouvelles contributions tous les ans, au fil de l’évolution des programmes. Nous espérons sincèrement que les collègues en charge de ces enseignements, ainsi que tous ceux désireux d'enrichir leur culture hispanophone, prendront connaissance avec intérêt de ces contributions.
Eva Touboul
SOMMAIRE
Programmes de 1ère LLCER Espagnol
Caroline Mena-Bouhacein (Université Caen-Normandie), «Enseigner la littérature étrangère en langue étrangère: un regard sur Caperucita en Manhattan (1990) de Carmen Martín Gaite»
Eugénie Romon (HTCI), «Échanges et transmission dans Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite»
Elvire Díaz, «Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura (1959), entre "Altérité et convivencia"»
Yolanda Millán, «Recorrido por El Olivo de Icíar Bollaín: claves para su estudio en clase de LLCER»
Lina Iglesias, «Concha Méndez: un itinéraire poétique aux prises avec son temps»
Programmes de Terminale LLCER Espagnol
Marta Espinosa Berrocal (CREC), «Lecturas de La buena letra, de Rafael Chirbes»
David Barreiro Jiménez, «La representación cultural de un imaginario familiar y el entramado narrativo de Como agua para chocolate (1989), de Laura Esquivel»
Zoraida Carandell, «La casa de Bernarda Alba, une prison de langage»
Laurence Garino-Abel (UGA), «Cuando la investigación policiaca se hace posmoderna: el caso de El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza»
Caroline Lepage, «Entre deux rives marquéziennes : La increíble y triste historia de la cándida Érendira y de su abuela desalmada (1972)»
José Luis Sánchez Noriega, «Filmar la ilógica de la dominación: También la lluvia»
José Luis Sánchez Noriega, «Icíar Bollaín - Introducción»
Programmes de Bachibac
Elvire Gomez-Vidal, «El cuento y la vida: Entre líneas: el cuento o la vida de Luis Landero»
Marie Gourgues, «Memoria friccional: resistencia y resiliencia femenina en Historia de una maestra de Josefina Aldecoa»
Programmes de BFI Espagnol
Liliana Riaboff, «Crónica de una muerte anunciada, el drama de un autor silenciado»
Caroline Mena-Bouhacein, «Rhétorique de l'enfance dans Los niños tontos d'Ana María Matute»
Marina Ruiz Cano, «Realismo y simbolismo en Historia de una escalera»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
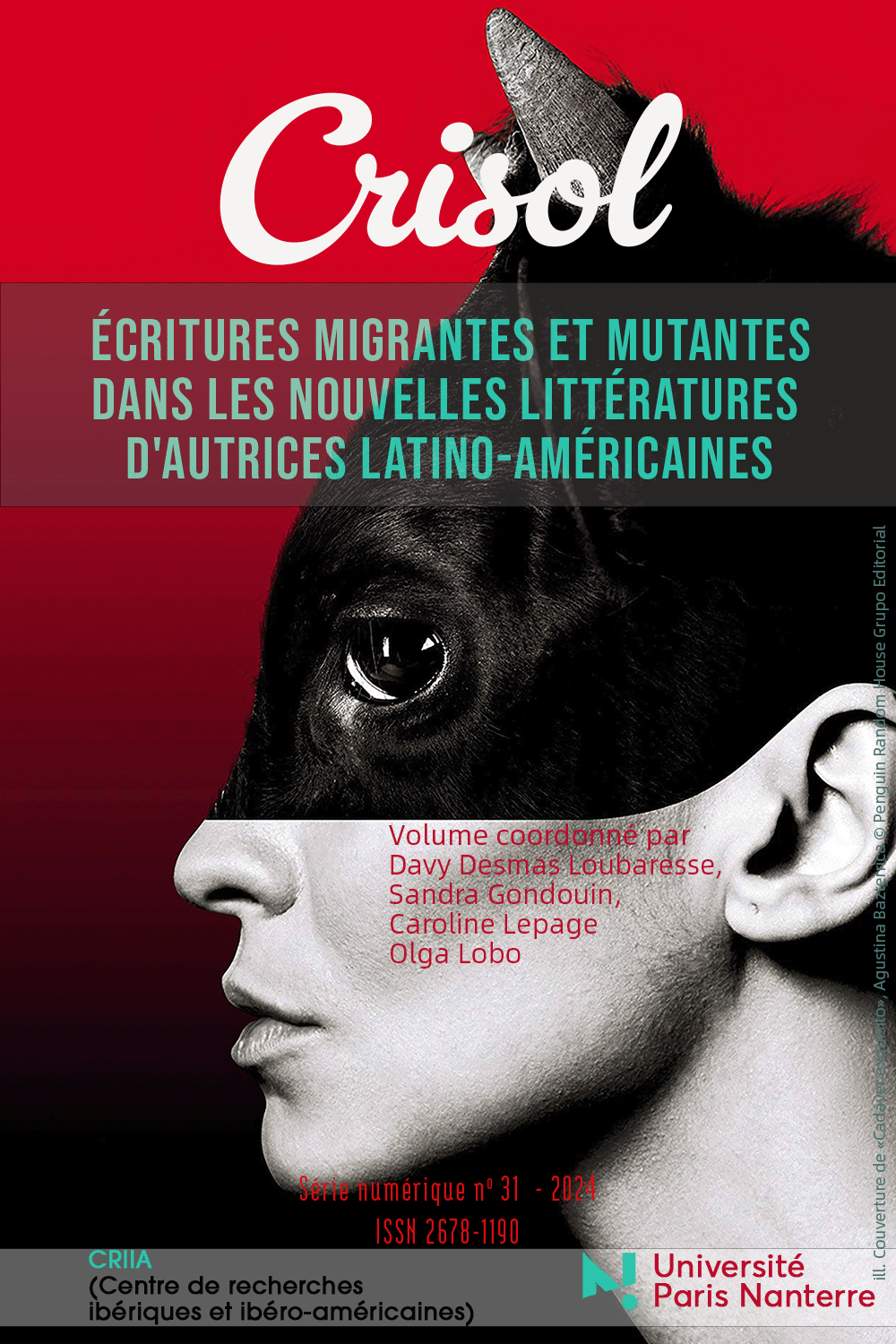
Ecritures migrantes et mutantes dans les nouvelles littératures d'autrices latino-américaines
No 31 (2024)Ce volume numéro 31 de Crisol, intitulé Écritures migrantes et mutantes dans les nouvelles littératures d'autrices latino-américaines, rassemble les communications entendues lors des deux jours du colloque qui s’est tenu à l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi les 21 et 22 septembre 2023, co-organisé par Davy Desmas Loubaresse (Institut National Universitaire Champollion) pour le CEIIBA, par Sandra Gondouin (Université de Rouen Normandie) pour l’ERIAC, par Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), pour le CRIIA, et par Olga Lobo (Université Paul Valéry – Montpellier 3) pour le CRESO.
Tout est parti de l’envie de travailler ensemble de quatre enseignants-chercheurs dont les centres d’intérêts communs les rapprochent en effet étroitement autour des nombreux et complexes questionnements relevant de l’ultra-contemporanéité dans les discours et dans les formes qu’elle bâtit et affiche au sein de cette zone si particulière de la littérature. Inviter une quinzaine d’universitaires, doctorant·es, Maîtres·sses de Conférences et Professeur·es des Universités, à réfléchir à la façon dont les femmes prennent une place et s’imposent aujourd’hui au premier plan dans le panorama littéraire en Amérique latine était en somme un point d’entrée logique vers ce territoire à peine exploré par la critique des littératures d’aujourd’hui et, à peine envisagé seulement, de celles qui pourraient s’écrire demain. Un point d’entrée que nous envisageons comme un départ pour, depuis la structuration d’un réseau réunissant nos quatre universités et que nous avons baptisé NUCLEON2010+, rester attentif·ves aux devenirs des littératures hispano-américaines et, justement en les suivant à la trace, essayer de poser les jalons d’études critiques sur la base desquelles l’histoire littéraire pourrait encore s’écrire depuis l’université… Audrey Louyer, de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, nous rejoindra dans cette nouvelle aventure collective.
Pour l’heure, ce numéro 31 de Crisol rassemble 15 textes, en sus de la belle introduction que nous a généreusement proposée Michèle Soriano ; mais il restera ouvert à d’éventuelles nouvelles contributions. À bon·ne entendeur·se !
(Nous remercions les éditions Alfaguara de nous avoir autorisé·es à utiliser gracieusement l’illustration de couverture créée pour le roman Cadáver exquisito de A. Bazterrica).
Davy Desmas Loubaresse, Sandra Gondouin, Caroline Lepage et Olga Lobo
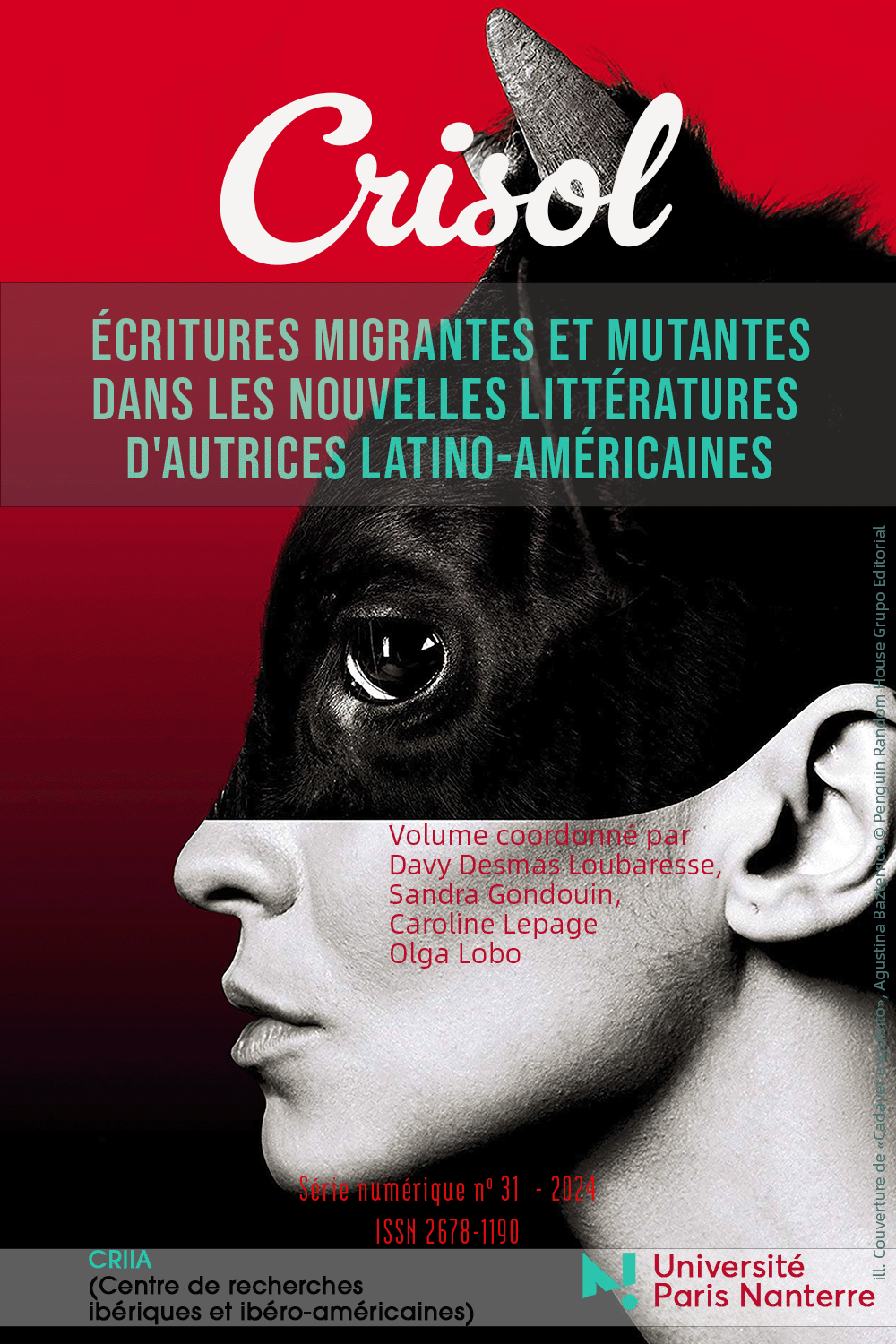
SOMMAIRE
Michèle Soriano (CEIIBA, Université Toulouse – Jean Jaurès), «Territoires littéraires et diffraction du champ culturel transnational»
Sophie Marty (Université d’Orléans), «¿La Academia, mundillo sadomasoquista? Una lectura de Body Time, de Gabriela Alemán (2003)»
Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «La patrie travestie: réécritures subversives du XIXe siècle argentin chez Gabriela Cabezón Cámara, Ana Ojeda et Camila Sosa Villada»
Sandra Gondouin Université de Rouen Normandie - ERIAC, «Las primas d’Aurora Venturini, un iconotexte mutant?»
Jose González Palomares (Université de Toulouse Jean Jaurès, CEIIBA), «La fragmentación de lo (sobre) natural en Distancia de rescate de Samanta Schweblin»
Nadège Guilhem Bouhaben CEIIBA, Université Toulouse Jean-Jaurès, «Écrire l’épuisement du monde. Mugre Rosa de Fernanda Trías»
Véronique Pitois Pallares (Université Paul-Valéry Montpellier 3 – EA740 Iriec), «Temporada de huracanes de Fernanda Melchor: en el ojo del ciclón… y en el centro, el margen»
Erich Fisbach (3L.AM – EA 4335 - Université d’Angers), «Fragmentación y distopía en la narrativa de Giovanna Rivero»
Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre/ CRIIA), «“Su rastro de caracol”: el recorrido de la mirada en El nervio óptico (2014) de María Gainza»
Olga Lobo (Université Paul Valéry, Montpellier 3. CRESO), «La novela Frankenstein de Nona Fernández. A propósito de Avenida 10 de julio (2021)»
Catherine Pélage (Université d’Orléans, Laboratoire REMELICE EA 4709), «Nombres y animales de Rita Indiana (República Dominicana): poética líquida y descubrimiento de nuevos mundos»
Julia de Ípola (Université Paris Nanterre – CRIIA), «Monstruos y mutación en Pelea de gallos (2018) y Sacrificios humanos (2021) de María Fernanda Ampuero»
Marie-José Hanaï (Université de Rouen Normandie, ERIAC (UR 4705), F-76130, Mont-Saint-Aignan, France), «El problema de los tres cuerpos de Aniela Rodríguez: voces dolientes de México y de la intimidad humana»
Marie-Agnès Palaisi (CEIIBA, Université Toulouse 2-Jean Jaurès), «Enjeux stratégiques de la cyber-littérature pour les minorités de genre Le cas de Minificcion para niñxs LGTBI de Sayak Valencia»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre/CRIIA), «Migrations, mutations, transgressions et révolutions dans Jauría de Maielis González»
Thérèse Courau (CEIIBA, Université Toulouse Jean Jaurès), «Écritures en transition: sexo-dissidence et débordement des genres dans la littérature argentine contemporaine»
Davy Desmas Loubaresse (Institut National Universitaire Champollion), «Actualisation féministe de la forme fragmentaire dans Tomar tu mano de Claudia Hernández»
Raúl Caplán (ILCEA4 - Université Grenoble Alpes), «La ciudad invencible de Fernanda Trías: una reescritura nómada y sensible de Buenos Aires»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
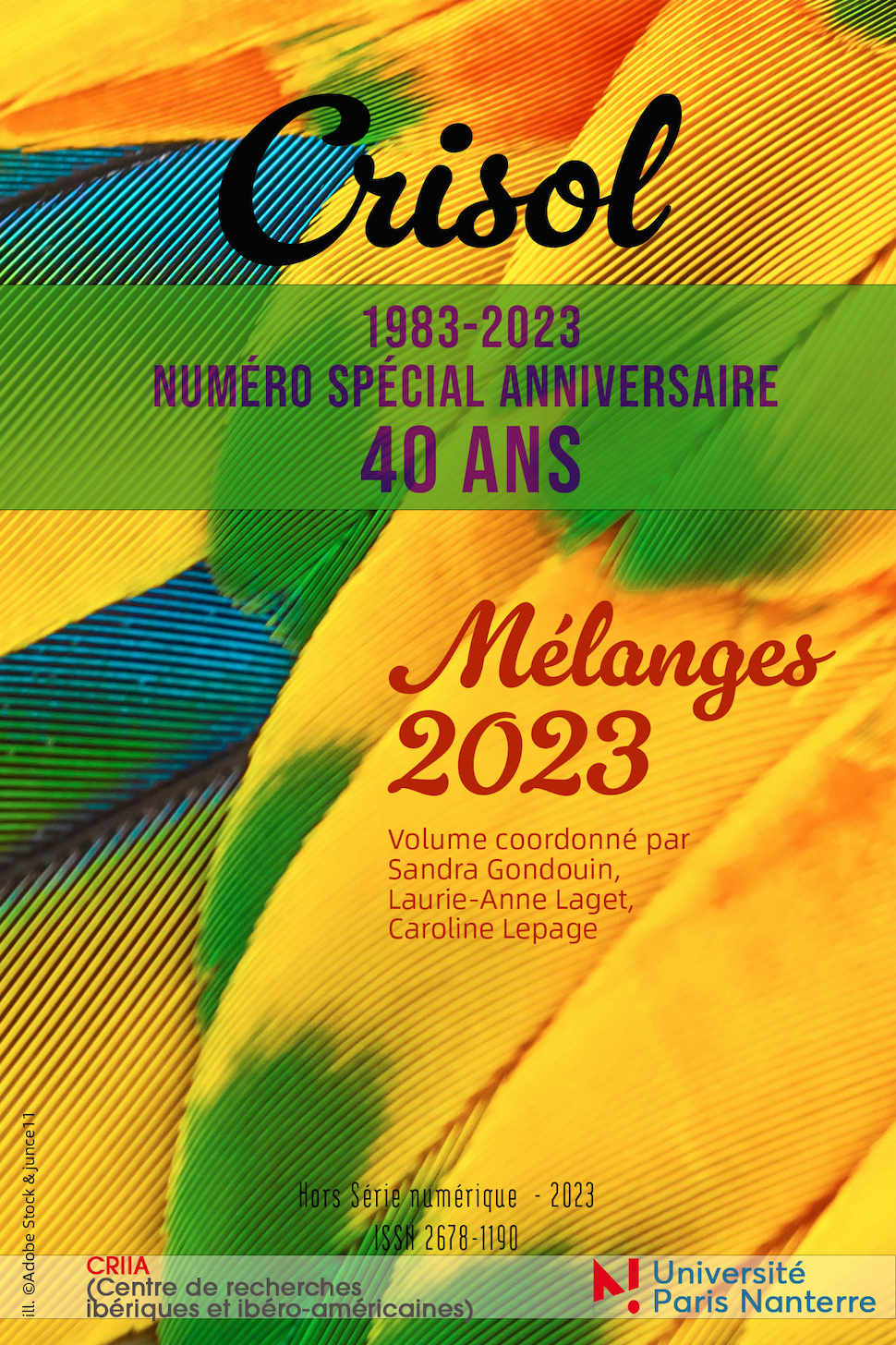
Mélange 2023
No HS (2023)C'est avec une immense joie que le CRIIA (Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines) célèbre aujourd'hui les 40 ans de Crisol.
C'est en effet en 1983 que le Professeur Bernard Sesé lance notre revue; nous lui devons 19 numéros, publiés jusqu'en 1994. Nous les avons numérisés et vous pouvez les trouver en cliquant ici.
En 1997, le Professeur Thomas Gómez assure le relais et crée la «Nouvelle série», qui compte 20 numéros. À quoi il faut ajouter celui, le 21e, à travers lequel ses collègues et ami·e·s lui ont rendu hommage. Ces volumes ont également été numérisés et vous les trouverez en cliquant ici.
À partir de 2018, la Professeur Caroline Lepage prend à son tour la direction de Crisol, pour, notamment, en assurer le passage vers le format numérique. À ce jour, 30 numéros et 4 Hors série ont ainsi été mis en ligne (pour un total de 495 articles), confiés à des spécialistes, enseignant·e·s-chercheur·se·s et doctorant·e·s, de l'Université Paris Nanterre et, bien plus largement, à des collègues d'autres universités, françaises et étrangères. Les champs couverts sont on ne peut plus vastes et divers puisqu'après avoir commencé avec un numéro consacré à la didactique des langues, nous avons ensuite abordé des sujets relevant de questionnements relatifs aux domaines de la civilisation, de la littérature, des arts visuels et de la linguistique… cela sans frontières ni géographiques ni temporelles puisqu'on lira des articles portant à la fois sur l'Espagne et l'Amérique latine, pour une période allant du Moyen-Âge au XXIe siècle. Il y a en somme là de quoi, nous l'espérons, non seulement alimenter la réflexion individuelle et collective, mais aussi contribuer aux débats citoyens de maintenant.
40 ans, ça se fête !
Pour cette occasion, nous avons donc mis sur pied ce numéro Hors série, coordonné par Caroline Lepage, Sandra Gondouin et Laurie-Anne Laget. Il paraît ce jour avec une dizaine de textes et recueillera, tout au long de l'année 2024, les contributions des chercheur·se·s désireux d'apporter leur petite pierre à l'édifice… de souffler avec nous ces belles bougies. N'hésitez pas à nous proposer votre contribution. Il s'agit pour le CRIIA d'ouvrir largement ses pages à la communauté scientifique afin de rendre hommage à nos deux regrettés pères fondateurs, Bernard Sesé et Thomas Gómez, et à tout·e·s ceux·celles qui, au fil du temps, ont fait de Crisol ce qu'elle est à présent. Nous sommes fier·ère·s de notre héritage et c'est avec reconnaissance, peut-être, également, le sentiment de porter une certaine responsabilité que nous nous tournons vers l'avenir… pour bien d'autres projets.
Un grand merci aux équipes de Crisol pour leur travail. Le Comité scientifique: Zoraida Carandell; Dalila Chine; Jean-Stéphane Durán-Froix; Sandra Gondouin; Lina Iglesias; Béatrice Ménard; Diana Sarrade Cobos; Emmanuelle Sinardet; Allison Taillot; Eva Touboul; Amélie Piel. Et le Comité éditorial: Pauline Cœuret; Julia de Ípola; Garcon Lévana; Grolleau Alexia; Yann Seyeux; Inès Jacques.
Caroline Lepage, Sandra Gondouin et Laurie-Anne Laget
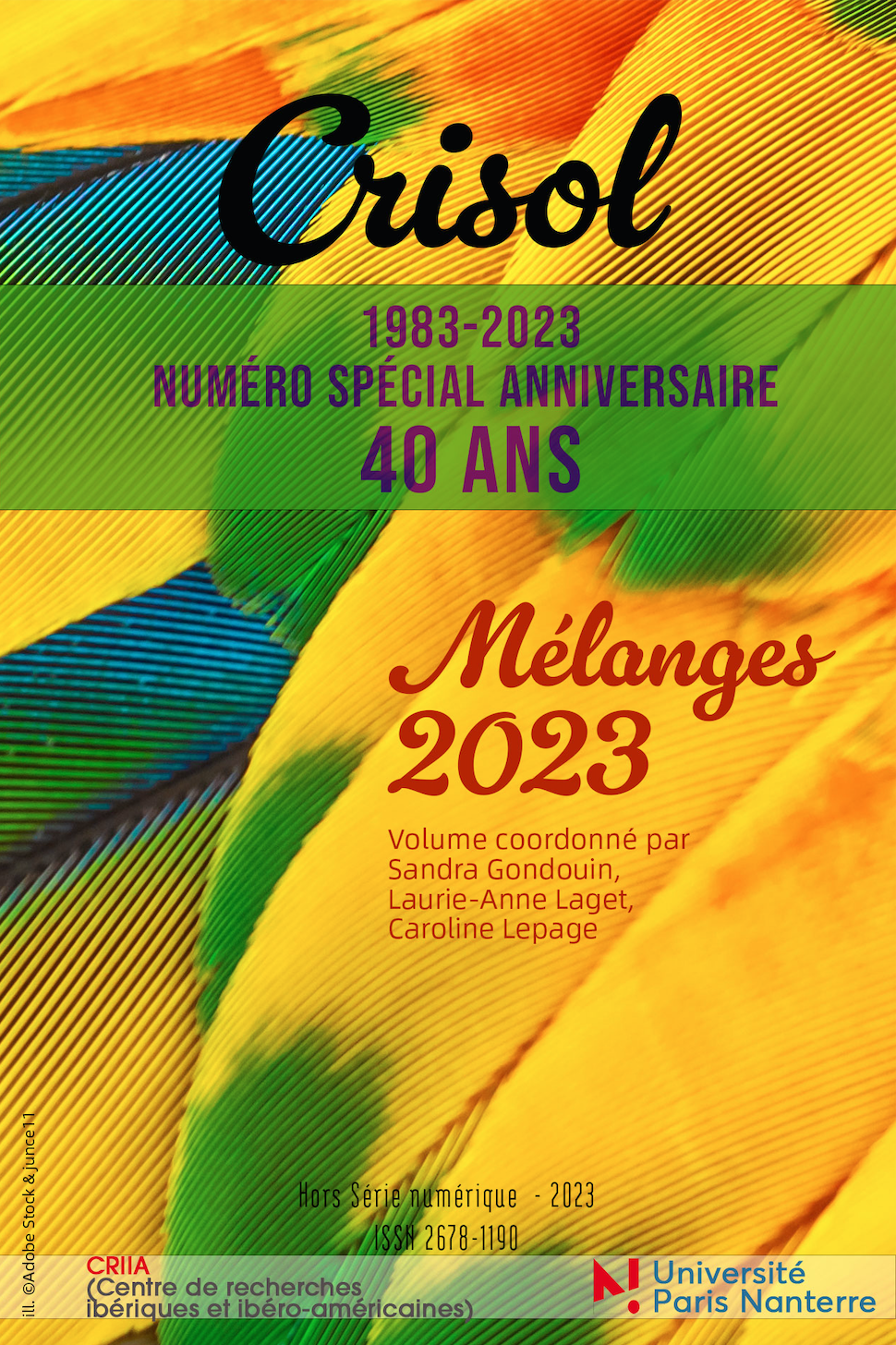
SOMMAIRE
Diane Bracco (Université de Limoges [EHIC]), «Geografía de una resiliencia: estudio de la espacialidad en Madre de Rodrigo Sorogoyen»
Fausto Garasa (Université de Tours, ICD, EA-6297), «Déplacements et représentations conceptuelles et spatiales dans les sociétés pyrénéennes traditionnelles de l’Aragon contemporain»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre / CRIIA - HLH), «De faux “vrais” adieux de García Márquez»
Álvaro López Fernández (Universitat de València), «En las fronteras del wéstern y de lo fantástico: los casos de Basilisco (2020), de Jon Bilbao, y Peregrino transparente (2023), de Juan Cárdenas»
Yann Seyeux (Université Paris Nanterre / Études romanes — CRIIA), «Tecnologías Vitales (2022) d’Edgar Gómez Cruz: une invitation à (enfin ?) penser les cultures numériques depuis l’Amérique latine»
Clara Siminiani León (Universidad de Alcalá / Université de Strasbourg), «Anatomía del jardín: De la física cuántica a lo fantástico en Hubo un jardín de Valeria Correa Fiz»
Sabrina Wajntraub Université (Paris Nanterre / Études Romanes – CRIIA]), «Repenser la bio d’Eva Duarte Perón au 70ème anniversaire de sa mort (1952-2022). Le cas de la mini-série argentine Santa Evita (2022)»
Víctor Alarcón (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá), «Algunos usos de lo sobrenatural en el Caribe. Los casos de El reino de este mundo y Del amor y otros demonios»
Aurore Ducellier (Université de Limoges, EHIC), «Légalité et clandestinité de l’écriture poétique dans les prisons franquistes»
Darío Varela Fernández (Sorbonne Université, CRIMIC – UR 2561), «Adolphe Falgairolle (1892-1975) Un passeur culturel entre la France et l’Espagne tombé dans l’oubli»
Julia de Ípola (Université Paris Nanterre / CRIIA), «Le plébiscite chilien de 2022: la franja electoral en perspective»
Pauline Cœuret (Université Paris Nanterre / CRIIA), «Quand le fait divers devient événement: analyse du féminicide d’Ingrid Escamilla et de ses impacts dans la société mexicaine»
Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre / CRIIA), «2022, “justo centenario” de Aurora Venturini. Reediciones, rectificaciones, reparaciones: cómo y por qué leer a la autora hoy»
Amélie Piel (CRIIA, Université Paris Nanterre), «Cet autre démonstratif: le système des déictiques de l’espagnol classique»
Cathy Fourez (Univ. Tours, EA 6297 - ICD-Interactions Culturelles et Discursives, F-37000 TOURS, FRANCE), «Industrie du spectacle et tyrannie du corps dans Friquis (2016) de Fernando Lobo: le graal de la beauté (fatale)»
Salomé Dahan (Université de Paris-Est Créteil), «Récupérer la mémoire des femmes dans la guerre des Malouines: Nosotras también estuvimos de Federico Strifezzo (2021)»
Audrey Louyer (Université de Reims Champagne-Ardenne - CIRLEP /EA4299), «Fantastiques géométries. De l’arabesque au rhizome: «métriser» l’inquiétante étrangeté du cuento en Amérique Latine»
Oscar Gamboa Durán (Universidad Sorbonne Nouvelle), «Retos del género como una comunidad imaginada, relaciones entre mujeres y los cuestionamientos antinormativos de En rojo de Gisela Kozak»
Lou Freda (EHEHI – Casa de Velázquez / CRIIA – Université Paris Nanterre), «Sororidad y ejemplaridad en la prosa de Sofía Casanova»
Françoise Richer-Rossi (Université Paris Cité, Laboratoire ICT / Identités, Cultures, Territoires, Les Europes dans le monde), «Les lettres et les ouvrages d’Alfonso de Ulloa envoyés à Philippe II depuis Venise: la mémoire de l’événement à l’épreuve de la prison»
Cynthia Gabbay (Université d’Orléans, Remelice-Le Studium Loire Valley Institute for advanced studies; Centre Marc Bloch Berlin), «L’Autotraduction de Mika Feldman Etchebehere ou l’écriture à deux plumes pour un pacte cosmopolite»
Claudia Torre (Universidad Nacional de Hurlingham /Argentina), «Narrativa desobediente argentina. Una aproximación a Llevaré su nombre (2021) de Analía Kalinec»
Inès Guégo Rivalan (Université Rennes 2 – CRIIA, Université Paris Nanterre), «Les représentations topiques des synesthésies dans le théâtre de l’âge d’argent en Espagne (1911-1936)»
Nathalie Besse (Université de Strasbourg – CHER / UR4376), «La monstruosité dans Los actores perversos de José Adiak Montoya: jeux narratifs et jeux de perspectives»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
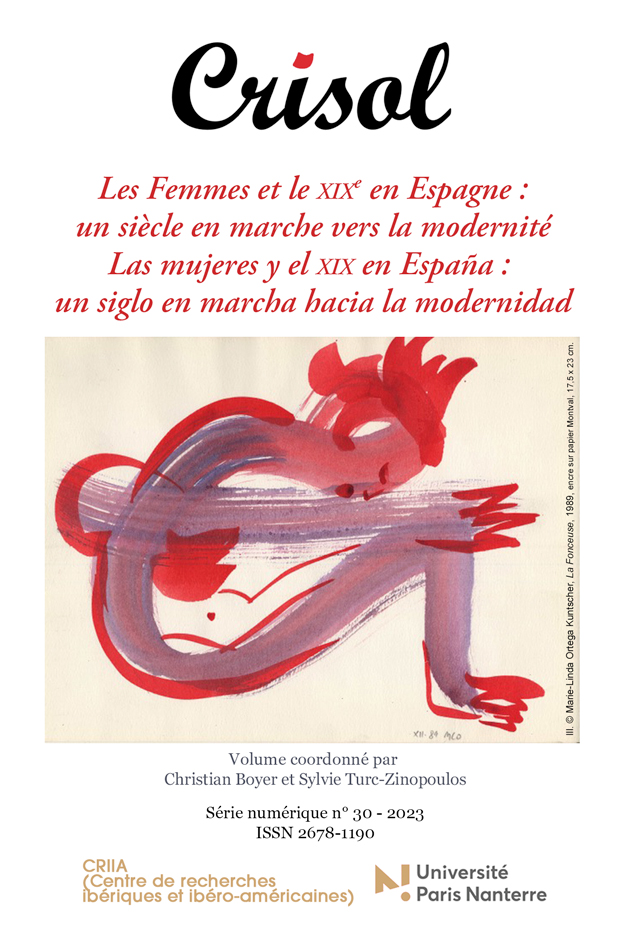
Les femmes et le XIXe en Espagne: un siècle en marche vers la modernité / Las mujeres y el XIX en España: un siglo en marcha hacia la modernidad
No 30 (2023)Ce numéro spécial de Crisol repose sur une double idée : il s'agit d'une part de renouveler le regard porté sur le XIXe siècle, en particulier espagnol, parmi les hispanistes français.
D'autre part, nous inscrivant dans la perspective plus large d'une remise en question des panoramas androcentrés qui ont dominé les sciences ou les Humanités jusqu’à il a peu, le dossier présenté ici se propose de suivre quelques autrices, parfois tombées dans l'oubli ou reléguées à un rôle secondaire, qui ont cependant contribué à faire bouger les lignes de leur siècle, à bousculer les normes admises. Bref, à faire advenir la modernité de leur temps en devenant sujets de leur destin.
**
La idea de este número especial de Crisol es doble: por un lado, se trata de renovar la mirada de los hispanistas franceses sobre el siglo XIX español, en particular.
Por otra parte, desde la perspectiva más amplia de un cuestionamiento de los panoramas androcéntricos que han dominado las ciencias y las Humanidades hasta hace poco, el dosier aquí presentado se propone seguir a algunas autoras, a veces olvidadas o relegadas a un papel secundario, que han contribuido sin embargo a sacudir su siglo y las normas aceptadas. En resumen, que han propiciado la modernidad de su tiempo convirtiéndose en sujetos de su propio destino.
Christian Boyer et Sylvie Turc-Zinopoulos
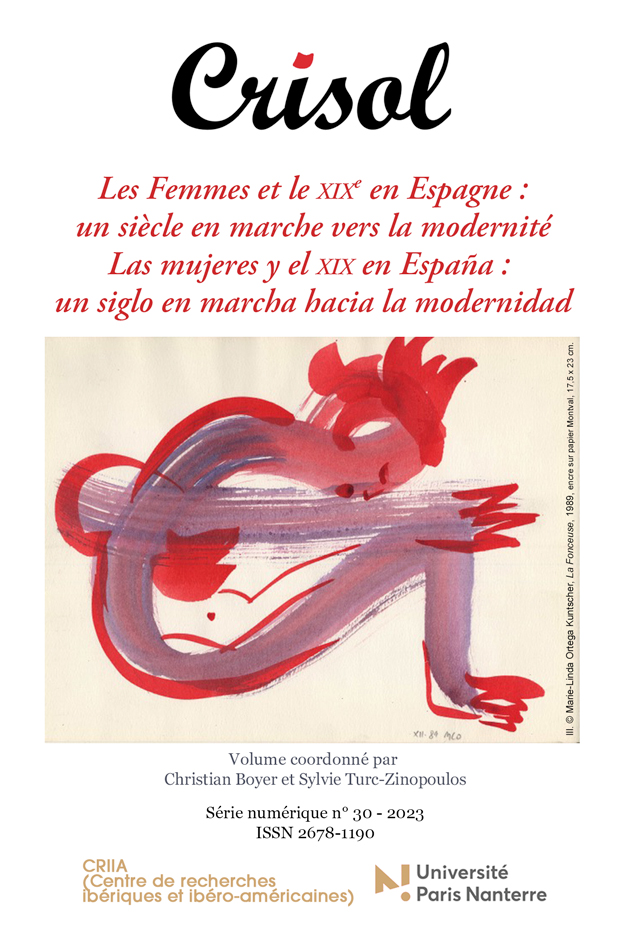
SOMMAIRE
Christian Boyer et Sylvie Turc-Zinopoulos, Préface - Prefacio
José Manuel González Herrán (Universidade de Santiago de Compostela), «Mujeres violentas en algunos cuentos de Emilia Pardo Bazán»
Marie-Angèle Orobon (CREC-Université Sorbonne Nouvelle), «Le triomphe de l’idée moderne : allégories féminines au XIXe siècle en Espagne»
Emilia Pérez Romero (Lycée Leonard de Vinci – Saint-Witz), «Emilia Pardo Bazán, narradora de la vida moderna»
Marta B. Ferrari (Universidad Nacional de Mar del Plata), «Las escritoras románticas españolas a la conquista del espacio público»
Dolores Thion Soriano-Mollá (Item /Cellam. Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Rennes 2), «Emilia Pardo Bazán en el ocaso de la poesía»
Manuelle Peloille (3L.AM, Université d'Angers), «Sofía Tartilán, el progreso por etapas»
Gloria Espigado Tocino (Universidad de Cádiz), «Un texto pionero del feminismo español: Rosa Marina, La mujer y la sociedad (1857)»
Elena Hernández Sandoica (Universidad Complutense de Madrid), «Poseer la palabra y anhelar la justicia. Autonomía femenina y libre pensamiento en Rosario de Acuña (1850-1923)»
Sylvie Turc-Zinopoulos (Université paris Nanterre / CRIIA), «Modernidad de Julia Codorniu ante la Ley española en Mis versos (1894)»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-

Continuités et Discontinuités
No HS (2023)Ce volume de Crisol rassemble les contributions issues du séminaire du groupe Horizons des littératures Hispaniques (membre du CRIIA) consacré à «Continuités et Discontinuités». Cette fois, plutôt que de publier en même temps, à la fin du cycle, l'intégralité des articles, nous avons décidé de les mettre en ligne au fur et à mesure… afin que celles et ceux qui se retrouvent dans le cadre de ces rencontres mensuelles de HLH ou, simplement, celles et ceux qui s'intéressent à nos travaux puissent nourrir leur réflexion à mesure qu'elle se développe à travers une trace écrite formalisée de nos échanges.
Le volume s'enrichira donc régulièrement de nouveaux textes pendant les deux prochaines années.
Pour commencer, Graciela Villanueva (Professeur à l'UniversitéParis-Est Creteil) nous offre un solide cadrage théorique et un éventail des approches méthologiques possibles de ce que l'on entend par continuité et discontinuité. Françoise Aubès (Professeur émérite à l'Université Paris Nanterre) nous propose, à partir du cas particulier de l'écrivaine péruvienne Karina Pacheco Medrano, une réflexion sur la question des effets de continuités et discontinuités, recherchés ou non, produits via la création de recueils ou d'anthologies de nouvelles. Corinne Mencé-Caster s'appuie sur un corpus de textes littéraire du domaine hispaniques pour interroger ce qui relève de la continuité – comme signes et symptomes de l'adhésion à un ordre dominant – et ce qui relève de la discontinuité – comme signes et symptomes de périodes de crise et de remise en cause de l'ordre dominant. Sophie Marty s'est penchée sur le cas du roman Cuaderno ideal, de Brenda Lozano (2014) qui représente un vrai défi justement pour faire roman depuis une apparente hyper-fragmentation. Quelles stratégies visibles et moins visibles sont-elles convoquées pour faire un tout. Dans un texte intitulé «Le recueil de formes brèves au prisme de la transtextualité Poétique, herméneutique, pratique», Julien Roger propose une théorisation, une poétique du recueil de formes brèves de prose à partir du corpus théorique de Gérard Genette dans Palimpsestes, ébauche une herméneutique de la transtextualité du recueil en tant que forme – il s'appuie sur Las fuerzas extrañas, de Leopoldo Lugones, pour étayer son propos. Julia de Ípola, elle, a travaillé sur PR3 Aguirre, de la Portoricaine Marta Aponte Alsina, pour interroger l'usage et la construction des continuités entre l'écriture documentaire et l'imagination au moment de poser les jalons d'une complexe et ambiguë théorie de l'écriture de la mémoire.
Les séances du séminaire de HLH font régulièrement l'objet d'une captation mise ensuite en ligne sur la chaîne YouTube du CRIIA. N'hésitez pas à aller les regarder.
Captation de la séance avec Graciela Villanueva
Captation de la séance avec Laura Gentilezza
Captation de la séance avec Françoise Aubès
Captation de la séance avec Corinne Mencé-Caster
Captation de la séance avec Sophie Marty
Captation de la séance avec Julia de Ípola
Captation de la séance avec Julien Roger
Captation de la séance avec Renée-Clémentine Lucien
Captation de la séance avec Marion Gautreau
Captation de la séance avec David Crémaux Bouche
Captation de la séance avec Inès Guégo Rivalan
Captation de la séance avec Alexia Grolleau
Captation de la séance avec Julie Burgeot
Captation de la séance avec Caroline Lepage
Captation de la séance avec Marie Gourgues
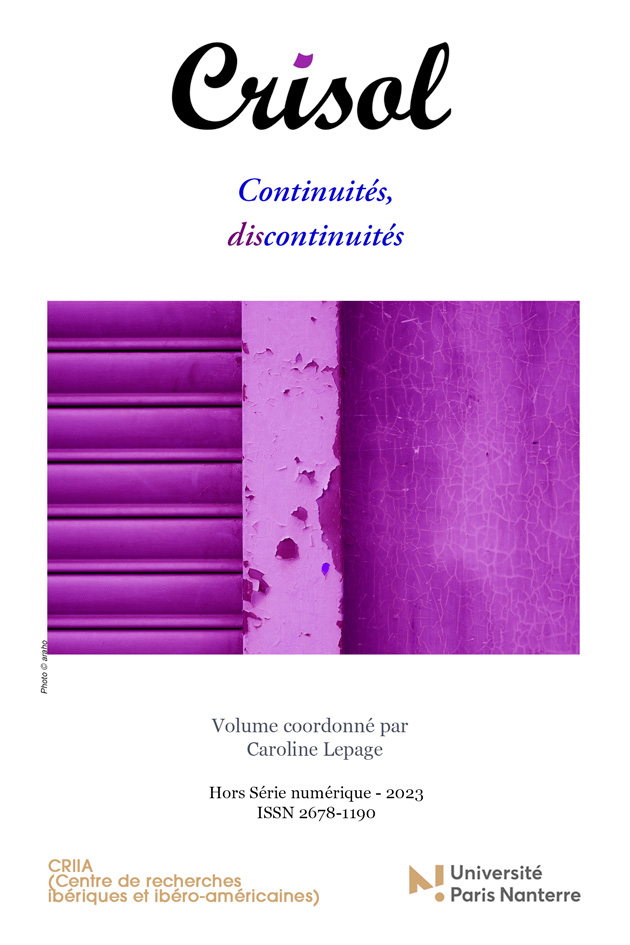
SOMMAIRE
Graciela Villanueva (Univ Paris-Est Creteil, IMAGER, F-94010 Creteil, Franceet EUR FRAPP), «Perception et construction de la (dis)continuité. Quelques pistes en vue d’une réflexion sur ces concepts en littérature»
Françoise Aubès (Université Paris Nanterre – CRIIA / HLH), «Étude de la continuité mystérieuse du recueil à partir de l’œuvre de la romancière péruvienne Karina Pacheco Medrano (1969, Cusco)»
Corinne Mencé-Caster (Lettres Sorbonne Université - Faculté des lettres CLEA (UR 4083), «Construire la discontinuité littéraire contre la linéarité du langage. Quelques études de cas dans la littérature hispanique»
Sophie Marty (REMELICE/CRIMIC), «“Un cuaderno es una vía láctea de letras”: continuidades y discontinuidades en una obra de Brenda Lozano»
Julien Roger (Sorbonne Université - CRIMIC UR2561), «Le recueil de formes brèves au prisme de la transtextualité Poétique, herméneutique, pratique»
Renée Clémentine Lucien (Sorbonne Université CRIMIC EA 2561), «Continuités et discontinuités, des «vibrations magnétiques» dans et entre deux anthologies de femmes poètes, Nancy Morejón et Georgina Herrera»
Julia de Ípola (Université Paris Nanterre / CRIIA), «L’archipel et l’autoroute: continuité et discontinuité dans PR3 Aguirre (2018), de Marta Aponte Alsina»
Marion Gautreau (Université Toulouse – Jean Jaurès FRAMESPA / UMR 5136), «Héritages et intericonicité dans la photographie de presse mexicaine au XXe siècle»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre, CRIIA/HLH), «Discontinuités, continuités et rétro-continuités dans Queremos tango a Glenda (1980) de Julio Cortázar»
Marie Gourgues (Université d’Artois – Textes et Cultures / UR 4028), «De la littéra-cou-ture: accrocs et reprises dans Els paradisos artificials d’Alfons Cervera»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
Du descriptif à l'indécrit
No 32 (2023)SOMMAIRE
Du descriptif…
Cécile Brochard (Nantes Université), «Yñipyru d’Augusto Roa Bastos, ou le descriptif démiurgique»
Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre – CRIIA / HLH), «La descripción como operador de ilegibilidad en la novela Nosotros, los Caserta (1992) de Aurora Venturini»
Marta Noguera Ortega (Université Paris Nanterre – Casa de Velázquez), «Commencer à (d)écrire. Réflexions autour du descriptif dans la genèse de El cuento de nunca acabar»
Paula Klein (Université Clermont Auvergne), «Listes, inventaires, travaux pratiques: le descriptif comme poétique infra-ordinaire chez Georges Perec et Julio Cortázar»
Preciado Soline Martinez (Université Paris Nanterre – CRIIA / HLH), «Les enjeux du descriptif dans Testo Yonqui, de Paul B.»
Yann Seyeux Université Paris Nanterre (Études Romanes – CRIIA), «Quand la machine (d)écrit. L’effet de liste dans Lagunas, un roman algorithmique de Milton Läufer»
Gaëlle Hourdin (Université Toulouse Jean Jaurès), «L'ekphrasis poétique hispano-américaine aux confins du figuratif et de l’abstraction»
Anna Rojas (Université Savoie Mont Blanc / LLSETI), «Promouvoir le livre: un exemple de stratégie commerciale sur le marché éditorial argentin»
Sylvie Turc-Zinopoulos (Université Paris Nanterre - CRIIA), «Lo descriptivo en la Topografía médica de las islas filipinas (1857) de Antonio Codorniu y Nieto»
Santiago Uhía Laboratoire d'Études Romanes EA 4385 (Université Paris 8), «Sept considérations autour de la liste et l’énumération chez Fernando Vallejo»
… à l'indécrit
Pénélope Laurent (Sorbonne Université – CRIMIC), «Tache aveugle dans El huésped de Guadalupe Nettel»
Corinne Mencé-Caster Sorbonne université (relir-clea, EA 4083) Olivier Biaggini (Université Sorbonne Nouvelle (lecemo-crem, EA 3979), «Une approche théorique de l’indécrit et une étude cas (General estoria, Première partie, IV)»
Clara Berdot (Université Paris-Est Créteil LIS / Lettres, Idées, Savoirs / UR 4395), «L’indécrit volontaire chez Borges: ellipses narratives, clivage du lectorat et maîtrise biographique»
Graciela Villanueva (Université Paris-Est Créteil IMAGER /UR 3958), «De la alacridad al silencio: “El etnógrafo” de Jorge Luis Borges»
Julia De Ípola (Université Paris Nanterre – CRIIA), «Por qué volvías cada verano: la no ficción entre lo indescrito y lo indescriptible»
Marie-José Hanaï (Université de Rouen Normandie, ERIAC / UR 4705), «Le silence du texte pour (ne pas) décrire l’insupportable violence : l’écriture en creux d’Emiliano Monge dans La superficie más honda»
-
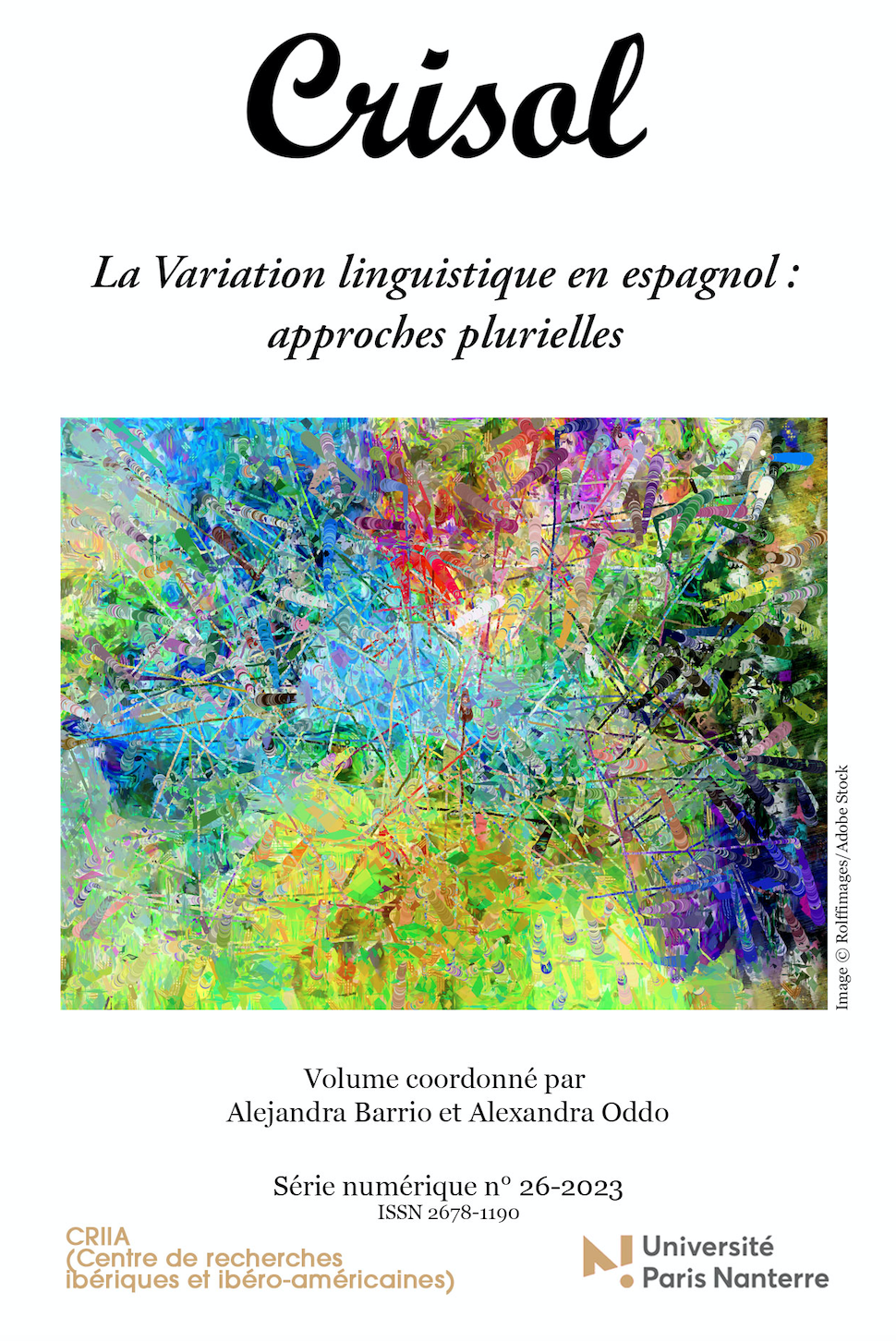
La variation linguistique en espagnol: approches plurielles
No 26 (2023)Le projet qui se dessine dans le titre de cette publication La variation linguistique en espagnol: approches plurielles s’ancre pour nous dans un questionnement profond et dans un temps long qui a déjà permis de produire une série de travaux consacrés au domaine de la variation. Nous avions pu alors évaluer l’importance de la variation non seulement en diachronie et en diatopie, mais aussi dans des emplois sociaux, institutionnels et pragmatiques qui nous ont fait prendre conscience du pouvoir fédérateur de ce domaine de recherche qui se pose comme un outil indispensable pour mieux connaître et comprendre les rapports entre la langue et la société. Si ces travaux ont pu éclairer et dynamiser de nombreux pans de la recherche dans des domaines variés allant de la langue à la littérature et à la civilisation dans les pays de l’aire hispanique, ils sont loin d’avoir épuisé la question et ont, bien au contraire, ouvert de nouvelles perspectives de recherche et de nouveaux questionnements. C’est que la notion de variation peut être abordée sous plusieurs angles et peut intéresser des chercheurs provenant de différentes disciplines. Ce numéro de Crisol, consacré à la variation dans les domaines de la langue et de la littérature, se donne pour objectif d’observer la variation au sens large cette fois, dans un monde hispanique d’une très grande diversité au-delà du concept générique qui englobe les peuples de langue et de culture espagnole sous la bannière de l’hispanidad. Il nous aura encore une fois permis de rassembler des travaux inédits d’une très grande qualité autour de cette notion féconde qu’est la variation.
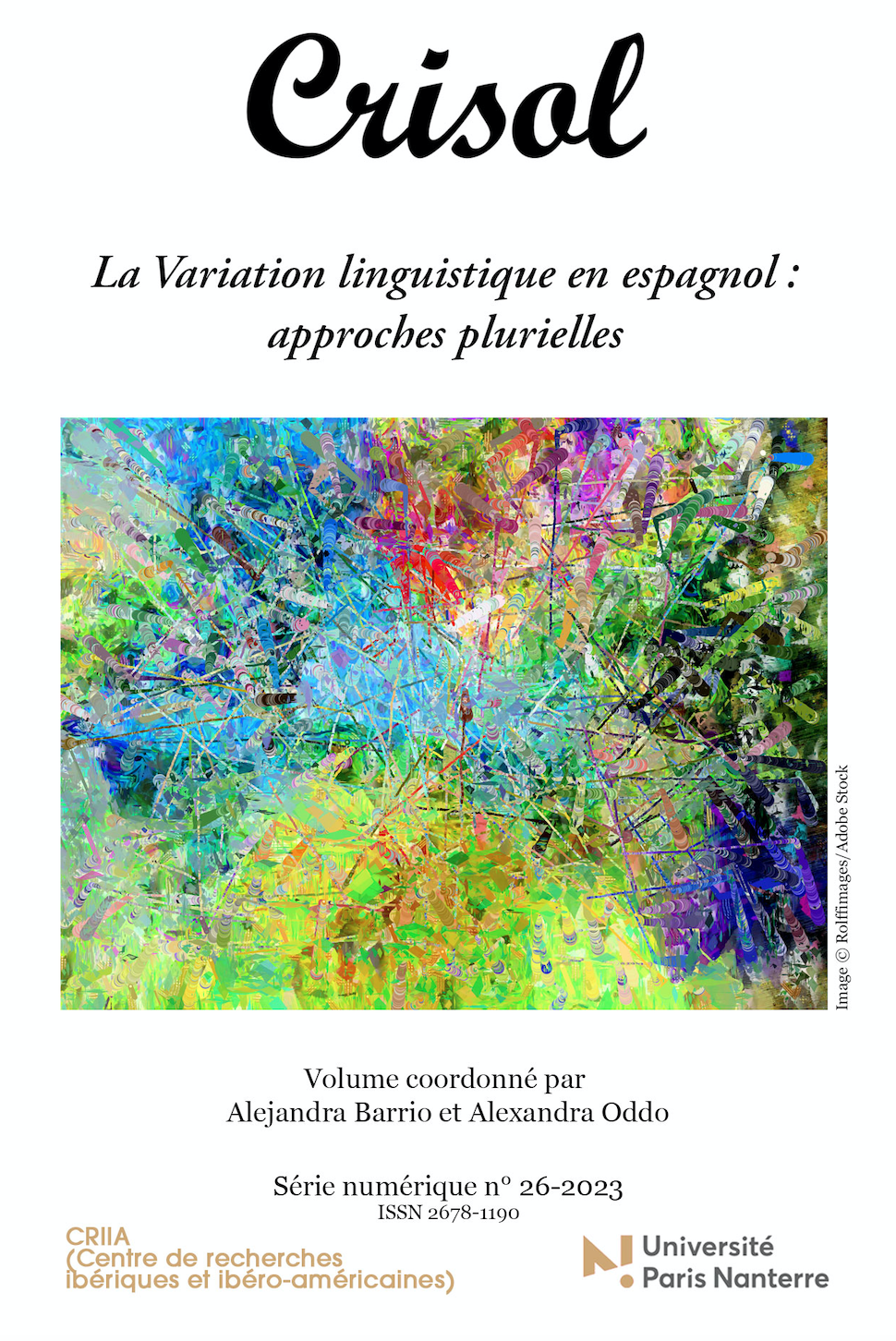
SOMMAIRE
Introduction, Alejandra Barrio (CRILLASH, Université des Antilles) et Alexandra Oddo (Études Romanes-CRIIA, Université Paris Nanterre)
Première partie – L’espagnol dans sa diversité: diatopie, diachronie, diastratie et diaphasie
Corinne Mencé-Caster (CLEA, Sorbonne Université), «La problématique de la ‘disparition’ et/ou de la co-existence des phonèmes: variations synchroniques et diachroniques et approches phonologiques en espagnol ancien et contemporain (Espagne et Amérique)»
Olivier Iglesias (CLESTHIA, Sorbonne Nouvelle), «Si pudiera o pudiese: la variation dans l’emploi des formes en -ra et en -se depuis une perspective idiolectale»
Carmen Quintero (Études Romanes-CRIIA, Université Paris Nanterre/Universidad Complutense de Madrid), «Rosa y rosado: cuestiones de variación lingüística»
Ana Ramos Sañudo (Études Romanes-CRIIA, Université Paris Nanterre), «Variación pragmática regional de marcadores discursivos de (des)acuerdo en el español de Andalucía»
Alejandra Barrio (CRILLASH, Université des Antilles), «Fenómenos de variación y alternancia en el español de hablantes bilingües en Martinica»
Deuxième partie – D’autres coordonnées de la variation: la phrase, le texte
Alexandra Oddo (Études Romanes-CRIIA, Université Paris Nanterre), «Apports de l’axe diachronique dans l’étude de lavariation des unités phraséologiques en espagnol»
Jean-Claude Anscombre, (LT2D, CNRS), «Tabús, censura y variaciones en el refranero soez»
Bernard Darbord (Études Romanes-CRIIA, Université Paris Nanterre), «Variation autour de la strophe 61 du Libro de buen amor»
Clara Dauler (CRILLASH, Université des Antilles), «De La novela de mi vida à Regreso a Itaca ou les variations du genre romanesque dans l’œuvre de Leonardo Padura»
Raquel Gómez Pintado (CLEA, Sorbonne Université), «Traduire l’hétérolinguisme de la littérature des Petites Antilles francophones en espagnol. Études de cas: Maryse Condé et Raphaël Confiant»
Compte-rendu de lecture
Emmanuelle Sinardet, «Marie-Lise Gazarian, Gaston von dem Bussche, Jaime Quezada, Pedro Pablo Zegers, El rescate del Baúl de los recuerdos: diálogo en torno a Gabriela Mistral»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
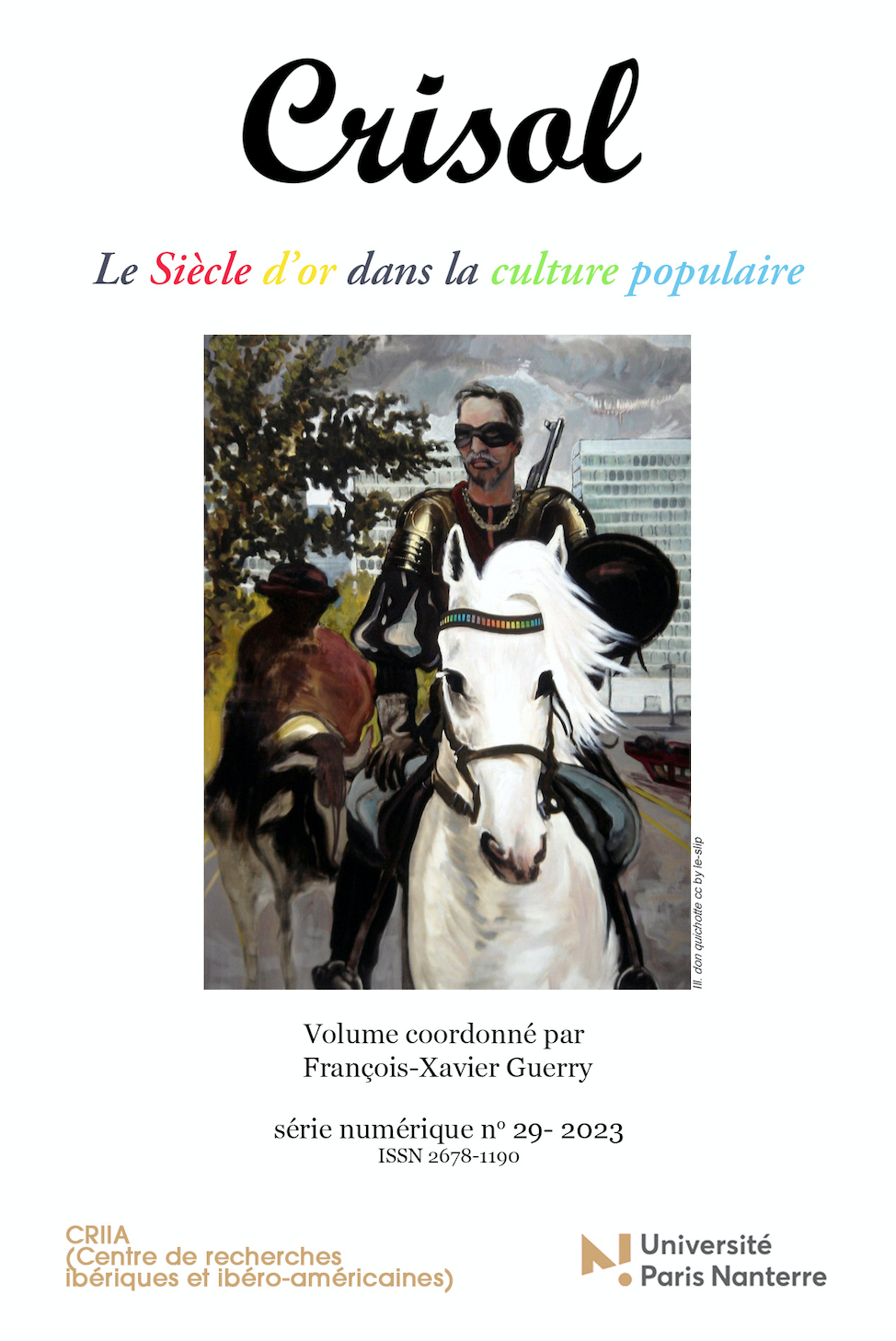
Le Siècle d'or dans la culture populaire
No 29 (2023)Le Siècle d’or dans la culture populaire
Lorsque Terry Gilliam se propose d’adapter sur grand écran le chef-d’œuvre de Miguel de Cervantès (The Man Who Killed Don Quixote, 2018), il ne sait pas qu’il se lance dans un périple de plus de deux décennies, fait de revers et de déconvenues à la chaîne (problèmes de financement chroniques, conflits avec les producteurs, acteurs empêchés de jouer et jusqu’aux inclémences du ciel qui perturbèrent le tournage), un périple mouvementé qui reproduit en quelque sorte celui du héros cervantin qui en est à l’origine . Cette genèse tourmentée, à laquelle l’intrigue du film finalement achevé ne manque pas de faire référence, serait-elle une métaphore de la relation volontiers tumultueuse qu’il peut y avoir entre Siècle d’or – convoqué à travers son personnage le plus iconique, Don Quichotte – et culture populaire ?
Le Siècle d’or ne se cantonne pas, loin s’en faut, aux pages des manuels scolaires et n’est pas l’apanage des universitaires et des concours de recrutement. C’est son existence hors des murs de l’université et des institutions qui le font vivre habituellement et l’ont élevé au rang de Siècle d’or précisément qui nous intéresse dans ce vingt-neuvième numéro de Crisol ; une existence parallèle, voire alternative, qui n’a souvent que faire du prestige qui l’entoure (quoiqu’elle l’exploite de bonne grâce) et des instances qui l’ont pour ainsi dire canonisé, et qui dépoussière, osons le mot, une culture que d’aucuns jugeront lointaine et scolaire ; une existence qui bat en brèche l’habituel cloisonnement entre haute culture et culture populaire. Ce n’est donc pas la culture populaire, que l’on définit d’ordinaire, en effet, par opposition à la haute culture (ce serait la définition la plus simple, une définition par la négative), qui nous occupe pour elle seule, mais bel et bien la façon dont elle s’approprie une culture vieille de plusieurs siècles, et ce qui en résulte.
On entend ici par culture populaire, conformément à la définition qu’en donne Shirley Fedorak, dans son ouvrage intitulé Pop Culture (2009), la culture de tous les jours, la culture de masse, qui touche un vaste public, non pas de façon incidente, mais par vocation et à dessein. Et au-delà du caractère massif qui est le sien et des critères proprement quantitatifs (nombre de ventes, de likes, de reproductions), c’est le geste de l’appropriation qui se trouve au cœur de la culture populaire [C’est d’ailleurs ce qui la différencie, nous dit Richard Mèmeteau, de la contre-culture, hostile à toute réappropriation ou récupération : « Les idées d’authenticité et de nouveauté définissent profondément la contre-culture et son paradigme moderniste. Au contraire, la pop culture est située par beaucoup du côté du postmodernisme, de la parodie et du collage » (Pop culture. Réflexions sur les industries du rêve et l’invention des identités, Paris, La Découverte, 2019 [2014], p. 17. Voir également p. 290-291)], et, pour notre propos, l’appropriation de certains personnages et de ses avatars, d’un univers fictionnel qui appartiennent à la culture du Siècle d’or – entendu dans ses bornes chronologiques larges et dans son versant essentiellement littéraire comme la période qui va de la fin du règne des Rois Catholiques jusqu’à la fin du règne des Habsbourg et l’époque baroque. Appropriation créatrice de la part de ceux qui en font quelque chose (d’autre) et appropriation au carré de la part du public qui consomme ces produits du Siècle d’or passés à la moulinette pop.
Ce numéro de Crisol a donc pour objet la culture populaire et/dans le Siècle d’or, deux concepts qui ne constituent pas un couple si antinomique que l’on pourrait d’abord le croire. Ce n’est ni une entreprise de réhabilitation de la culture populaire que la nôtre, ni un examen des mérites comparés des manifestations culturelles populaires et des manifestations littéraires consacrées. Ce qui motive ce numéro, c’est la volonté d’étudier, sans préjugés ni condamnations esthétiques aprioristiques, dans une perspective fondamentalement transmédiatique, ces manifestations culturelles populaires bigarrées qui s’emparent des œuvres littéraires et du Siècle d’or pour en faire autre chose : les faire connaître, les vulgariser, s’en moquer, leur rendre hommage, les amplifier, développer les mille possibilités qu’offre leur univers fictionnel, concrétiser leurs virtualités, les exploiter à des fins publicitaires, récréatives, journalistiques, étant entendu que les motivations ne s’excluent pas les unes les autres. L’intérêt se porte également sur les objets culturels qui recréent l’Espagne des XVIe-XVIIe siècles, s’en inspirent de façon plus ou moins appuyée, ou nous plongent dans l’ambiance de cette époque : depuis les œuvres d’Antonio Hernández Palacios, la bande dessinée Les Indes fourbes (Ayroles/Guarnido, 2019) jusqu’aux jeux vidéo (Blasphemous, The Game Kitchen/Team17, 2019), en passant par certaines créations vestimentaires de Cristóbal Balenciaga.
La grande diversité, pour ne pas dire la dissimilitude, des objets culturels accueillis dans ce volume (dessin de presse et d’actualité, vêtements de haute couture, morceau de trap, série télévisée, mème…) et certains rapprochements que certains jugeront peut-être acrobatiques, trouvent leur cohérence dans le fait que ce sont les rives du Siècle d’or qui sont abordées, sous le prisme de la fiction le plus souvent, et dans la diffusion potentiellement massive qui est la leur. La culture populaire se définit moins par les caractéristiques propres de ses manifestations, en effet, que par ses canaux de production, de diffusion et de réception, par l’ampleur du public qu’elle peut atteindre. C’est donc une réflexion sur ce qu’est la culture populaire à laquelle sont invités les lecteurs, et sur les opérations que ce passage d’une œuvre (ou d’œuvres) de la culture consacrée à la culture populaire suppose, que celle-ci soit marquée du sceau de la Movida ou de l’imaginaire volontiers gaillard d’un Francisco Ibáñez. Ce champ d’étude, d’actualité si l’en est, à l’heure où les séries s’attaquent à certains personnages de l’imaginaire collectif de cette époque (Águila roja, TVE, 2009 ; Isabel, TVE, 2012 ; El Ministerio del tiempo, TVE, 2015 ; Carlos, rey emperador, TVE, 2015) et les fandoms sont plus actifs que jamais sur internet, n’a été que peu exploré pour ce qui est des revisitations et de l’exploitation du Siècle d’or. Il est vrai que la culture pop s’incarne essentiellement dans des figures pop de naissance, des figures fictionnelles actuelles destinées, d’emblée, à toucher un large public, et appartenant aux genres qui se vendent le mieux. Et pourtant, n’y a-t-il pas une mode du Siècle d’or ? Le revival du Siècle d’or, s’il a lieu, ne viendra-t-il pas justement de la culture populaire, à une époque où il a moins le vent en poupe, semble-t-il, à l’université ?
Au-delà de la dimension proprement hypertextuelle et transfictionnelle de la réappropriation sur laquelle se penchent la plupart des contributeurs, et les réflexions de nature forcément intermédiale que suppose le passage d’un média (texte littéraire, le plus souvent) à l’autre (cinéma ; jeux vidéo ; musique, depuis l’album La leyenda de la Mancha du groupe Mägo de Oz, une chanson de Lhasa, intitulée La Celestina, jusqu’aux clips musicaux parodiques de certains youtubeurs), ce sont les opérations qui président au passage d’un texte littéraire, d’un tableau consacrés à son existence populaire qui nous interrogent : l’adaptation, l’adultération, la profanation diront certains, la simplification que l’on postule à l’arrière-plan (a-t-on raison de la postuler ?), l’acclimatation aux coordonnées de l’époque qui est la nôtre, et le décalage entre la contemporanéité de ces manifestations culturelles et l’époque des objets qu’elles convoquent. Ce sont donc moins les transformations que subit tel élément de l’univers fictionnel classique auquel on puise qui attirent notre attention, que les stratégies des auteurs (entendus au sens large) pour créer des œuvres attractives, pour rendre accessible le Siècle d’or, à supposer qu’il ne le soit pas sans ce truchement, pour s’assurer un succès commercial, sinon un succès d’estime ; autrement dit, les transformations qui visent à actualiser le Siècle d’or, qui le font vivre, en même temps qu’elles le dénaturent, ou, pour le dire mieux, qui le font vivre précisément parce qu’elles le dénaturent, l’adaptent et le re-sémantisent. Ces produits culturels qui se saisissent du Siècle d’or et en font un élément de distinction pourraient-ils s’apparenter à des produits d’appel à même de donner envie au grand public de s’y intéresser, de le (re)découvrir et de revenir à la source ?
Nous ne perdons pas de vue qu’il est moins question de la migration d’un texte dans un autre texte ou sur un autre support, et des liens qui se tissent entre les deux, que de réception au long cours. Notre intérêt se porte aussi bien sur les adaptations filmiques, les adaptations sous forme de bandes dessinées, de romans graphiques, qui agrègent l’image au texte d’origine, que sur les réécritures qui s’affranchissent de celui-ci, investissent un univers fictionnel, l’image d’un personnage, pour ce qu’il représente, les valeurs dont il est porteur (à commencer par Don Quichotte, pouvait-il en être autrement ?), et donnent lieu à des crossovers inattendus. Les objets, qui, sans ressortir à la littérature, jouent avec elle, l’utilisent à des fins humoristiques, promotionnelles ou d’actualité, comme pur prétexte aussi (on pense à certains gifs), ont également retenu notre attention.
Quels sont les pans de la culture du Siècle d’or que la culture populaire investit volontiers, et pourquoi ? Y a-t-il à ce titre un Siècle d’or pop(ulaire) ? S’il est vrai que l’on définit communément ce qui est populaire par son contraire, c’est-à-dire ce qui appartient en propre à une culture élitiste, d’intellectuels ou d’initiés, ou à une contre-culture, l’appropriation tous azimuts par un large public de certains motifs, de certains mythèmes de la culture du Siècle d’or, « qui deviennent ainsi de véritables électrons de sens, libres de survivre pour eux-mêmes ou d’entrer dans de nouvelles combinaisons, de nouveaux récits », [Jean-Jacques Wunenburger, « Création artistique et mythique », Questions de mythocritiques. Dictionnaire, Imago, 2005, p. 78] ne met-elle pas en évidence les limites d’une telle distinction ? Certaines intrigues chevaleresques, picaresques ou quichottesques, au succès résonnant en leur temps, ne sont-elles pas intrinsèquement populaires et, par là même, plus susceptibles que d’autres d’être concernées ? Cette appropriation dont nous avons parlé va-t-elle nécessairement de pair avec un aplatissement des enjeux des textes ainsi pris pour cible ? Ces œuvres qui réélaborent des classiques de la littérature et de la peinture, et sur lesquelles pèse donc un horizon d’attente particulièrement aiguisé, mettent-elles nécessairement en scène un retour réflexif sur leur propre pratique, comme chez Terry Gilliam ? Le Siècle d’or peut-il être un produit culturel de consommation comme les autres ? Géographiquement et historiquement circonscrit, le Siècle d’or peut-il véritablement accéder au rang d’objet populaire ?
Autant de questions auxquelles s’attachent à répondre les auteurs de ce volume — qu’ils soient tous ici chaleureusement remerciés, ainsi que les évaluateurs qui ont pris part à l’élaboration de ce dernier —, réceptacle d’études et d’objets d’études qui se trouvent habituellement éparpillés en divers endroits et limités au champ disciplinaire qui est le leur.
Bonne lecture !
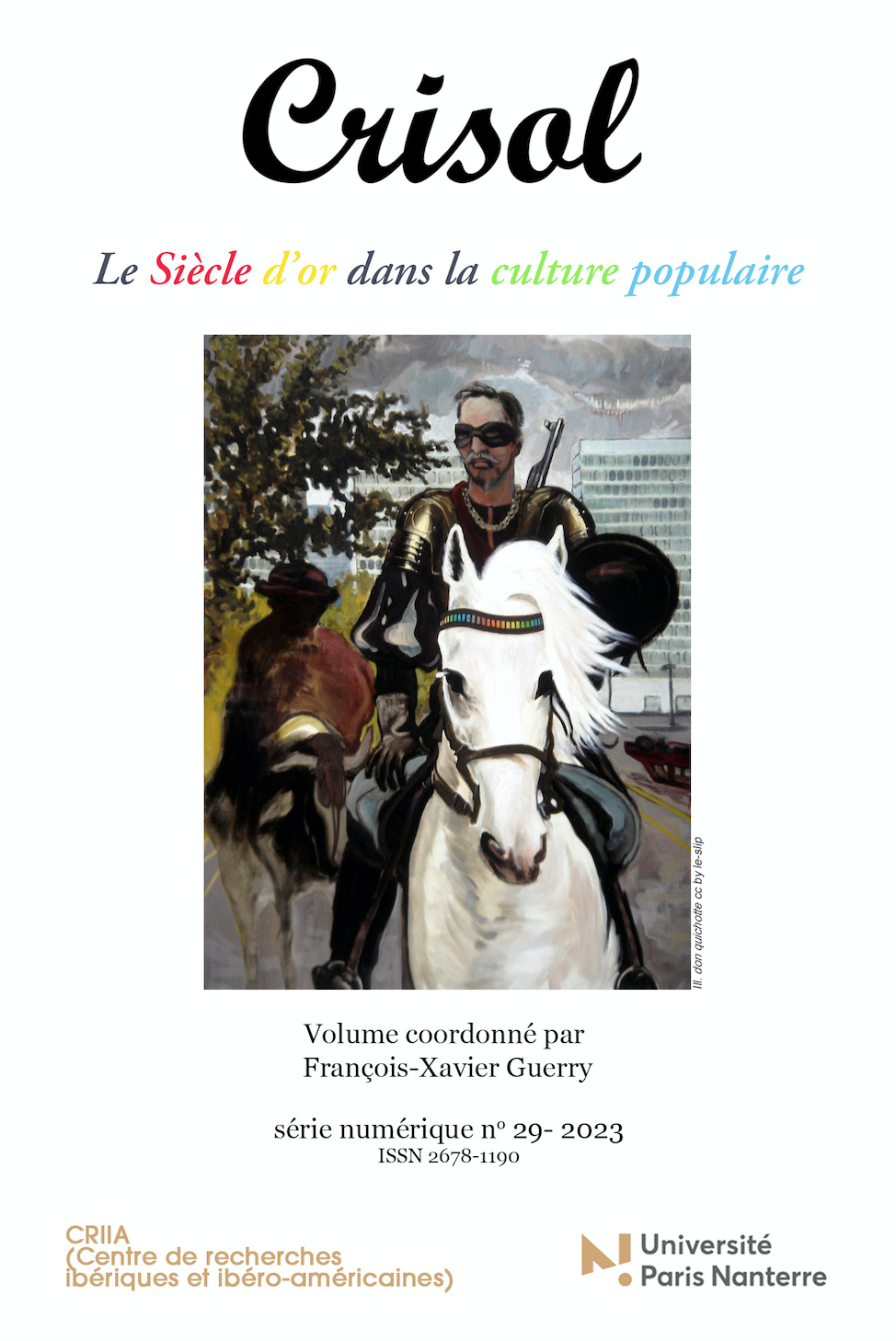
SOMMAIRE
Mercedes Blanco, «Introduction»
Victoria Aranda Arribas, «De gozos y sombras: Tarde llega el desengaño (María de Zayas, 1647) a la luz de José Antonio Páramo (TVE, 1969)».
Anaïs Fabriol, «Voyage vers le Siècle d’or: El Ministerio del Tiempo ou la transfictionnalisation de l’Histoire».
Enrique Fernández, «Una Celestina en la Argelia contemporánea en la película Délice Paloma (2007)»
Eduardo Hernández Cano, «Entre patrias e imperio. Relatos sobre la España áurea en el cómic para durante la democracia (1978-2022)»
Isabelle Touton et Lise Segas, «Poderoso caballero es don Pícaro : l’art de la perspective trompeuse et de la référentialité ingénieuse dans Les Indes Fourbes».
José Manuel López Torán, «El Quijote en la revista ilustrada Puck : del Siglo de Oro español a la edad dorada de la prensa estadounidense (1880-1914)»
Santiago López Navia, «Mortadelo de la Mancha de Francisco Ibáñez (2005): recreación, parodia y homenaje»
José Luis Ocasar Ariza, «La contracultura de los ochenta y el Siglo de Oro. La Movida ante el canon»
Luis Navarrete-Cardero et Antonio Jesús Gil González, «Dialéctica de una oposición. Conexiones hermenéuticas entre Barroco histórico y dispositivo videolúdico»
Soline Martinez et Yann Seyeux, «Velaske, yo soi guapa? Une version trap de Las Meninas»
Citlalli Luna Quintana, «Memes áureos: la emblemática del siglo XXI»
Philippe Denis, «Balenciaga ou la promotion de l’imaginaire pictural du Siècle d’or»
-
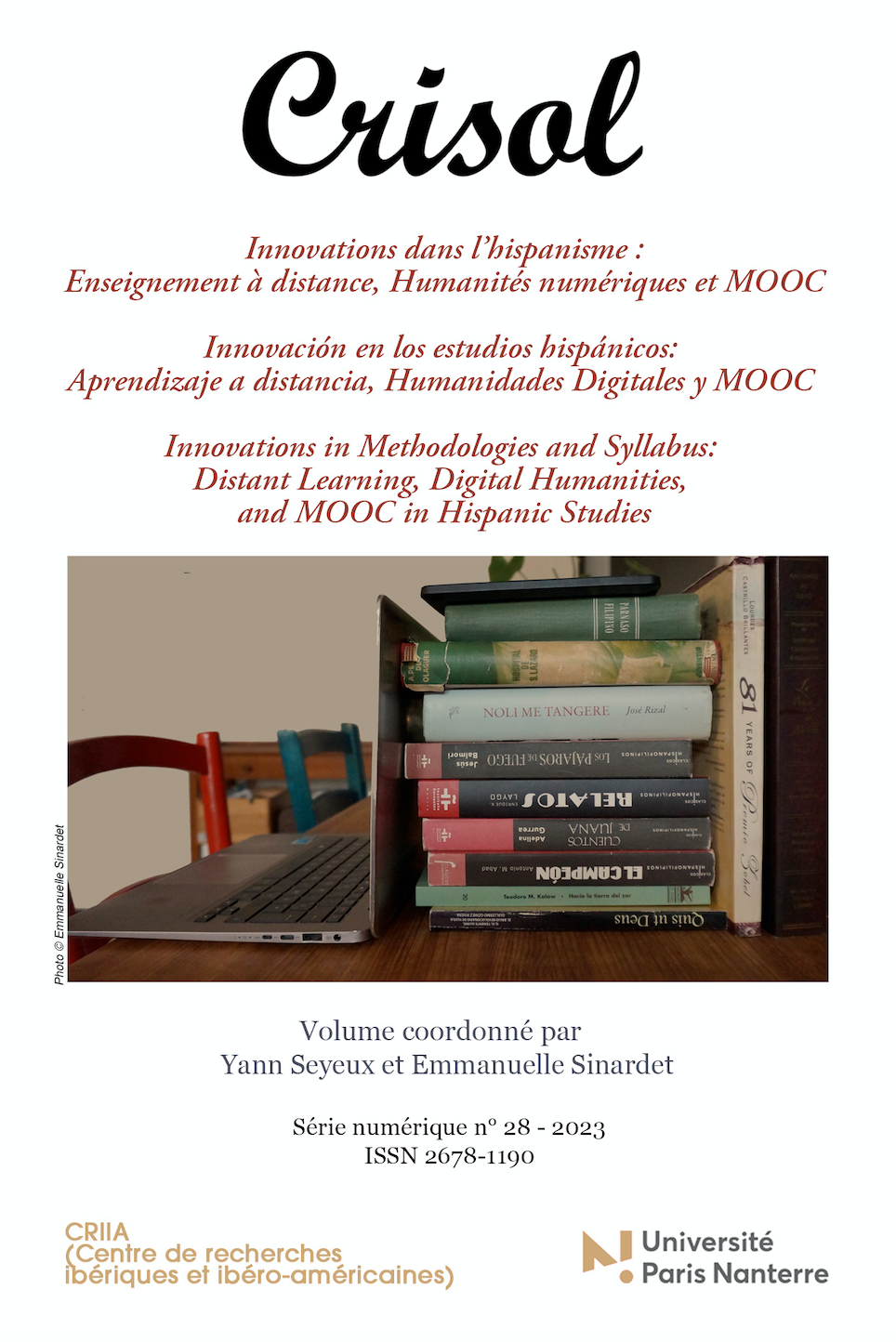
Innovations dans l’hispanisme: Enseignement à distance, Humanités numériques et MOOC/ Innovación en los estudios hispánicos: Aprendizaje a distancia, Humanidades Digitales y MOOC/ Innovations in Methodologies and Syllabus: Distant Learning, Digital Humanities, and MOOC in Hispanic Studies
No 28 (2023)Ce volume propose de réfléchir à un thème que la revue Crisol a peu abordé jusqu'à présent, malgré l’importance croissante de celui-ci dans la vie universitaire, notamment avec la pandémie : l'enseignement à distance. Pourtant, l'innovation pédagogique et scientifique passe aussi par l’usage des technologies numériques. C'est pourquoi nous présentons différents retours d'expériences en matière d’enseignement et de formation à distance, notamment l’apprentissage par les MOOC, à la manière d’un guide des bonnes pratiques, avec une approche concrète.
Ces travaux s’inscrivent dans la réflexion collective du Projet européen Erasmus+ DigiPhiLit Innovations in Methodologies and Syllabus: Digital Humanities and Philippine Literature.
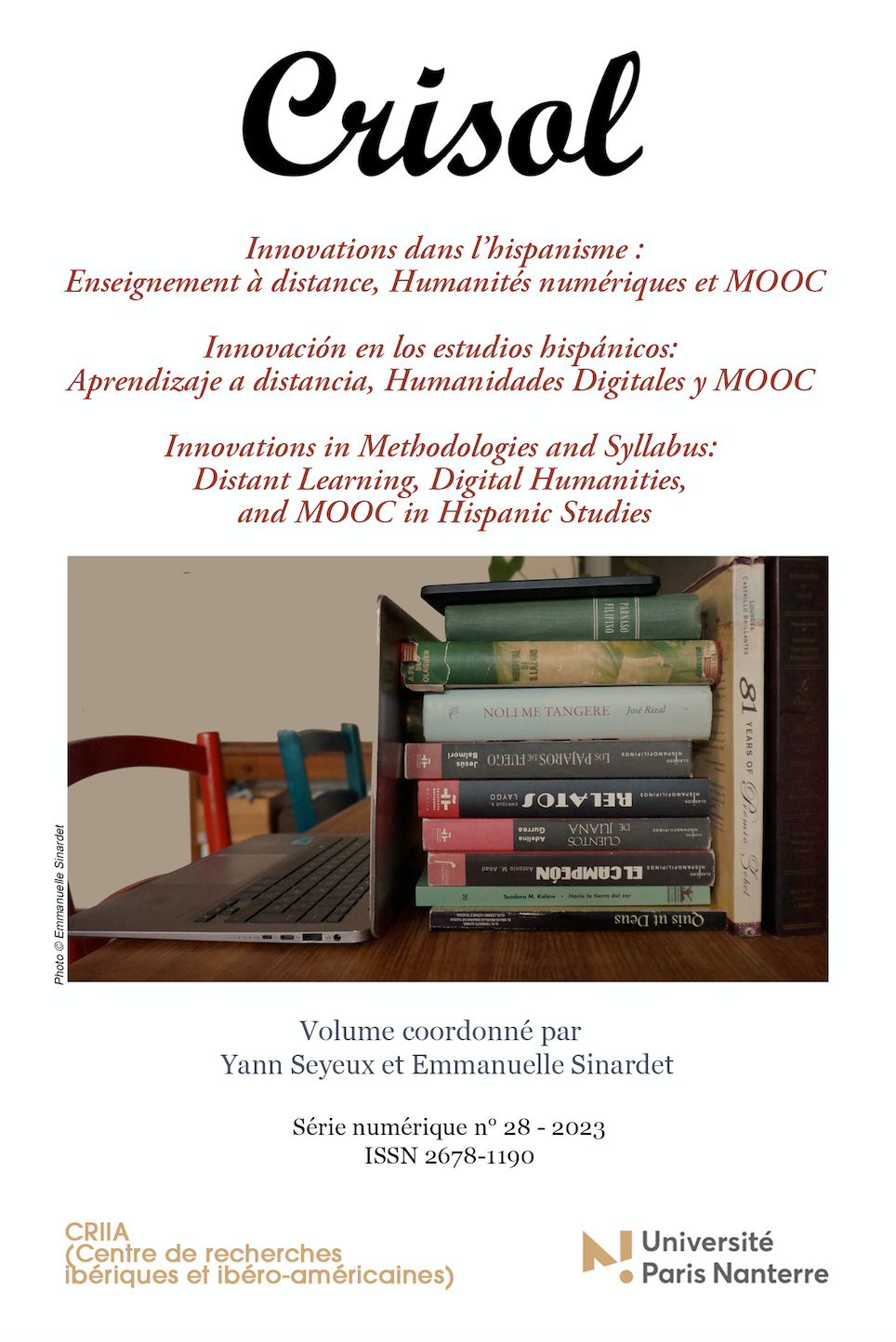
SOMMAIRE
Yann Seyeux, Emmanuelle Sinardet, (Études romanes – CRIIA, Université Paris Nanterre), «Innovación en los estudios hispánicos: Aprendizaje a distancia, Humanidades Digitales y MOOC. Introducción»
1. Educación a distancia: nuevos desafíos pedagógicos
Elaine Walsh (University of Limerick, Ireland), «Harnessing online distance education methodologies to enhance teaching and learning for Literature students»
María Bosch Moreno (CEED Valencia), «Las Humanidades Digitales en la Enseñanza Superior de Grado en España»
2. Buenas prácticas en educación a distancia: dos ejemplos desde las ciencias humanas
Rocío Ortuño Casanova (Universidad de Alcalá, Universiteit Antwerpen), «Zotero en una clase online invertida: una experiencia pedagógica de enseñanza a distancia»
Clara I. Martínez Cantón, Rosa María Aradra Sánchez, Carmen María López López (UNED), «La rúbrica como elemento de formación y de autoevaluación en el comentario de textos literarios. Una experiencia aplicada a la educación a distancia»
3. El MOOC en la educación a distancia: buenas prácticas y recomendaciones
María Sánchez González (Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Málaga), «Les MOOC au service de l’apprentissage de la littérature : expériences récentes et clés de leurs mises en œuvre»
Arnaud Mouzat (Université Clermont Auvergne), «Retour d’expérience sur la création de MOOC à l’Université Clermont Auvergne : quelles étapes et quelle implication des acteurs ?»
Beatriz Álvarez Tardío, Macarena Gil de la Puerta, Ivana Krpan (Universidad Rey Juan Carlos), «Criterios de calidad en la educación a distancia: la evaluación de contenidos audiovisuales»
-
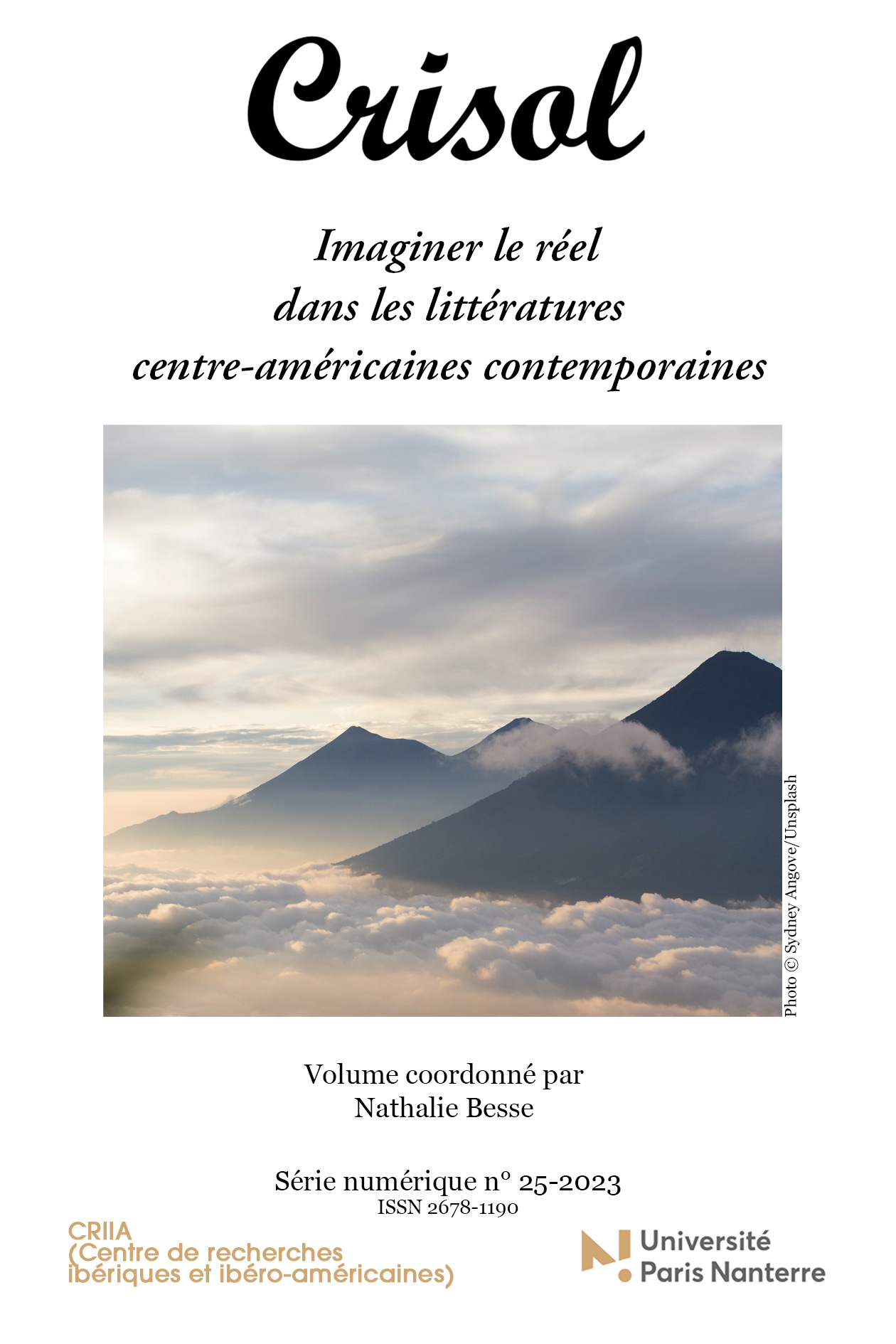
Imaginer le réel dans les littératures centre-américaines contemporaines
No 25 (2023)Ce volume s’intéresse aux réélaborations fictionnelles des réalités centre-américaines dans les littératures contemporaines de l’isthme, à la manière dont les auteurs centre-américains imaginent et resignifient le réel dans leurs écrits. Comment les imaginaires s’articulent-ils avec les diverses réalités qui les inspirent ? Dans quelle mesure ces écrits possèdent-ils une fonction critique, ou de quelle manière se voient-ils traversés par une aspiration axiologique qui ressortirait à une éthique et une implication de l’écrivain alliant liberté et responsabilité ? Selon quelles formes narratives, quels motifs, quelles esthétiques cela se donne-t-il à lire ? Observe-t-on, entre continuité et rupture, des héritages, des emprunts, des innovations et rénovations ?
Le présent volume, décliné en trois volets, propose d’abord une approche rétrospective de ces littératures qui permet d’apprécier des évolutions et des constantes, notamment dans le rapport à l’Histoire. Ce sont d’ailleurs les relations entre fiction et Histoire qui intéressent la deuxième section de ce numéro, dans laquelle dictature et révolution, accords de paix et après-guerre constituent des points saillants. Ceux-ci témoignent d’un lien étroit avec les sociétés plus actuelles, elles-mêmes indissociables des problématiques identitaires, autant de questions sur lesquelles se penchent les études de la dernière partie de ce dossier.
.jpg)
SOMMAIRE
Nathalie Besse (Université de Strasbourg), «Imaginer le réel dans les littératures centre-américaines contemporaines»
1. Entre hier et aujourd’hui, rétrospectives et évolutions
Flora Ovares y Margarita Rojas (UNA - Universidad Costa Rica ), «Ajuste de cuentas con la Historia»
Barbara Dröscher (Freie Universität Berlin), « Plotting women en Centroamérica - Las escritoras, su posición en la literatura y la cuestión de género en el último tercio del siglo XX »
Norbert-Bertrand Barbe (Universidad centroamericana UCA, Managua), «L’expression identitaire dans la littérature nicaraguayenne contemporaine: origines et conséquences – Rapide survol d'une histoire intellectuelle du siècle»
2. Fiction et Histoire
Sergio Villalobos-Ruminott (University of Michigan), «La ficción de lo real: Horacio Castellanos Moya y la pregunta por la historia»
Emiliano Coello Gutiérrez (UNED), « Imaginarios de la revolución en la literatura centroamericana contemporánea: tres novelas disidentes »
Mercedes Seoane (Universidad Nacional de Cordoba, Universidad Nacional Arturo Jauretche), «Los Acuerdos de Paz entre la historia y la ficción: una lectura de Las copas del castigo, de Berné Ayala»
Nathalie Besse (Université de Strasbourg), «Entre réel et imaginaire, jeux de miroirs et enjeux romanesques dans les romans de José Adiak Montoya»
3. Fiction, sociétés et identités
Magdalena Perkowska (Hunter College et The Graduate Center, CUNY), «El presente histórico y la estética del impasse en El hombre amansado de Horacio Castellanos Moya»
Claudia Panameño (Université de Lille, Université Bretagne Sud), «“Lo descubrí mirándome de nuevo”. La sociedad hipervigilada en Moronga de Horacio Castellanos Moya»
Julio Zarate (Université Savoie Mont Blanc), «Realidades enfrentadas: la lucha por la tierra en El país de Toó de Rodrigo Rey Rosa»
Águeda Chávez García (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), «Comida y bebida del pueblo de tradición lenca: Un asunto de identidad en La guerra mortal de los sentidos de Roberto Castillo»
Carlos M-Castro (Investigador independiente), «Ficciones nicaragüenses ultracontemporáneas: una presentación. Donde abunda la muerte: transgresiones a lo real en la ficción novosecular nicaragüense»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
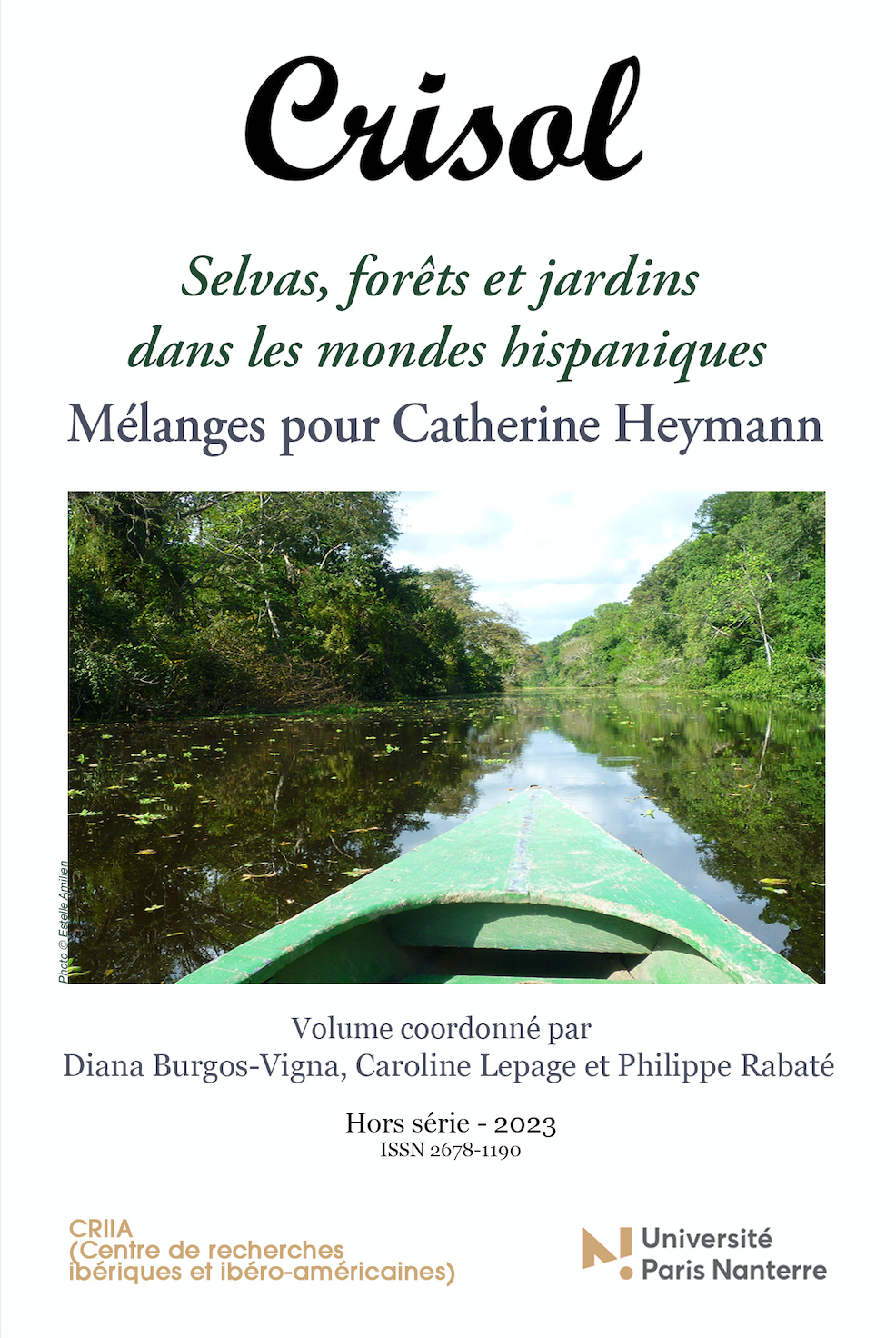
Hommage à Catherine Heymann
No HS (2023)Ce dossier sur «selvas, forêts et jardins dans les mondes hispaniques» rend hommage à Catherine Heymann, hispaniste, latino-américaniste et grande amoureuse de la nature. Il réunit des contributions issues d’approches scientifiques diverses. Uni.es par un intérêt commun pour les liens entre nature et sociétés, mais surtout par leur reconnaissance et leur attachement à Catherine et le respect de son travail, les autrices et auteurs construisent un numéro articulé autour de trois axes: la nature dans les Arts visuels, la nature comme enjeu social, politique et identitaire dans le monde hispanique et, enfin, les représentations littéraires des éléments naturels.
C’est avec joie, affection et respect que nous offrons ces mélanges à l’esprit vif et itinérant de Catherine et que nous l’invitons ainsi à quelques pérégrinations silvestres.
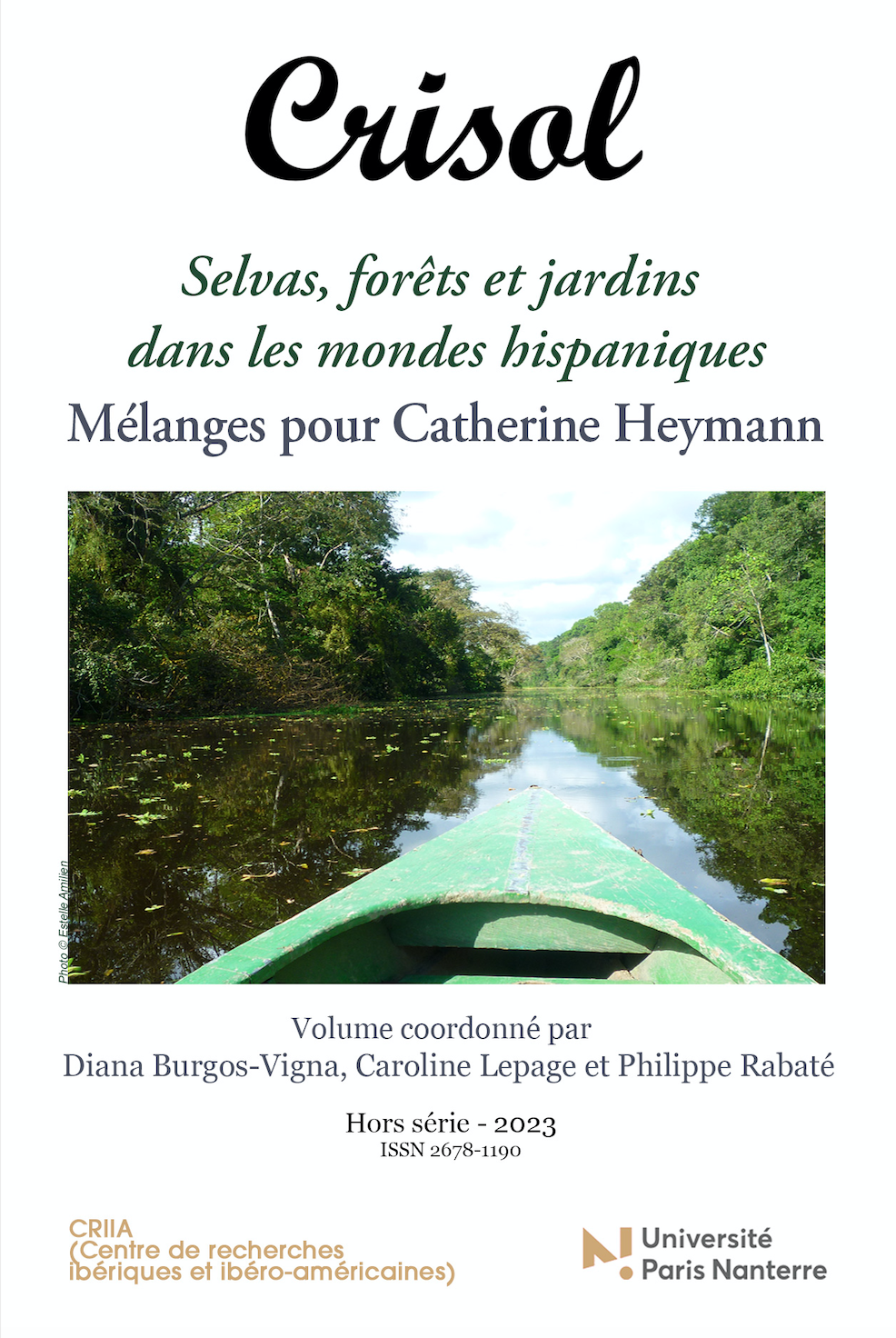
SOMMAIRE
Diana Burgos-Vigna, Caroline Lepage, Philippe Rabaté
Préface, «Catherine Heymann, une hispaniste en Amazonie»Bernard Darbord, Alexandra Oddo
«Le signe linguistique et son extension : ‘forêt’ et ‘bois’ en français, bosque, selva et monte en espagnol»1. En guise de préambule: textes d’autrices
Laurence Breysse-Chanet
«Pour K.»Silvia Contarini
«Sous le pin de Grazia Deledda»Nathalie Lalisse-Delcourt
«AvaGala»Modesta Suárez
«Lisières»2. La nature dans les Arts visuels en Amérique latine et en Espagne
Estelle Amilien
«K Austin en Amazonie: une réécriture contemporaine du mythe d'Eldorado»Thibaut Cadiou
«Représentations de cultures en mouvement: la peinture amazonienne contemporaine
Migrations et transformations, le cas des shipibo-conibo à Lima»Jean-Pierre Chaumeil
«Le photographe et le sauvage – Les premiers clichés de Kroehle en Amazonie péruvienne»Paola García
«El Lago Atitlán y su representación pictórica»Emmanuelle Sinardet
«Du lieu au territoire : artialisation de la selva dans la peinture de Rafael Troya (1845-1920)»Mercé Pujol Berché
«El modernismo de Gaudí : la naturaleza (jardines y bosques) hecha arte»3. La nature comme enjeu social, politique et identitaire dans le monde hispanique
Miguel Rodríguez
«Chapultepec, cerro de chapulines»Louise Benat-Tachot
«L’affaire des épices en Castille 1490-1580. La cannelle et el ají : les improbables épices américaines»Marie Lecouvey
«Les arbres de Mexico, porteurs de mémoire et d’espoir»Alvar De La LLosa
«De l’Éden amazonien au jardin du diable, regards des diplomates français en poste à Lima face à la crise de l’Orient péruvien et à la montée des revendications indigènes et ouvrières (1912-1923)»Morgana Herrera
«Dos escritores de la Selva en el Primer encuentro de narradores peruanos de 1965: Francisco Izquierdo Ríos y Arturo D. Hernández representantes de lo amazónico en Arequipa»Dalila Chine Lehmann
«Les trésors cachés du Mexique. La nature au service de la construction d’un imaginaire national»4. Représentations littéraires des éléments naturels
David Barreiro Jiménez
«Relecturas de la novela La serpiente de oro de Ciro Alegría: el espacio natural entre cohabitación y enfrentamiento»Raúl Caplán
«Humanimalidad: lectura ecocrítica de Alrededor de la jaula de Haroldo Conti»Enrique Fernández Domingo
«Paisaje y “otredad” del Perú de finales de la década de 1870 en el relato de viaje de Charles Wiener»Luis González Fernández
«De árboles y bosques septentrionales : una idea del Norte en el Jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada»Lina Iglesias
«Jardin, forêt, poème: les lieux d’une habitation poétique, dans l’œuvre d’Olvido García Valdés»Claude Le Bigot
«Paysage, histoire et écriture dans le Chant général de Pablo Neruda»Daniel Lecler, Claudine Marion-Andrès
«El sueño de lo invisible en “La naturaleza” de Luis Cernuda»Béatrice Ménard
«¡Árboles! ¡Árboles! ¡Árboles!” La representación de la selva en Canaima de Rómulo Gallegos (1935)»Jean-Claude Rabaté
«Martín Fierro et Unamuno (De la Pampa aux campagnes de Salamanque)»Isabelle Tauzin-Castellanos
«José T. Torres Lara, Joaquín Capelo, Olivier Ordinaire, Antonio Raimondi : révision de sources oubliées sur l’accès à l’Amazonie péruvienne»Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
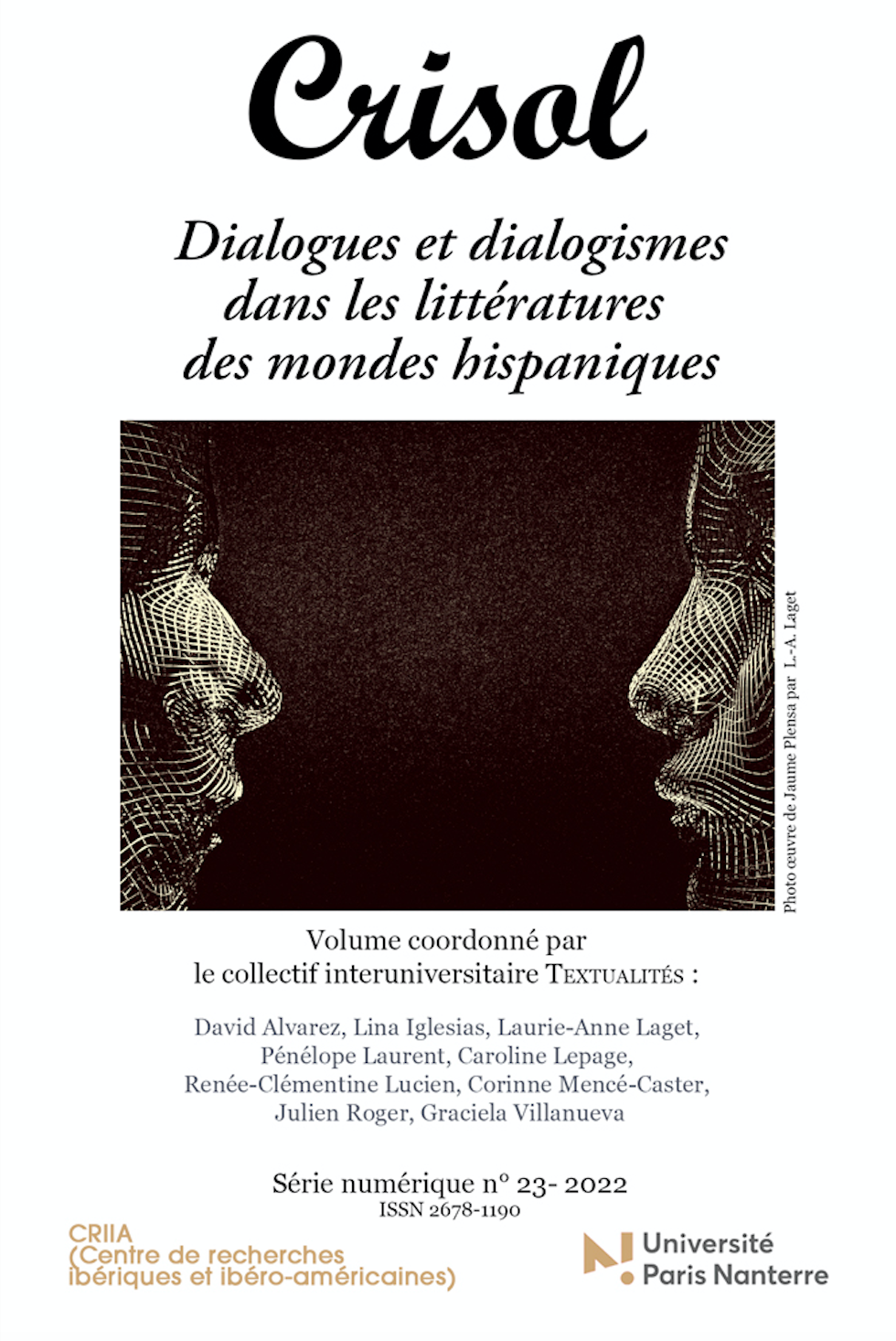
Dialogues et dialogismes dans les littératures des mondes hispaniques
No 23 (2022)L'objectif de ce numéro de la revue Crisol est d'étudier les rapports entre la dimension dialogique de la textualité et sa dimension dialogale. Le dialogisme, une notion voisine de celles de polyphonie, plurivocité, plurivocalité et de leurs multiples déclinaisons transtextuelles, se manifeste souvent dans un dialogue réel (entre écrivains, entre écrivains et traducteurs, entre écrivains et critiques, entre écrivains et lecteurs) ou dans un dialogue fictionnel (oral ou épistolaire) théâtral, narratif ou poétique. L'étude des dialogues qui mélangent différentes langues, dialectes et registres ou des dialogues qui mettent en avant l'oralité constitue le cœur de plurieurs travaux. D'autres proposent des réflexions sur cet autre dialogue, plus métaphorique, entre la littérature et différents arts (musique, arts visuels, bande dessinée, cinéma) et prennent en compte la dimension intermédiale, interdiscursive ou intersémiotique de leur corpus, souvent imbriquée avec une dimension dialogale. Toutes ces approches s'articulent autour d'une réflexion sur la manière dont la littérature crée un jeu dialogique avec le soubassement doxique des discours sociaux ; un jeu visant souvent à mettre en question les topoï, les orientations argumentatives sous-jacentes, les connotations valoratives implicites dans les mots, les thématiques, les motifs, les stéréotypes et les conventions qui construisent la doxa d'une langue, d'une tradition et d'une culture.
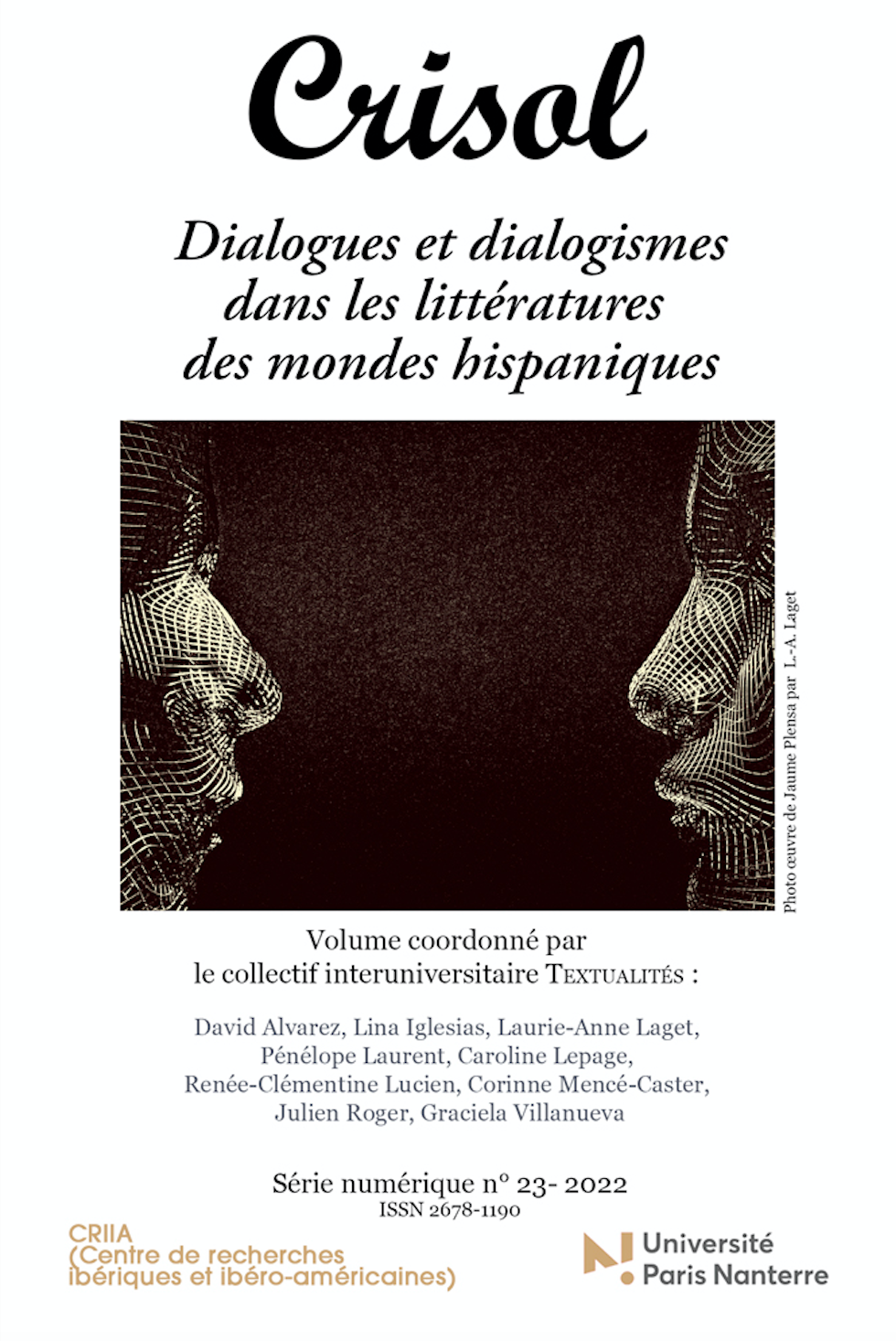
SOMMAIRE
Introduction
Graciela Villanueva (Université Paris-Est Créteil, IMAGER (UR 3958)
1. Enjeux théoriques du dialogisme
Rafaèle Audoubert (Université Jean Monnet, Université de Lyon, Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités), «Cerner la parole ? Approche définitionnelle pour l’étude des voix dialogales et dialogiques dans les littératures des mondes hispaniques»
2. Apports critiques
Enjeux stratégiques du dialogisme
Pénélope Cartelet (Univ. Lille, ULR 4074 - CECILLE - Centre d’Études en Civilisations Langues et Lettres Étrangères), «Le(s) dialogue(s) dans le Conde Lucanor de Don Juan Manuel: de la manera à la materia»
Corinne Mencé-Caster (Sorbonne Université), «XVIe siècle: dialogues et dialogisme dans El diálogo de la lengua de Juan de Valdés»
Carole Fillière (lla creatis – ut2j ), «Dialogisme et retraduction des poèmes en prose de Federico García Lorca»
Graciela Villanueva (Université Paris-Est Créteil, IMAGER (UR 3958), «Cuando el extranjero toma la palabra»
Salomé Dahan (IMAGER (UPEC), «Dialogues sur/dans Buenos Aires dans la littérature argentine contemporaine»
L'inévitable dialogisme de la création
Clémentine Lucien (Sorbonne Université-Faculté des Lettres CRIMIC-EA 2561, GRIAHAL), «Dialogisme, polyphonie et stratégie dialogale dans l’essai Dame el siete, tebano, la prosa de Antón Arrufat, de Margarita Mateo Palmer»
Claudie Terrasson (LISAA-EMHIS (EA 4120)), «Natalia Sosa: un dialogue entre confidence, réflexivité et dérobade»
Sandra Gondouin (Université de Rouen Normandie – ERIAC / CRIIA), «Parle-t-on jamais seul? Dialogues et dialogisme dans Hablar solos (2012) d’Andrés Neuman»
Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes ILCEA4 ), «Actos de resistencia contra la muerte d’Angélica Liddell: un nouveau dialogisme théâtral»
3. Le dialogisme vu par les traducteurs et les auteurs
Laura Alcoba, «Entretien avec la traductrice Laura Alcoba»
Véronique Béghain, «La traductrice qui entendait des voix»
Jean Canavaggio, «Entretien avec un traducteur de Don Quichotte»
Thierry Davo, « Entretien avec le traducteur Thierry Davo»
Jocelyn Dupont, «Entretien avec le traducteur Jocelyn Dupont»
François-Michel Durazzo, «L'écriture des dialogues: traduction, transposition ou recréation?»
Corinna Gepner, «Traduire en sympathie»
Laurence Kiefé, «Entretien avec la traductrice Laurence Kiefé»
Caroline Lepage, «Enjeux, difficultés et joies de la traduction des dialogues et des dialogismes»
Diane Meur, «“Mettez-vous à leur place!”»
Monique Michaud, «Entretien avec la traductrice Monique Michaud»
Christophe Mileschi, «Entretien avec le traducteur Christophe Mileschi»
Rosie Pinhas-Delpuech, «Entretien avec la traductrice Rosie Pinhas-Delpuech»
Renée-Clémentine Lucien Sorbonne (Université-Faculté des Lettres CRIMIC-EA 2561, GRIAHAL), «Entrevista a Abilio Estévez»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
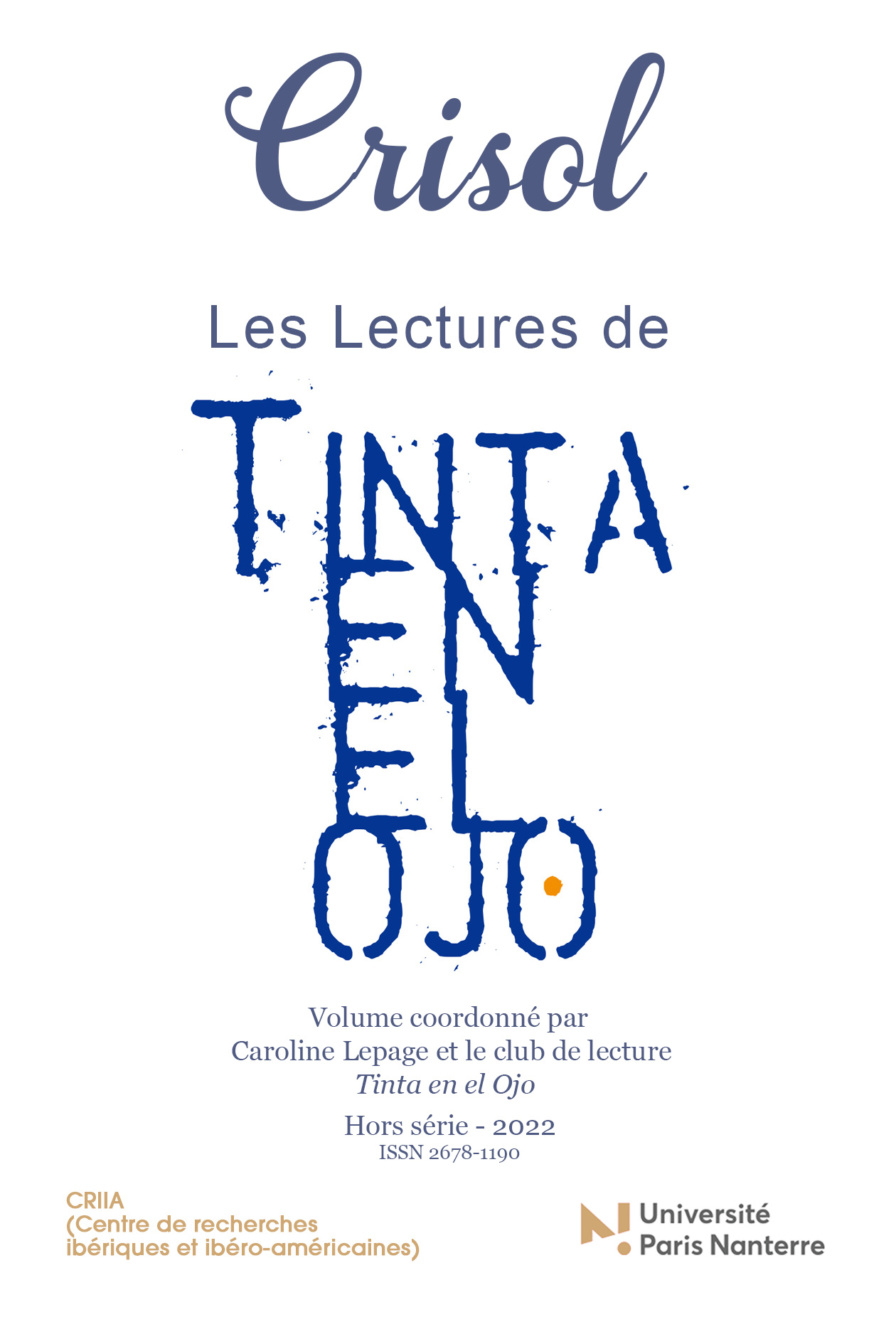
Les lectures de Tinta en el ojo
No HS (2022)La vocation de ce Hors série de Crisol est de recueillir les échanges du Club de lecture Tinta en el ojo, qui rassemble, une fois par mois, une vingtaine d'enseignants-chercheurs, de docteur·e·s, de doctorant·e·s et détudiant·e·s du Master Études Romanes de l'Université Paris Nanterre pour discuter de littérature autrement que depuis une perspective strictement universitaire. Que cela est difficile! Il y a effectivement là pour nous tout un processus de désapprentissage et de réapprentissage –également à la base de la décision de monter ce groupe. C'est donc en simples lectrices et lecteurs ou en simples lectrices et lecteurs engagé·e·s dans une sorte de “rééducation” que nous vous donnerons nos impressions et nos avis, absolument subjectifs et assumés comme tels, sur les livres que nous aurons choisis de lire et de commenter.
Jusqu'à récemment, nous nous sommes efforcé.es d'écrire nos compte-rendus (qui deviennent progressivement des articles scientifiques à part entière) tantôt en français, tantôt en espagnol. Et nous avons finalement décidé d'en faire une traduction systématique pour qu'ils soient disponibles dans les deux langues. Nous rattrapons progressivement notre retard pour les 16 déjà en ligne.
Bonne lecture de nos lectures!
***
Este número especial de Crisol tiene por objeto compilar los intercambios del club de lectura Tinta en el ojo, que una vez al mes reúne a profesores, doctores, doctorandos y estudiantes del Máster de Estudios Románicos de la Universidad Paris Nanterre para debatir sobre literatura, pero desde una perspectiva distinta a la académica. ¡Y cuán difícil es! Efectivamente, esto nos demanda pasar por un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje, lo cual es además el fundamento de la creación de este grupo. Es así como, en tanto simples lectores o simples lectores comprometidos con una especie de “reeducación”, daremos nuestras impresiones y opiniones, absolutamente subjetivas y asumidas como tales, sobre los libros que hemos elegido para leer y comentar.
¡Buena lectura de nuestras lecturas!
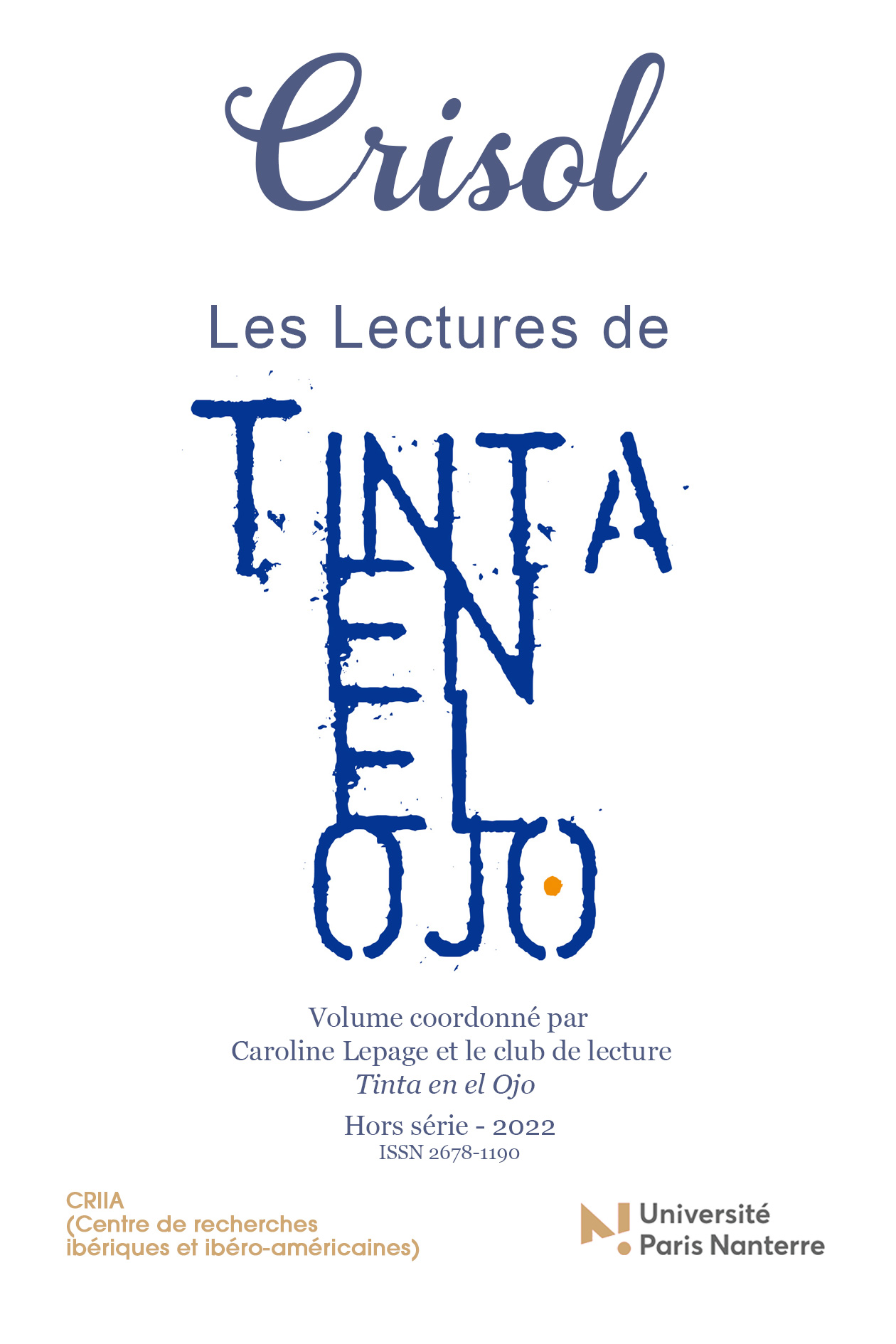
SOMMAIRE
«Rojo y negro, los colores de la ceguera en Sangre en el ojo de Lina Meruane», David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Elena Geneau (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH)
«De l’horizon d’attentes au contrat d’exigences du lecteur: le cas de La hija única de Guadalupe»/ «Del panorama de expectativas al contrato deexigencias del lector: el caso de La hija única deGuadalupe Nettel», Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université-CRIMIC), Caroline Lepage (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH)
«La tristesse excitante d’une femme brisée: Matate, amor, Ariana Harwicz, 2012», David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre - CRIIA/HLH), Elena Geneau (Université Paris Nanterre - CRIIA/HLH) Diana Gil Herrero (Université Paris Nanterre - CRIIA/HLH), Caroline Lepage (Université Paris Nanterre - CRIIA/HLH)
«La humareda de la impunidad – Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enriquez (2016)», Elena Geneau (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Julia De Ípola (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Marisol Martini (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH) Sheila Siguero Université (Paris Nanterre – CRIIA-HLH)
«Cadáver exquisito (Agustina Bazterrica), «Una cruda distopía del presente», Elsa Fernández (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Elena Geneau (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Liliana Riaboff (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH)
«Historia del llanto de Alan Pauls: prueba de hermeticidad para el testimonio», Julia De Ípola (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH), Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre – CRIIA-HLH)
«Coyhaiqueer de Ivonne Coñuecar: ¿la primera novela homoerótica patagónica?», Caroline Lepage (Université Paris Nanterre – CRIIA/HLH), Sophie Marty (Université d'Orléans), Liliana Riaboff (Université Paris Nanterre – CRIIA / HLH)
«Los abismos (2021) de Pilar Quintana: la constante propensión al vacío», David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre / CRIIA – HLH), Elena Geneau (Université Paris Nanterre / CRIIA – HLH), Liliana Riaboff (Université Paris Nanterre / CRIIA – HLH)
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre/ CRIIA – HLH), Elena Geneau (Université Paris Nanterre/ CRIIA – HLH), Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre/ CRIIA – HLH) Sophie Marty (Université d'Orléans), Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre/ CRIIA – HLH), «Señales que precederán al fin del mundo (2009), Yuri Herrera»
Elena Geneau Université (Paris Nanterre), Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre), Sophie Marty (Université d'Orléans), Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre), «Desenterrando el lenguaje de La sed (2020), de Marina Yuszczuk»
Émilie Boyer (Université de Poitiers), Elena Geneau (Université Paris Nanterre), Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre), Sophie Marty (Université d'Orléans), «Tikal Futura (2012) : patchwork futuriste du chaos avant l’apocalypse»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), Elena Geneau (Université Paris Nanterre), Julia de Ípola (Université Paris Nanterre), Nieves Macías (Université Paris Nanterre), «Una mirada hacia los Cielos de Córdoba, de Federico Falco»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), «Dans les fractures de Fractura (2018), d'Andrés Neuman»
Julia de Ípola (Université Paris Nanterre), Sophie Marty (Université d'Orléans), Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre), «Las malas (2019), Camila Sosa Villada»
Sophie Marty (Université d'Orléans), Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre), «L’horreur de mère en fille: Mandíbula, de Mónica Ojeda»
Sheila Siguero (Université Paris Nanterre), «Nueve comentarios sobre Temporada de huracanes de Fernanda Melchor »
Tafarel Ramos Lara (Université Paris Nanterre), «Una novela criminal, de Jorge Volpi»
Sophie Marty (Université d'Orléans) et Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre), «La música va por dentro: El rastro, de Margo Glantz (2002)»
Julia de Ípola (Université Paris Nanterre / CRIIA), «La plume et les plumes: Las aventuras de la China Iron (2017), de Gabriela Cabezón Cámara»
Liliana Riaboff (Université Paris Nanterre), «El desencanto de lo cotidiano en Qué vergüenza de Paulina Flores»
Daniella Prieto (Cornell University), «La violencia de Esta herida llena de peces (Lorena Salazar Masso)»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
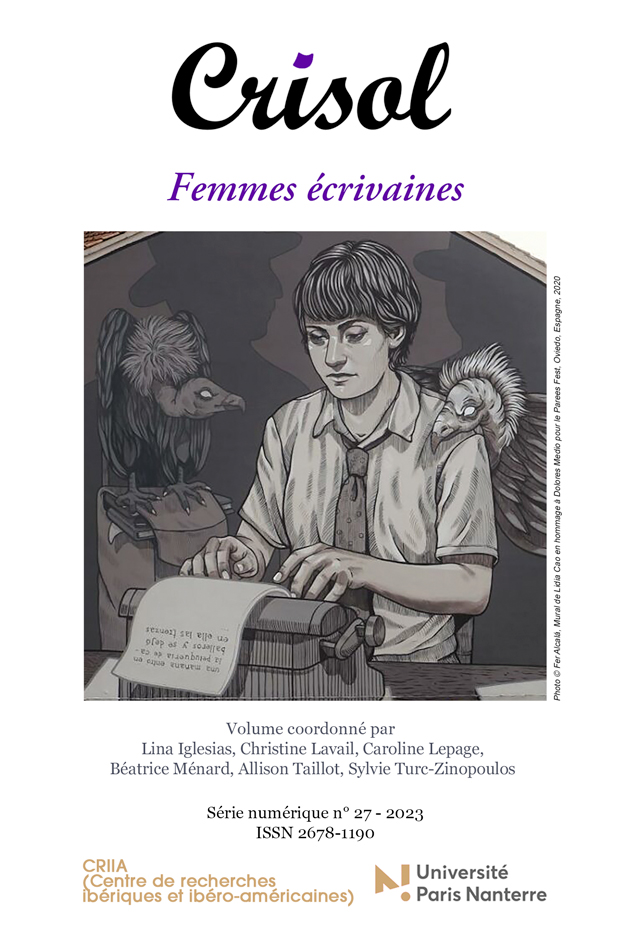
Femmes écrivaines
No 27 (2023)Les 13 septembre et 4 octobre 2021, le groupe Horizons des Littératures Hispaniques et l’Atelier sur l’Histoire des Femmes dans l'Aire Hispanique Contemporaine s’associaient pour l’organisation, à l’Université Paris Nanterre, sous la houlette du Centre de Recherche Ibériques et Ibéro-Américaines, de deux journées d’étude consacrées aux femmes écrivaines en Espagne et en Amérique latine contemporaines. Au-delà des sempiternelles interrogations sur l’existence ou non d’une écriture proprement féminine ou de spécificités thématiques, techniques, voire stylistiques, propres à l’écriture des femmes – nous souhaitions partiellement laisser ces débats et autres polémiques derrière nous –, il s’agissait pour nous, tout simplement, de réunir des chercheuses et des chercheurs de nos domaines, en l’occurrence l’histoire et la littérature hispaniques et ibéro-américaines, pour évoquer des parcours de femmes, ordinaires ou extraordinaires, ayant pris la plume comme on s’installe à une tribune pour se dire elles-mêmes, parfois pour s’afficher et se revendiquer elles-mêmes, dans leurs mondes intimes, dans le monde, et dire le monde dans ses rapports avec elles. Cela donne une traversée qui nous mène de l’Espagne et du Pérou du 19e siècle à l’Espagne, à la Porto Rico, au Guatemala, à l’Argentine, à la Cuba, à la Colombie et à l’Espagne des 20e et 21e siècles ; 13 articles qui nous conduisent vers des horizons qui divergent dans les évidences, purement circonstancielles (liées au temps de l’écriture et de la réception), mais convergent en des points de jonction plus inattendus et qui, nous l’espérons, décaleront la réflexion que l’on peut faire quand on lit ce que les femmes ont à écrire… veulent écrire.
Pour ouvrir la voie, Sheila Siguero pose en quelque sorte un cadre à nos échanges en s’appuyant sur le cas de l’Argentine Mariana Enríquez (1973) afin de revenir sur la place que la critique donne et sur le rôle qu’elle a coutume de donner et d’attribuer / concéder à la polémique « question du genre » dans son analyse et son évaluation de la littérature des femmes, tantôt pour mieux les invisibiliser, tantôt, au contraire, pour les sur-exposer dans la lumière d’une pseudo identité femme qui réduit considérablement la portée de leur œuvre et des discours qu’elle porte.
Le premier axe de ce numéro, «Femmes écrivaines et société», privilégie la transversalité en réunissant des articles qui nous entraînent dans un va-et-vient entre l’Espagne et l’Amérique latine, de la fin du 19e au seuil du 21e siècle. Il réunit des autrices qui bousculent l'ordre social, dénoncent les injustices et les oppressions de toutes sortes, remettent en question le rôle qu'on leur assigne, voire franchissent la ligne rouge. Ainsi, Sylvie Turc-Zinopoulos présente une lecture de la pièce El padre Juan (1891) à la lumière du manuel de conduite érigé en modèle par la littérature édifiante en vigueur que la dramaturge espagnole Rosario de Acuña (1850-1923) détourne pour en faire un manuel de combat destructeur à la gloire de “la femme du futur”. À la même époque, au Pérou, l'écrivaine Clorinda Matto de Turner (1852-1908) publie son œuvre romanesque – Aves sin nido (1889), Índole (1891) et Herencia (1895) – dont le caractère pionnier dans l'apparition de l'indigénisme littéraire est souligné par Béatrice Ménard qui se penche également, dans les œuvres citées, sur la dénonciation des agissements de l'Église et la place fondamentale accordée à l'éducation de la femme péruvienne. Revenant en Espagne, Christian Boyer montre comment Emilia Pardo Bazán (1851-1921) s'impose sur la scène littéraire – essentiellement masculine à cette époque – avec des récits courts originaux à la rhétorique faite de sang et de brutalité qui évoquent les lointains horizons d'un Orient imaginaire ou fantasmé. Progressant dans le temps, nous passons au 20e siècle, sous la dictature franquiste, avec Claire Laguian qui s'intéresse à la réversibilité du motif de l'insularité dans une approche croisée des poèmes de Gloria Fuertes (1917-1998) et de Natalia Sosa (1938-2000) qui soulèvent la question du lesbianisme et de la difficulté à être écrivaine à cette époque en Espagne. Pour finir, en compagnie de Sophie Large, nous arrivons au début du 21e siècle et repartons en Amérique latine dans une étude comparée de Fe en disfraz de Mayra Santos-Febres (1966) et Diosa decadentes de Jessica Masaya Portocarrero (1972), romans dont le choix de la voix narrative masculine misogyne pose question dans le cadre d'un projet d'écriture féministe.
Le deuxième axe, « Femmes écrivaines et violences », réunit trois études qui abordent un sujet sensible d’une actualité toujours dramatique, sous des angles différents mais complémentaires. Qu’elle soit morale, sociale, économique ou psychologique, la violence faite aux femmes se manifeste le plus souvent sur leur corps, considéré comme objet à posséder et à soumettre. Si les atteintes au corps féminin rendent visibles, par les traces laissées, une forme de domination masculine, elles sont aussi l’expression d’une volonté de destruction et d’anéantissement de l’Autre, comme en témoigne la liste sans fin des féminicides. Dans la mesure où elles sont écrites par des femmes, les œuvres analysées dans cette section posent la question de l’expression d’un vécu intime, associée à une dénonciation : par leur diversité générique – poésie, théâtre, roman –, et par leur variété géographique – Espagne, Mexique, Argentine –, les trois contributions examinent les différentes modalités de dire et de montrer la violence, ainsi que les formes de résistance qu’elles sous-tendent. Lina Iglesias propose une lecture de la poésie d’Isabel Pérez Montalbán (Cordoue, 1964), et en particulier de son dernier recueil Vikinga (2020), en montrant comment le sujet poétique, à partir des atteintes sociales et physiques subies depuis l’enfance, se construit en résistance contre la société. Le poème se présente alors comme le lieu d’une diction sensible qui fait affleurer un douloureux vécu personnel à partir duquel est abordée la question d’un sujet féminin. Les deux articles suivants s’articulent autour du terme récent de féminicide. Ainsi, Laurent Gallardo analyse la pièce de théâtre La casa de la fuerza, dernier volet de la tétralogie du sang, écrite par Angélica Liddell (1966), qui, entre performance et théâtre, explore les limites du représentable. En mettant en scène les disparitions et assassinats de femmes qui ont lieu, depuis de nombreuses années, à Ciudad Juárez (Mexique), la dramaturge cherche à rendre visible l’invivable, construisant ainsi un contre-discours, à la fois sensible et politique. Portée par une puissante poétique scénique, la mise en scène devient un événement théâtral qui interpelle et dénonce sans compromis. Quant à Paula Klein, elle se penche sur deux romans argentins contemporains aux titres significatifs : Chicas muertas, de Selva Almada (1973), publié en 2014, et Aparecida, de 2015, écrit par Marta Dillon (1966). À partir d’une perspective féministe, ces autrices reviennent sur les féminicides et les disparitions sous la dictature militaire argentine, en mettant au jour la violence de genre. Les crimes donnent lieu à des enquêtes qui mêlent, dans le roman, fiction et documents d’archives ; en interrogeant le statut de l’écrivaine-enquêtrice comme nouvelle figure de la littérature, Paula Klein montre les modalités d’un dispositif de dénonciation.
Le troisième axe de ce volume, intitulé « Femmes écrivaines et médias », explore la relation que les femmes écrivaines entretiennent avec les médias depuis le premier tiers du 20e siècle. Tout en privilégiant là encore la transversalité, elle réunit des travaux qui s’intéressent aux productions médiatiques et médiatisées des femmes écrivaines et interrogent les motivations, les formes et les enjeux de ces prises de parole et de position qui ouvrent à la question de la femme écrivaine comme personnage public. Manuelle Peloille revient sur l’une des pionnières du journalisme en Espagne, Sofía Casanova (1861-1958). Elle s’intéresse plus particulièrement aux écrits que cette dernière produisit en lien avec son expérience de la Première Guerre mondiale et de la Révolution bolchevique. À travers la mise en regard des chroniques publiées par la correspondante de guerre dans le journal madrilène ABC et de son « roman de poupée » Viajes y aventuras de una muñequita española en Rusia (1920), elle met au jour les deux stratégies à l’œuvre dans cette mise en mots de l’expérience vécue. C’est également le caractère précurseur des écrits journalistiques de Magda Donato (Carmen Eva Nelken, 1868-1966) que met en évidence Rocío González Naranjo. En s’appuyant sur 3 reportages parus dans Ahora entre 1932 et 1935, elle montre en quoi cette figure encore largement méconnue mais représentative d’un « mouvement de femmes républicaines » peut être considérée comme la pionnière du periodismo gonzo en Espagne, quelques 40 ans avant l’apparition de ce journalisme d’infiltration aux États-Unis. Enfin, prolongeant la réflexion jusqu’à l’époque actuelle et aux nouvelles technologies de la création et de la communication, Caroline Lepage s’intéresse au blog de Zoé Valdés (1959) : zoevaldes.net. Sur la base d’une analyse minutieuse des posts qui y ont été publiés depuis 2008, elle présente une facette peu connue de l’écrivaine cubaine, celle de la « lectrice-écrivaine » dont elle examine la complexité en termes d’auto-figuration et d’auto-discours auctorial.
Pour fermer le ban, Yann Seyeux s’est intéressé, dans un quatrième axe intitulé « Femmes écrivaines et littératures numériques », à ce que l’on pourrait désigner sous l’étiquette de littérature mutante ou, en l’occurrence, de littérature 2.0, quand le littéraire échappe aux frontières sacralisées du livre papier et s’engage dans des expériences depuis ce qu’il faut bien voir ici comme une forme extrême de transtextualité ; la Colombienne Alejandra Jaramillo Morales (1971) a en effet eu recours aux outils technologiques pour relire-réécrire Rayuela, de Julio Cortázar, l’une des grandes et plus échevelées aventures expérimentales de littérature du 20e siècle… ouvrant ainsi un dialogue d’auteurs sur les formes et les formats de la littérature.
Bonne lecture à toutes et tous !
Lina Iglesias, Caroline Lepage, Béatrice Ménard, Allison Taillot, Sylvie Turc-Zinopoulos
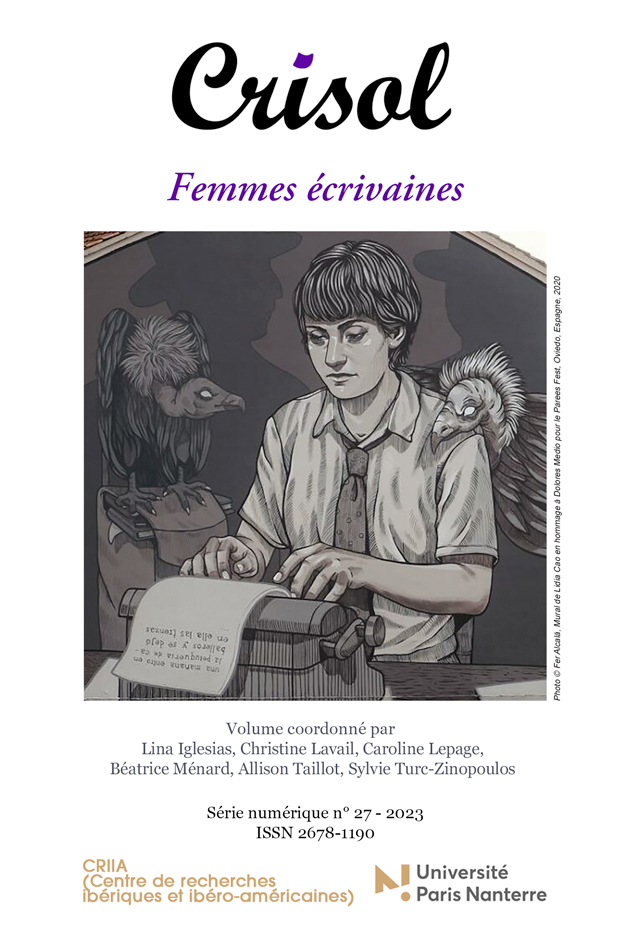
SOMMAIRE
Sheila Siguero (Horizons des Littératures Hispaniques), «Escritura o mujer: el malestar del posicionamiento»
Partie 1 – Femmes écrivaines et société
Sylvie Turc-Zinopoulos (Université Paris Nanterre – UR Études Romanes / CRIIA), «Aproximación a El padre Juan (1891) de Rosario de Acuña desde el manual de conducta de la literatura de la domesticidad»
Béatrice Ménard (Université Paris Nanterre, UR Études Romanes / CRIIA / HLH), «Clorinda Matto de Turner: de la protección del indio a la educación de la mujer »
Christian Boyer (CRIIA, Université Paris Nanterre), «L’évocation de l’Orient dans les récits courts d’Emilia Pardo Bazán: le lointain à l’épreuve de la violence»
Claire Laguian (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Laboratoire d’Études Romanes –LER, EA4385), «Femmes et lesbiennes: le motif de l’insularité dans la poésie de Gloria Fuertes et Natalia Sosa»
Sophie Large (Université de Tours, ICD – EA 6297), «Voix narratives masculines dans la fiction féministe contemporaine: étude comparée de Fe en disfraz de Mayra Santos-Febres et Diosas decadentes de Jessica Masaya Portocarrero»
Partie 2 – Femmes écrivaines et violences
Lina Iglesias (Université Paris Nanterre / CRIIA – HLH), «Isabel Pérez Montalbán: la voix d’une “vikinga”»
Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes ILCEA4), «La casa de la fuerza d’Angélica Liddell: comment témoigner de l’invivable féminin?»
Paula Klein (Imager (Paris XII)- FORELLIS (Université de Poitiers), «Escritoras-investigadoras: Chicas muertas de Selva Almada y Aparecida de Marta Dillon»
Partie 3 – Femmes écrivaines et médias
Manuelle Peloille (3L.AM, Université d'Angers), «Sofía Casanova: entre les armes et les lettres»
Rocío González Naranjo (Université Catholique de l'Ouest EA 4249 HCTI Université Bretagne Sud), «Una mujer pionera del periodismo gonzo en españa: Magda Donato (1898-1966)»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre / CRIIA – HLH), «Une écrivaine lectrice à travers son blog: le cas de Zoé Valdés»
Partie 4 – Femmes écrivaines et littératures numériques
Yann Seyeux (Université Paris Nanterre – UR Études Romanes / CRIIA), «De la Rayuela al Mandala: para una lectura hipertextual de la novela digital de Alejandra Jaramillo Morales»
-
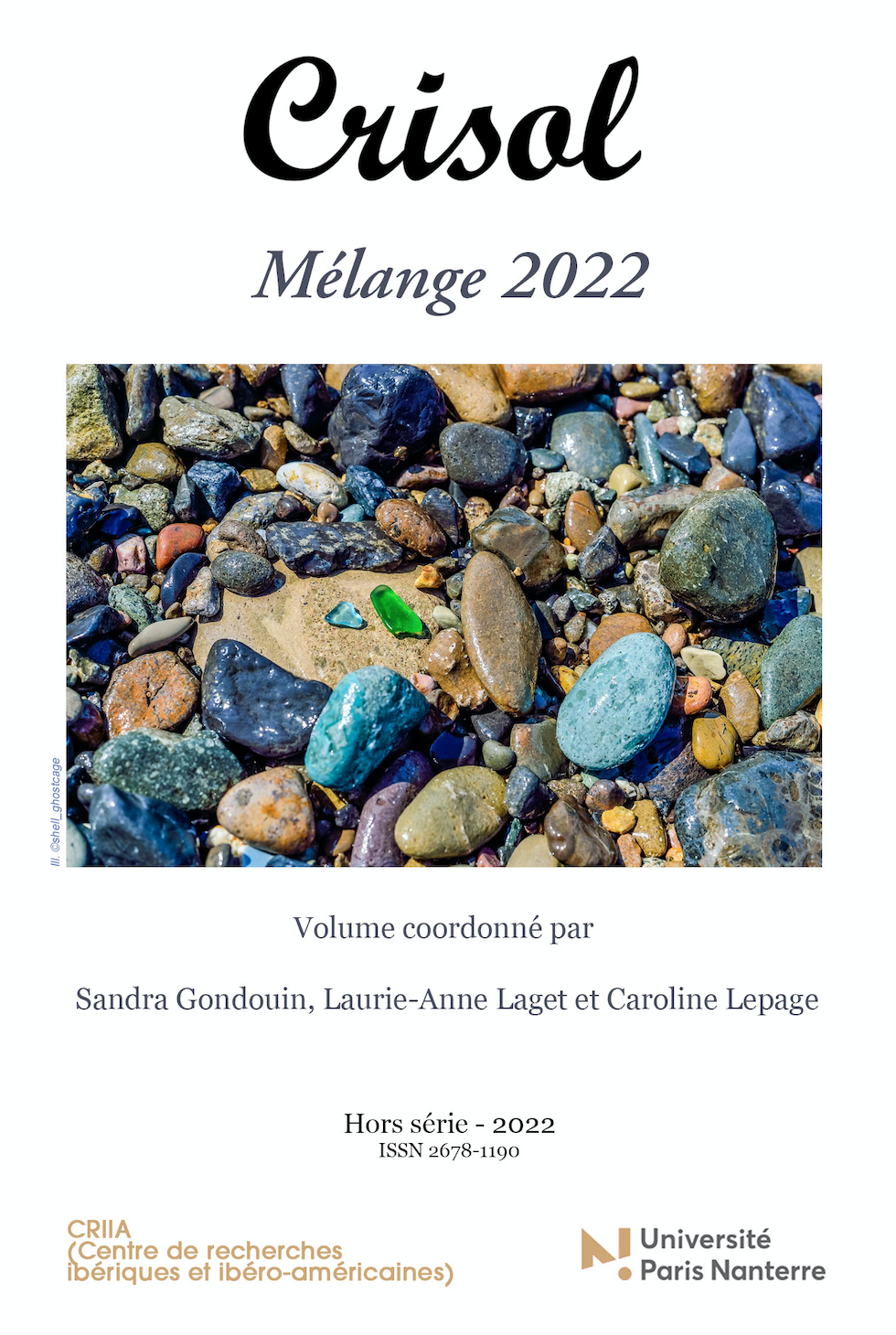
Mélange 2022
No 24 (2022)Ce Hors série de la revue Crisol est le deuxième volume de Mélange de la série numérique.
Il a été conçu et coordonné par Sandra Gondouin (Université de Rouen), Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université) et Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) avec l’ambition d’ouvrir à des enseignants-chercheurs, à des doctorants et à des enseignants du secondaire docteurs un vrai espace de liberté pour écrire sur le sujet de leur choix et dans une totale liberté de ton.
Cela donne, nous l’espérons, une riche mosaïque, avec des réflexions qui parcourent des lignes allant du Moyen-âge au XXIe siècle, des études en littérature, en civilisation et linguistique, de l’Espagne et de l’Amérique latine.
Nul doute que grâce à ces 16 contributions, la lectrice et le lecteur auront un bel échantillon de ce qui intéresse et inquiète actuellement la communauté des chercheurs hispanistes et américanistes.
Rendez-vous dans un an pour le Mélange 2023.
Sandra Gondouin, Laurie-Anne Laget et Caroline Lepage
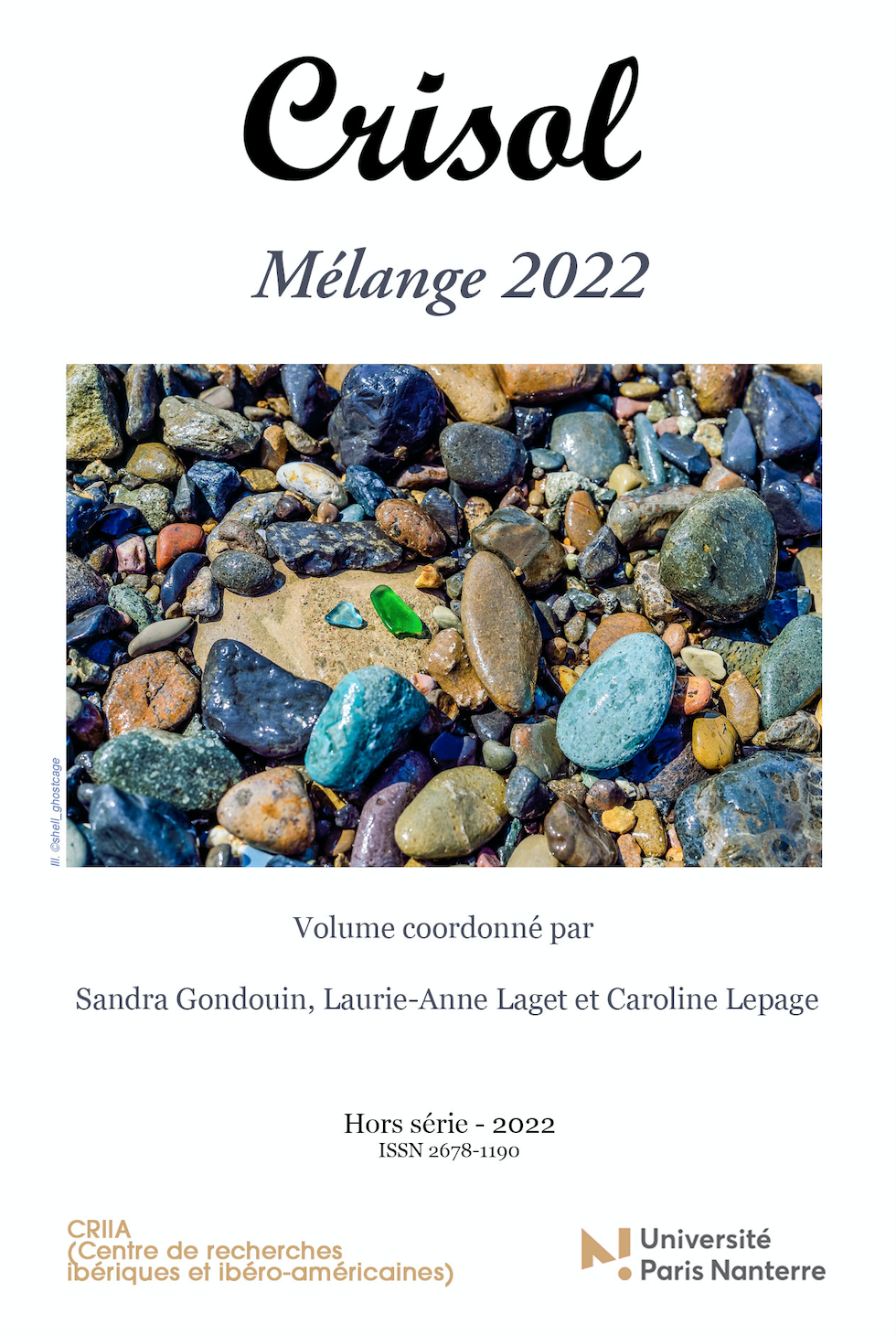 SOMMAIRE
SOMMAIREPatricia Rochwert-Zuili (Université d’artois – Textes & Cultures / UR 4028), «La représentation de la mort au tournant des XIIIe et XIVe siècles: le témoignage de l’historiographie royale castillane»
Fausto Garasa (Université de Tours, ICD), «L’autorité comme élément structurant du vécu dans la casa traditionnelle du Haut-Aragon»
David Alvarez Roblin (Université de Picardie – Jules Verne), «Aventures et mésaventures transfictionnelles de l’ingenioso hidalgo cervantin»
Aude Plozner Bruder (Centre interlangues - Texte Image Langages / EA 4182), «Le système narratif dans l’adaptation graphique du Don Quichotte de Cervantès par Rob Davis»
Teresa Orrechia-Havas (Université de Caen Normandie), «Las tres caídas de Beatriz Guido»
Sophie Marty (Université d'Orléans / REMELICE), «“Una luz distinta”: el oficio del escritor en la obra de Daniel Mella»
Nathalie Besse (Université de Strasbourg - Cher ur 4376), «Modalités, enjeux et limites de l’écrivain impliqué: les romans de Gioconda Belli et de Sergio Ramírez»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre – CRIIA / UR Études Romanes), «Cincuenta años de Cien años de soledad en el diario Le Monde»
Elena Geneau (Université Paris Nanterre EA Études Romanes – CRIIA / HLH), «Cien años de soledad en Argentina: crónica de medio siglo»
Liliana Riaboff (Université Paris Nanterre – CRIIA/HLH), «Gabriel García Márquez et le choix du merveilleux»
Gaëlle Hourdin (Université Toulouse – Jean Jaurès), «¿Contar o cantar la historia? Quelques considérations sur l’importance du descriptif dans la construction du discours épique du Canto General de Pablo Neruda»
Vladimer Luarsabishvili (New Vision University, Tbilisi, Georgia), «”Azul” como metáfora en el libro Azul… de Rubén Darío: el motor metafórico de dimensión metafísica-cultural»
François-Xavier Guerry (Université Bretagne Sud, HCTI), «Patty Diphusa de Pedro Almodóvar ou la poétique de l’explicite»
Cécile Bertin-Elisabeth (Université de Limoges EHIC, Université de Limoges), «Approche iconologique des pandémies d’hier et d’aujourd’hui»
Yann Seyeux (Université Paris Nanterre – CRIIA), «The Covid Art Museum: quand l’art numérique devient pandémique sur Instagram»
Alexandra Maria De Castro E Santos Araújo (Universidade Estadual Vale Do Acaraú/ UVA - Brasil), Márluce Coan (Universidade Federal Do Ceará/UFC – Brasil), Valdecy De Oliveira Pontes (Universidade Federal Do Ceará/ UFC – Brasil), «Da multifuncionalidade do pretérito imperfeito do indicativo em Espanhol, Francês e Português»
Aurore Ducellier (Université de Limoges), «De las cárceles de Franco al desencanto: los poetas liberados frente a la Transición»
***
Compte-rendus de lecture
Compte-rendu de lecture (Marc Zuili): Pedro de Valencia, Le Traité sur les Morisques d’Espagne, Vincent Parello
Compte-rendu de lecture (Sarah Voinier): Les traductions de la littérature espagnole (XVIe-XVIIIe siècle) / Las traducciones de la literatura española (siglos XVI-XVIII), Marie-Hélène Maux et Marc Zuili (dir.)
Compte-rendu de lecture (Marc Zuili): Isabelle Rouane Soupault, Une si vertueuse audace… Les femmes dramaturges dans l’Espagne du XVIIIe siècle
Compte-rendu de lecture (Odile Díaz Feliú): Jean de la Croix, Les dits de lumière et d’amour suivis de Degrés de perfection, avant-propos et traduction de Bernard Sesé
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
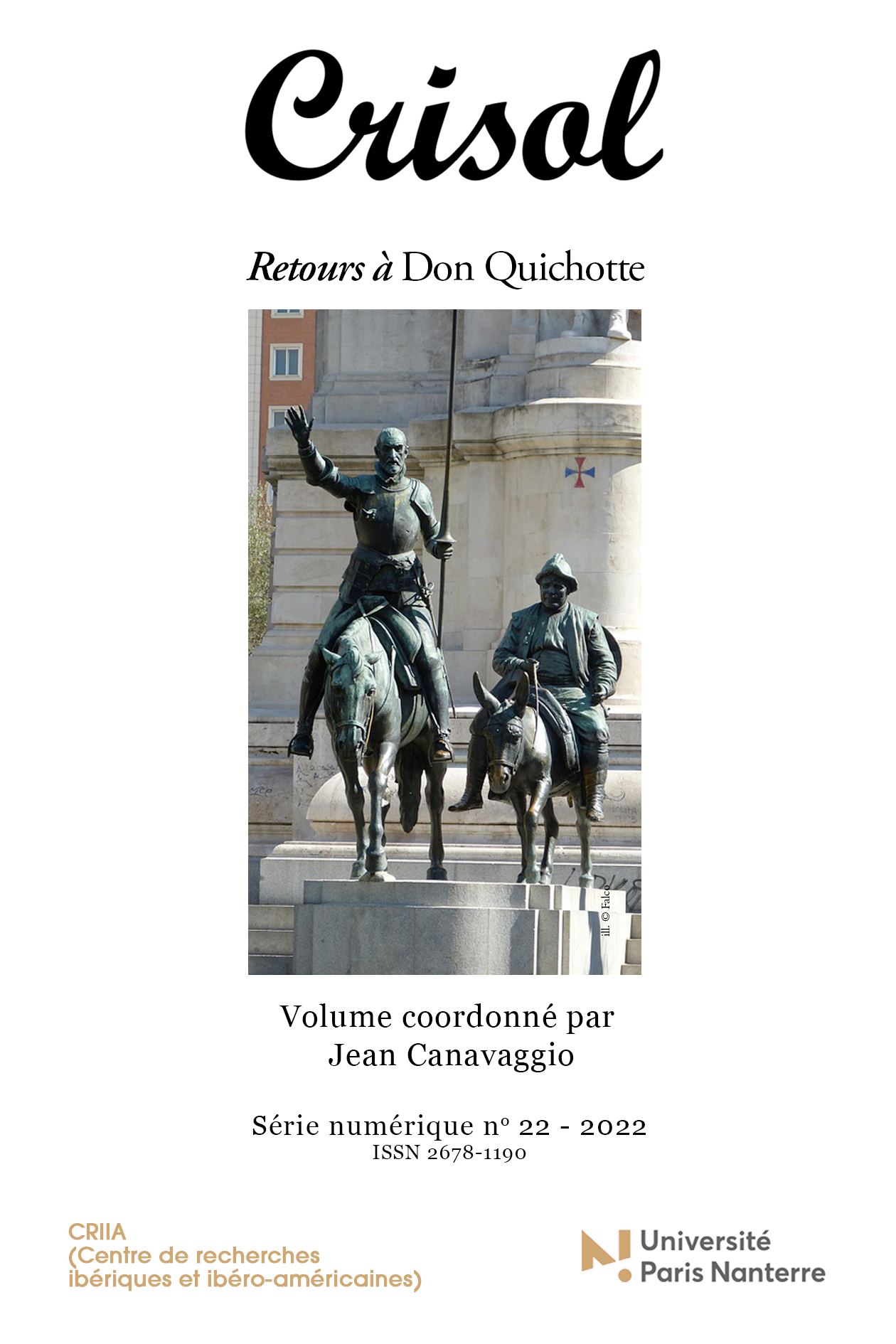
Retours à Don Quichotte
No 22 (2022)Les commémorations qui, entre 2013 et 2016, ont marqué le quatrième centenaire de la mort de Cervantès et de la publication de ses œuvres majeures, se sont traduites par l’organisation de nombreux congrès et colloques et par une intense activité éditoriale dont il serait vain de résumer ici les fruits. Pour nous en tenir au Don Quichotte, deux types d’événements méritent tout particulièrement d’être signalés. Le premier, de caractère scientifique, est la sortie des presses d’une édition de référence, coordonnée par Francisco Rico sous l’égide de la Real Academia Española : dernière mise à jour d’une entreprise engagée de longue date, elle constitue le fleuron d’une édition des Obras completas venue remplacer avantageusement celle que Rudolf Schevill et Adolfo Bonilla y San Martín avait menée à bien il y a plus d’un siècle. L’autre, qui a sensibilisé un cercle plus large que celui des seuls spécialistes, est la parution, à quelques mois de distance, de deux romans inspirés, sur des modes différents, du chef-d’œuvre de Cervantès : Le Quichotte, de Salman Rushdie, et Rêver debout, de Lydie Salvayre. Les aventures de l’ingénieux hidalgo ont ainsi bénéficié d’une renouveau d’intérêt qui s’est partagé, en quelque sorte, entre les deux images que ce dernier nous offre traditionnellement : d’une part, le protagoniste d’un récit que l’on s’accorde à tenir pour le premier roman des Temps modernes ; d’autre part, le personnage mythique qu’il est devenu au fil de ses réceptions successives et qui, de ce fait, a été remodelé souvent très librement.
On ne sera pas surpris de constater que les cinq contributions ici réunies sous le titre Retours à Don Quichotte s’inscrivent dans la première de ces deux traditions. Trois d’entre elles envisagent sous un angle inédit des chapitres dont le sens a été parfois obscurci par le poids des commentaires. Celui qui ouvre la Première Partie fait l’objet de la part de l’auteur de ces lignes d’un examen circonscrit à ce fameux « lugar de la Mancha » d’où part don Quichotte en quête d’aventures et dont l’imprécision délibérée a fait couler des flots d’encre. Il s’emploie à montrer, à partir d’une discussion de la dernière hypothèse en date, comment toute tentative d’identification de ce lieu est par définition vouée à l’échec. Isabelle Rouane, pour sa part, s’attache, dans la Seconde partie, à l’étape décisive du séjour du héros à Barcelone. Elle envisage plus particulièrement les espaces concrets de la plage et du bord de mer qui constituent le décor récurrent des aventures qu’ils structurent. Évoqué en amont, au chapitre 60, et en conclusion, au chapitre 66, ce rivage particulier encadre l’épisode à la manière d’une scène de théâtre dont il s’agit d’analyser la mise en écriture. Marqueur textuel de l’œuvre cervantine, elle contribue à la définition d’une géo-poétique des rivages ontologiquement marquée par sa dimension pathétique. Une géopoétique à laquelle donne sa pleine l’une des péripéties de Las dos doncellas, l’une des Nouvelles exemplaires, qui, elle aussi, a le même décor pour cadre final. Quant à Jean-Paul Sermain, il examine en les comparant les conclusions respectives de la Première et de la Seconde Partie. Il montre comment l’auteur continue à se dissocier de son personnage et de son point de vue, mais en des termes inversés par rapport à tout ce qui précède, ce qui permet de suggérer une autre approche du roman que celle qui s’affirme purement critique et comique, compatible, par conséquent, avec les lectures romantiques qui lui confèrent la capacité d’émouvoir le lecteur.
Philippe Rabaté, en revanche, envisage l’ensemble du roman dans une perspective qui transcende l’enchaînement et la diversité des épisodes, en prenant pour objet la construction de Sancho Pança dont on sait qu’elle a donné lieu à une abondante littérature critique. Prenant appui sur son maniement de l’oralité et sur la relation changeante que noue l’écuyer avec le code chevaleresque de son maître, il se propose de montrer comment ce personnage, issu d’un substrat folklorique qui a connu maintes transpositions littéraires, s’affirme peu à peu comme un être inventif et capable comme tel de se faire une place dans les aventures qu’il doit vivre.
Enfin, David Alvarez reconsidère la suite d’Avellaneda à partir d’un des lieux communs qui veut que don Quichotte y finisse reclus dans l’asile d’aliénés de Tolède. A bien y regarder, estime-t-il, cette affirmation doit être nuancée. Un nouvel examen du dénouement de l’apocryphe lui permet d’en faire ressortir les paradoxes, tout en découvrant de possibles réminiscences de cette fin allographe au début du Don Quichotte de 1615.
Sans qu’il faille mésestimer tout ce qui les distingue les unes des autres, ces cinq contributions, on le voit, témoignent d’une même préoccupation : celle d’une défense et illustration de la lettre du texte cervantin, préalable indispensable à toute lecture soucieuse d’en rectifier ou d’en renouveler le sens. Retours à Don Quichotte y puise sa cohérence, sans pour autant sacrifier sa diversité.
Jean Canavaggio, Université Paris Nanterre
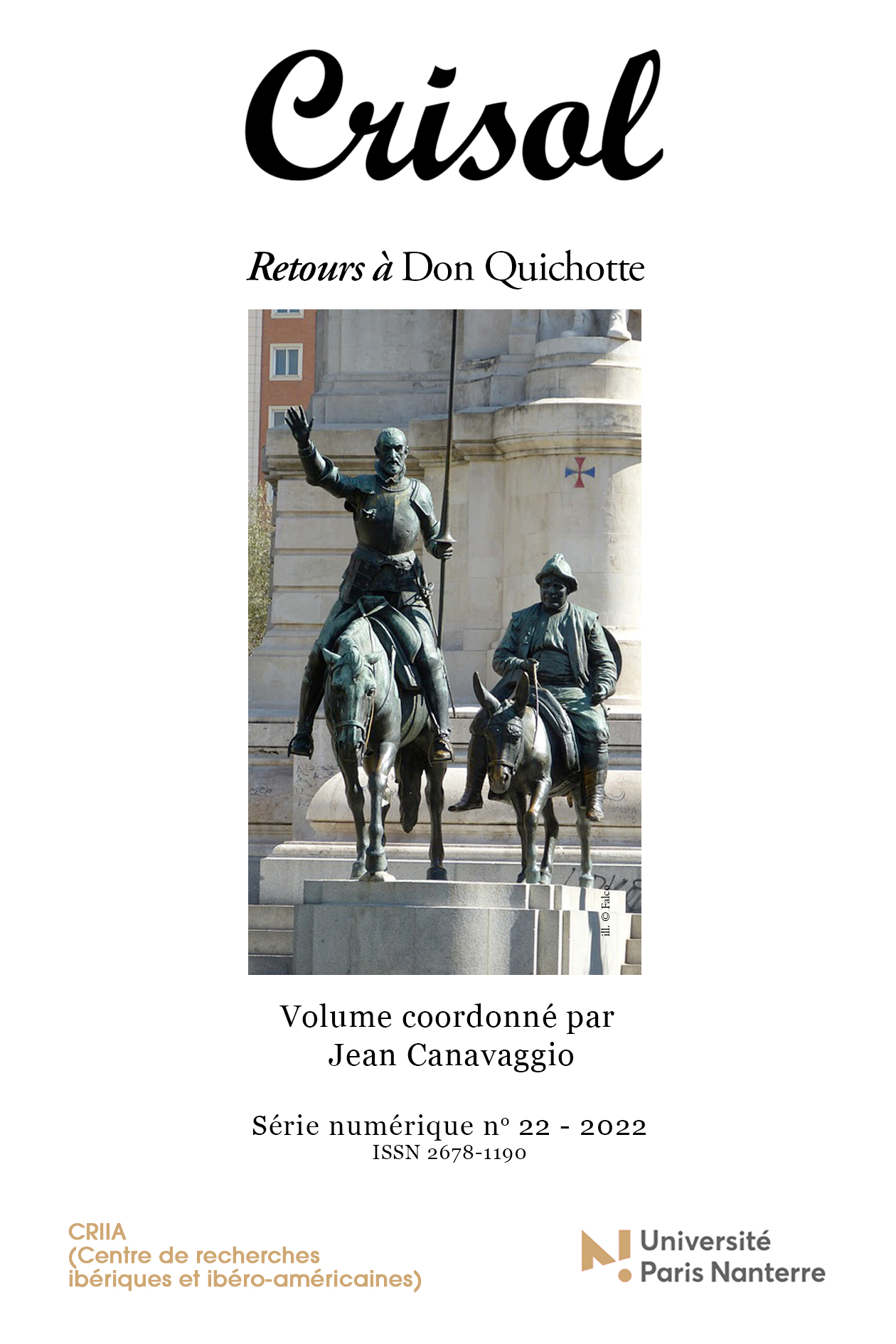
SOMMAIRE
Jean Canavaggio (Université Paris Nanterre), présentation
Jean Canavaggio (Université Paris Nanterre), «Un village de la Manche dont il n’y a pas lieu de se rappeler le nom»
Isabelle Rouane Soupault (Université d’Aix-Marseille), «La plage de Barcelone (Don Quichotte II, 61-64) : vers une géo-poétique cervantine des rivages»
Jean-Paul Sermain (Université Sorbonne Nouvelle), «Le repentir de don Quichotte et le double jeu de Cervantès»
Philippe Rabaté (Université Paris Nanterre), «La construction du personnage de Sancho Pança»
David Alvarez (Université de Picardie), «La fin surprenante du Don Quichotte d’Avellaneda et ses échos au début du Don Quichotte de 1615»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr