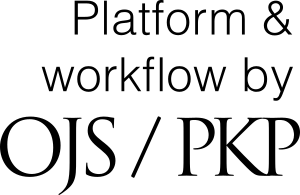-
 Construire les mémoires politiques: discours et pratiques esthétiques de résistance en Amérique latine
No 21 (2022)
Construire les mémoires politiques: discours et pratiques esthétiques de résistance en Amérique latine
No 21 (2022)Construir las memorias políticas: discursos y prácticas estéticas de resistencia en América latina
En el contexto actual, América Latina avanza en la construcción de nuevos discursos que insisten en visibilizar procesos de movilización social en contra de estructuras hegemónicas adheridos al poder. Así mismo, intenta preservar las memorias de individuos y de colectivos que constantemente crean prácticas estéticas como alternativa de resistencia política y de lucha en defensa de sus derechos. Voces y acciones que instalan nuevas preguntas, pero que además proyectan nuevas necesidades y demandas de verdad, justicia y reparación social. Un escenario complejo que nos permite hoy hablar de un despertar colectivo; un estallido social que viene sacudiendo los cimientos de un continente marcado por la pobreza, la desigualdad, la falta de políticas de inclusión y de garantías de preservación y salvaguarda de las memorias. En este número se destacan acciones y procesos realizados por actores e instituciones sociales que intentan visibilizar, mediante el uso de nuevos lenguajes, aquellas memorias subterráneas que durante años han permanecido por fuera de los archivos oficiales, o que sistemáticamente han sido borrados como estrategia de silenciamiento estatal. Estas nuevas voces, que surgen como alternativas contrahegemónicas de lucha social, nos permiten entender las dinámicas que hoy se construyen en América Latina como respuesta al creciente malestar en la sociedad. Estudios como el del origen y evolución del parlache realizado mediante el análisis de textos escritos por estudiantes de sectores marginales de la ciudad de Medellín – Colombia, dan cuenta del proceso de construcción de un repertorio discursivo marcado por la violencia que genera el narcotráfico. En esta misma óptica, los testimonios de familiares de víctimas realizados mediante la utilización de objetos personales como dispositivos de recuerdos, y como evidencia probatoria ante la justicia, constituyen una memoria viva del conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, y en busca de nuevos soportes y nuevas lecturas que nos pemitan comprender el presente, el analisis de la obra del cineasta Victor Gaviria nos permite acercarnos al horizonte poético que emerge en su filmografía. Patrimonios que son parte de la herencia cultural de la humanidad, y que requieren una intervención para su conservación. Tal es el caso del articulo sobre la dificultad de hacer memoria sobre la dictadura cívico-militar en Brasil, donde se revela la fragilidad de las medidas para preservar los espacios en los que se perpetraron crímenes de presos políticos y civiles, así como la falta de politicas para la conformación de lugares que permitan la construcción de una memoria ejemplar para las generaciones futuras. Otros dos artículos, ambos escritos a partir de las reflexiones que nos deja la pandemia, reflejan no sólo las medidas con las que la población civil debió lidiar durante un confinamiento necesario pero excesivo, sino las problemáticas de fondo que emergieron desde leyes impuestas por instituciones del Estado que buscaban controlar a unos individuos cansados de los abusos y la falta de garantías de subsistencia básicas en Brasil. Desde otra latitud, en Colombia este fenómeno, junto al alza desmedida a los impuestos en periodo de crisis, motivó la destrucción o intervención de estatuas y monumentos en el marco de las protestas sociales del llamado Paro Nacional de 2021, el cual desató una resignificación de los valores nacionales y amplió el debate en torno a la participación, la inclusión y la legitimación de derechos fundamentales. Violencias políticas con raíces coloniales que se extienden hasta nuestros días, las cuales son evidentes en la obra de la artista plástica brasileña Rosana Paulino. Dichas piezas son un claro ejemplo de como el llamado arte negro contemporáneo se eleva como una voz de resistencia que saca a flote el racismo estructural, pero también asuntos tratados desde la teoría poscolonial como la subalternidad y el feminismo en Brasil, entre otros. Memorias que tienen puntos de conexión, pero que a la vez crean rupturas y continuidades en las luchas por los usos del pasado. Un dialogo que se construye en tiempos y espacios diferentes, y que nos permite comprender, a partir de casos como los que analiza el texto sobre las experiencias extremas de la violencia del terrorismo de Estado en Argentina, cómo las formas estéticas y narrativas de apropiación cultural de memorias crean un orden simbólico colectivo mediante el cual la lucha de un grupo puede transformarse en la lucha de todo un continente que busca acercarse a una democracia firme, imparcial y perdurable. Todas estas reflexiones, junto a la imagen que sirve de portada y que nos comparte el fotógrafo Javier Serna Sánchez, obturada el 19 de mayo de 2021 en el marco de las protestas sociales en Colombia, le dan sentido a un dossier en el que, más que simples textos, encontramos un llamado a la reflexión, la preservación y la visibilización de los discursos y las prácticas estéticas que se están produciendo en América Latina como parte de las memorias vivas que emergen en contexto de lucha social.
Construire des mémoires politiques: discours et pratiques esthétiques de résistance en Amérique latine
Dans le contexte actuel, l’Amérique latine progresse dans la construction de nouveaux discours qui cherchent à renforcer la visibilité des processus de mobilisation sociale contre des structures hégémoniques attachées au pouvoir. De même, elle tente de préserver les mémoires des individus et des collectifs qui créent sans cesse des pratiques esthétiques comme alternative de résistance politique et de lutte pour défendre leurs droits. Des voix et des actions qui posent de nouvelles questions et qui reflètent de nouveaux besoins et de nouvelles exigences de vérité, de justice et de réparation sociale. Un scénario complexe qui nous permet aujourd’hui de parler d’éveil collectif; une explosion sociale qui ébranle les fondements d’un continent marqué par la pauvreté, l’inégalité, l’absence de politique d’inclusion et le manque de garanties concernant la conservation et la sauvegarde des mémoires. Dans ce numéro, sont mis en relief des actions et des processus réalisés par des acteurs et des institutions sociales qui tentent de rendre plus perceptibles, grâce à l’utilisation de nouveaux langages, ces mémoires souterraines qui pendant des années sont restées en dehors des archives officielles, ou qui ont été effacées systématiquement, et qui constitue une mise sous silence stratégique de la part de l’Etat. Ces nouvelles voix qui surgissent comme alternatives de lutte sociale contre l’hégémonie nous permettent de comprendre les dynamiques qui se construisent aujourd’hui en Amérique latine en réponse au mal être croissant dans la société. Des études comme celle qui porte sur l’origine et l’évolution du parlache élaboré à partir de l’analyse de textes écrits par des étudiants des secteurs marginaux de la ville de Medellin- Colombie, rendent compte du processus de construction d’un répertoire discursif marqué par la violence engendrée par le trafic de drogue. Dans cette même optique, les témoignages de familles de victimes réalisés à partir d’objets personnels utilisés comme déclencheurs de souvenirs, et faisant office de preuves devant la justice, constituent une mémoire vivante du conflit armé en Colombie. De même, en quête de nouveaux supports et de nouvelles lectures qui nous permettent de comprendre le présent, l’analyse de l’œuvre du cinéaste Victor Gaviria nous permet une approche de l’horizon poétique qui émerge de sa filmographie. Patrimoine qui fait partie de l’héritage culturel de l’humanité, et qui nécessite une intervention afin d’être conservé. Il en va de même pour l’article qui traite de la difficulté de garder en mémoire la dictature civilo-militaire au Brésil, étant donnée la fragilité des mesures mises en œuvre pour préserver les espaces où furent perpétrés les crimes de prisonniers politiques et civiles, ainsi que le manque de politiques visant à la création de lieux propices à la construction d’une mémoire servant d’exemple aux générations futures. Deux autres articles, écrits l’un et l’autre à partir de réflexions inspirées par la pandémie, reflètent les mesures auxquelles la population civile a du faire face durant un confinement nécessaire mais excessif, mais aussi les problématiques de fond qui ont surgi, depuis que des lois ont été imposées par des institutions de l’Etat pour tenter de contrôler des individus lassés par les abus et le manque de garanties élémentaires pour assurer la subsistance au Brésil . Par ailleurs, en Colombie ce phénomène, auquel s’est ajoutée une hausse démesurée des impôts en temps de crise, a engendré la destruction ou la mise à mal de statues et de monuments, dans le cadre des protestations sociales de ce que l’on a appelé le Paro Nacional de 2021, lequel a déclenché une redéfinition des valeurs nationales et a élargi le débat concernant la participation, l’inclusion et la légitimation des droits fondamentaux. Des violences politiques issues du passé colonial et qui se prolongent jusqu’à nos jours, comme le démontre clairement l’œuvre de l’artiste plasticienne brésilienne Rosana Paulino. Ces réalisations témoignent clairement de la manière dont ce que l’on nomme l’art nègre contemporain s’élève comme une voix de résistance qui met en évidence le racisme structurel, mais aussi des questions traitées à partir de la théorie postcoloniale telles que la subalternité et le féminisme au Brésil, entre autres. Mémoires qui ont des points communs, mais qui en même temps créent des ruptures et des continuités dans les luttes, selon les usages du passé. Un dialogue qui s’élabore en des temps et des espaces différents, et qui nous permet de comprendre, à partir de cas comme ceux qu’analyse le texte sur les expériences extrêmes de la violence du terrorisme d’état en Argentine, comment les formes esthétiques et narratives d’appropriation culturelle de la mémoire créent un ordre collectif symbolique au travers duquel la lutte d’un groupe peut se transformer en lutte de tout un continent qui cherche à s’approcher d’une démocratie stable, impartiale et durable. Toutes ces réflexions, ainsi que l’image qui sert de couverture et que nous offre le photographe Javier Serna Sanchez, prise le 19 mai 2021 dans le cadre des protestations sociales en Colombie, donnent du sens à un dossier dans lequel, au-delà des textes, on trouve un appel à la réflexion, à la préservation et à la mise en lumière de discours et de pratiques esthétiques qui ont cours en Amérique Latine et qui participent de la mémoire vivante qui surgit au cœur de la lutte sociale.
Luis Carlos TORO TAMAYO Medellin – Colombie, janvier 2022
.jpg)
@ photo : Serna Sánchez Javier, Medellín, 19 de mayo de 2021 (Protesta social durante el Paro Nacional – Colombia, 2021)
Luis carlos Toro Tamayo : EDITEUR SCIENTIFIQUE
Emmanuelle Sinardet : COORDINATRICE
SOMMAIRE
Luz Stella Castañeda Naranjo (Universidad de Antioquia), José Ignacio Henao Salazar (Universidad de Antioquia), «La voz de los jóvenes marginales de Medellín – Colombia: una memoria fresca y espontánea»
Luis Carlos Toro Tamayo (Universidad de Antioquia), José Ignacio Henao Salazar (Universidad de Antioquia), «Discurso y silencio. Análisis de texto a partir de los testimonios de familiares de víctimas del conflicto armado en Colombia»
Beatriz Elena Acosta Ríos (Facultad de Artes y Humanidades –Instituto Tecnológico Metropolitano), Juan Diego Parra Valencia (Facultad de Artes y Humanidades (Instituto Tecnológico Metropolitano), «Arte, monumento y archivo. Reflexiones en torno a la obra de Víctor Gaviria como archivista de la ciudad»
Maria Leticia Mazzucchi Ferreira (Federal University of Pelotas, Rs, Brazil), Darlan de Mamman Marchi (Federal University of Pelotas, Rs, Brazil), «Resilient Heritages: The Difficult Memory of the Military Dictatorship in Brazil»
Javier Alejandro Lifschitz (Universidad Federal Del Estado de Rio de Janeiro /PPGMS), «Memoria social y pandemia en América del Sur: “libertarios”, negacionistas y el porvenir de una ilusión»
Sebastián Vargas Álvarez (Universidad del Rosario, Colombia), «Desmonte de la historia y apropiación del espacio público. Derribo e intervención de monumentos durante el Paro Nacional en Colombia (2021)»
Márcio Seligmann-Silva (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil), «Rosana Paulino: a arte como resistência aos apagamentos da violência colonial»
Ludmila Da Silva Catela (IDACOR/UNC), «Memorias enlazadas – Rupturas y continuidades en las luchas por los usos del pasado»
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, Centre D’Études Équatoriennes - CRIIA, Études Romanes), «Compte-rendu de lecture : La escalera de Bramante de Leonardo Valencia, roman hélicoïdal»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
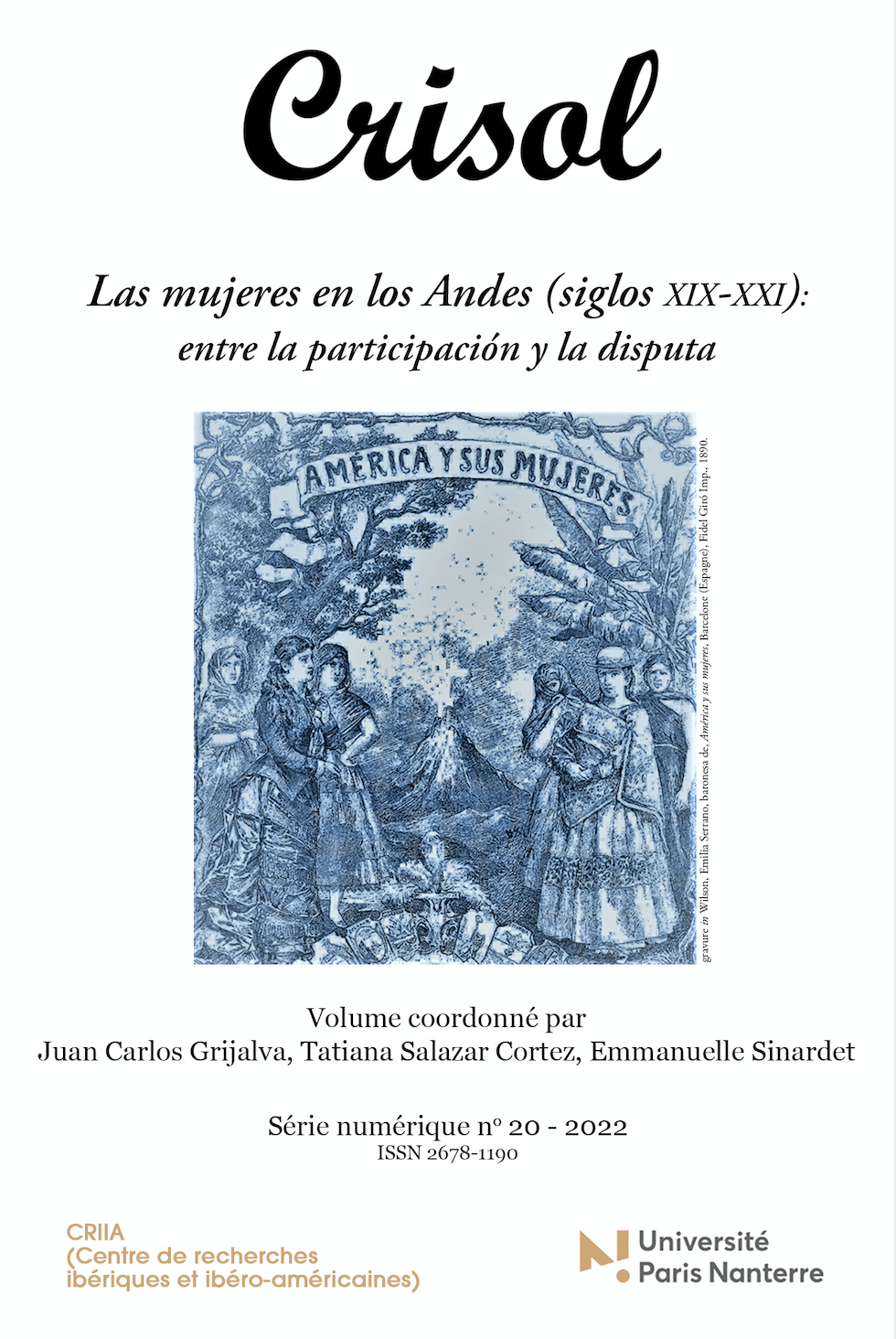 Las mujeres en los Andes (siglos XIX-XXI): entre la participación y la disputa
No 20 (2022)
Las mujeres en los Andes (siglos XIX-XXI): entre la participación y la disputa
No 20 (2022)La relevancia actual de los movimientos de mujeres y demandas en torno a sus derechos sociales, políticos, legales y reproductivos han marcado un derrotero multívoco en los debates contemporáneos de las sociedades de la región andina. Varias propuestas de sectores sociales vinculados a la lucha histórica de los movimientos de mujeres han puesto sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre cómo las demandas femeninas han llegado y se han situado en la palestra pública actual. Asimismo, la búsqueda de pasados históricos y de genealogías feministas que disputan discursos y perspectivas en la opinión pública evidencian la necesidad de fomentar análisis y producciones científicas sobre las demandas políticas y sociales de los movimientos de mujeres a través del tiempo. Ante este horizonte, los estudios aquí compilados buscan contribuir, desde la producción académica, a una mejor comprensión sobre el género y la participación histórica, cultural y política de las mujeres en los Andes.
Los editores, Juan Carlos Grijalva (Assumption University-Estados Unidos); Tatiana Salazar Cortez (Universidad del País Vasco / Université Paris Nanterre, CRIIA - Centre d'études équatoriennes); Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, CRIIA - Centre d'études équatoriennes)
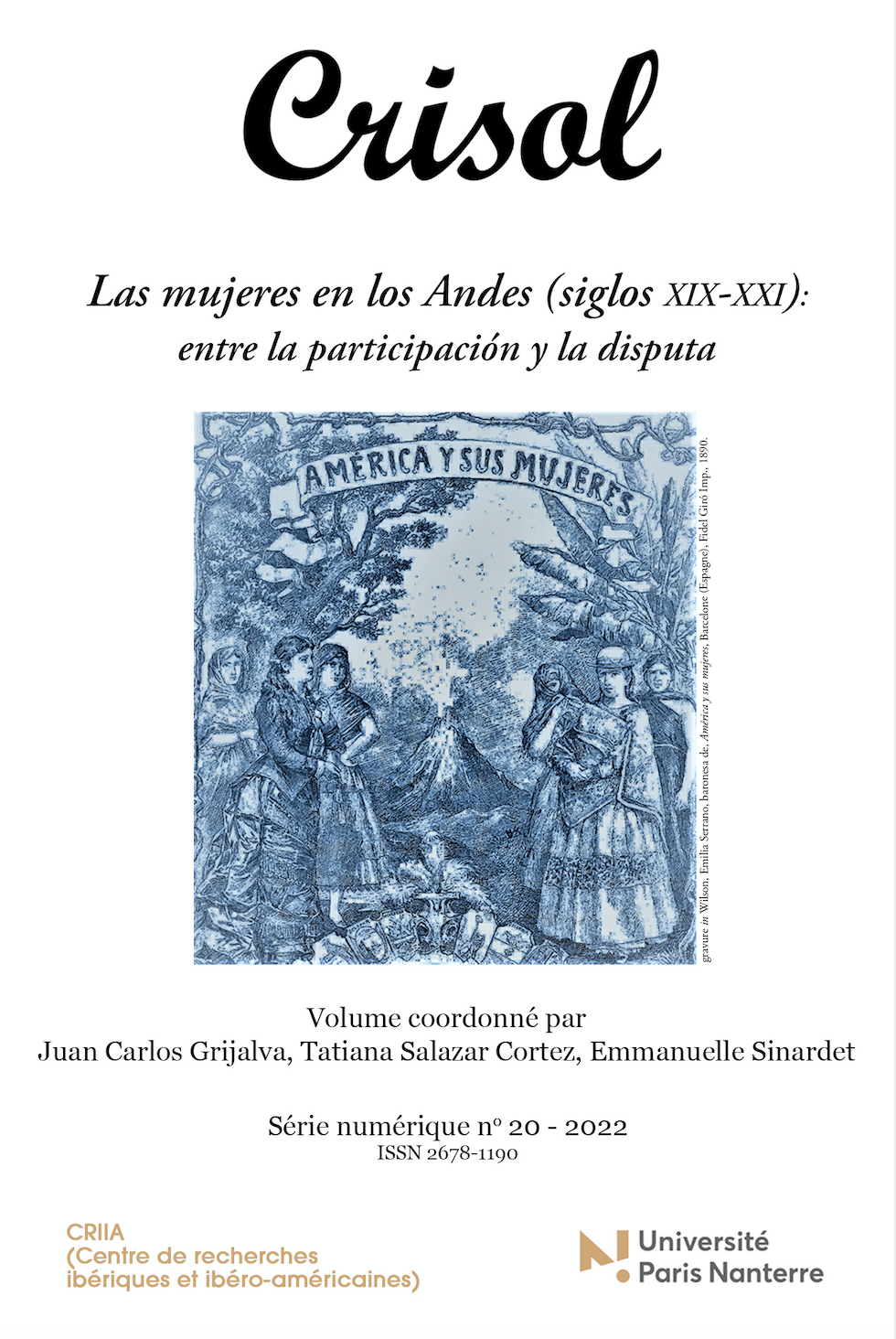
SOMMAIRE
Juan Carlos Grijalva, Emmanuelle Sinardet, Tatiana Salazar Cortez, «Introducción»
Alejandra Arango Londoño (Universidad de Granada), «Mujer y conflicto en Colombia durante el siglo XIX: testimonio de una combatiente en la Guerra de los Mil Días (1899-1902)»
Michal Handelsman (University of Tennessee), «“Ain’t I a Woman?” Poéticas de (re)existencia en algunas poetas afrocolombianas»
Alexandra Astudillo Figueroa (Universidad San Francisco de Quito), «Redes de mujeres en el siglo XIX Andino: carácter transnacional de un quehacer intelectual»
Ana María Goetschel (Departamento de sociología y estudios de género de Flacso- Ecuador), «El pensamiento de las mujeres y los dilemas de la emancipación: La visita de Belén de Sárraga al Ecuador»
Juan Carlos Grijalva (Assumption University), «Ventriloquismos travestis de la escritura masculina en el siglo XIX en Ecuador: las voces femeninas de Juan Montalvo»
Marlène Moret (Université de Toulouse Jean-Jaurès – Framespa), «Los feminismos de José de la Cuadra, de jurista a escritor»
Tatiana Salazar Cortez (Universidad del País Vasco UPV/ EHU- Université Paris Nanterre), «Ecuatorianas comunistas entre las décadas de los 60 y 70: estrategias locales para intereses internacionales»
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, Centre D’Études Équatoriennes - CRIIA, Études Romanes), «Generización de la memoria y socialización de la maternidad en Colombia: El dolor tiene cara de madre»
Diana Sarrade Cobos (Université de Bordeaux – CRIIA), «La Ley de economía popular, social y solidaria en Ecuador: ¿Una herramienta en favor del empoderamiento de las mujeres?»
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
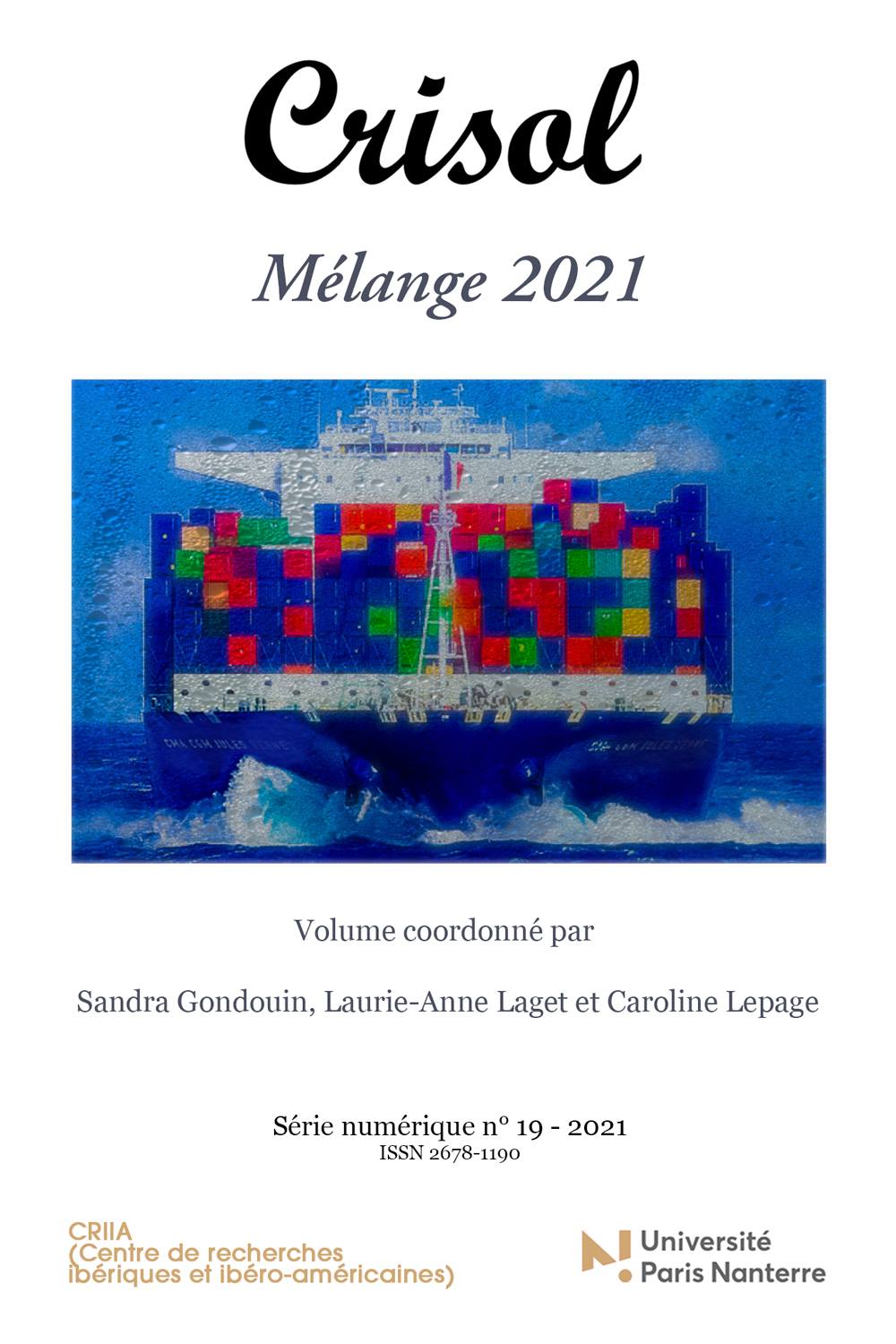 Mélange 2021
No 19 (2021)
Mélange 2021
No 19 (2021)Ce numéro 19 de Crisol est le premier volume de Mélange de la série numérique.
Il a été conçu et coordonné par Sandra Gondouin (Université de Rouen), Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université) et Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) avec l’ambition d’ouvrir à des enseignants-chercheurs français et étrangers et – en bonus – à une traductrice un vrai espace de liberté pour écrire sur le sujet de leur choix et dans une totale liberté de ton.
Cela donne, nous l’espérons, une riche mosaïque, avec des réflexions qui parcourent des lignes allant du Siècle d’Or au XXIe siècle, des études en littérature et en civilisation, de l’Espagne, de l’Amérique latine (Uruguay, Argentine, Colombie, Mexique, Cuba, Brésil, Chili) et de l’Afrique hispanophone…
Nul doute que grâce à ces 23 contributions, la lectrice et le lecteur auront un bel échantillon de ce qui intéresse et inquiète actuellement la communauté des chercheurs hispanistes et américanistes. Rendez-vous dans un an pour le Mélange 2022.
Sandra Gondouin, Laurie-Anne Laget et Caroline Lepage
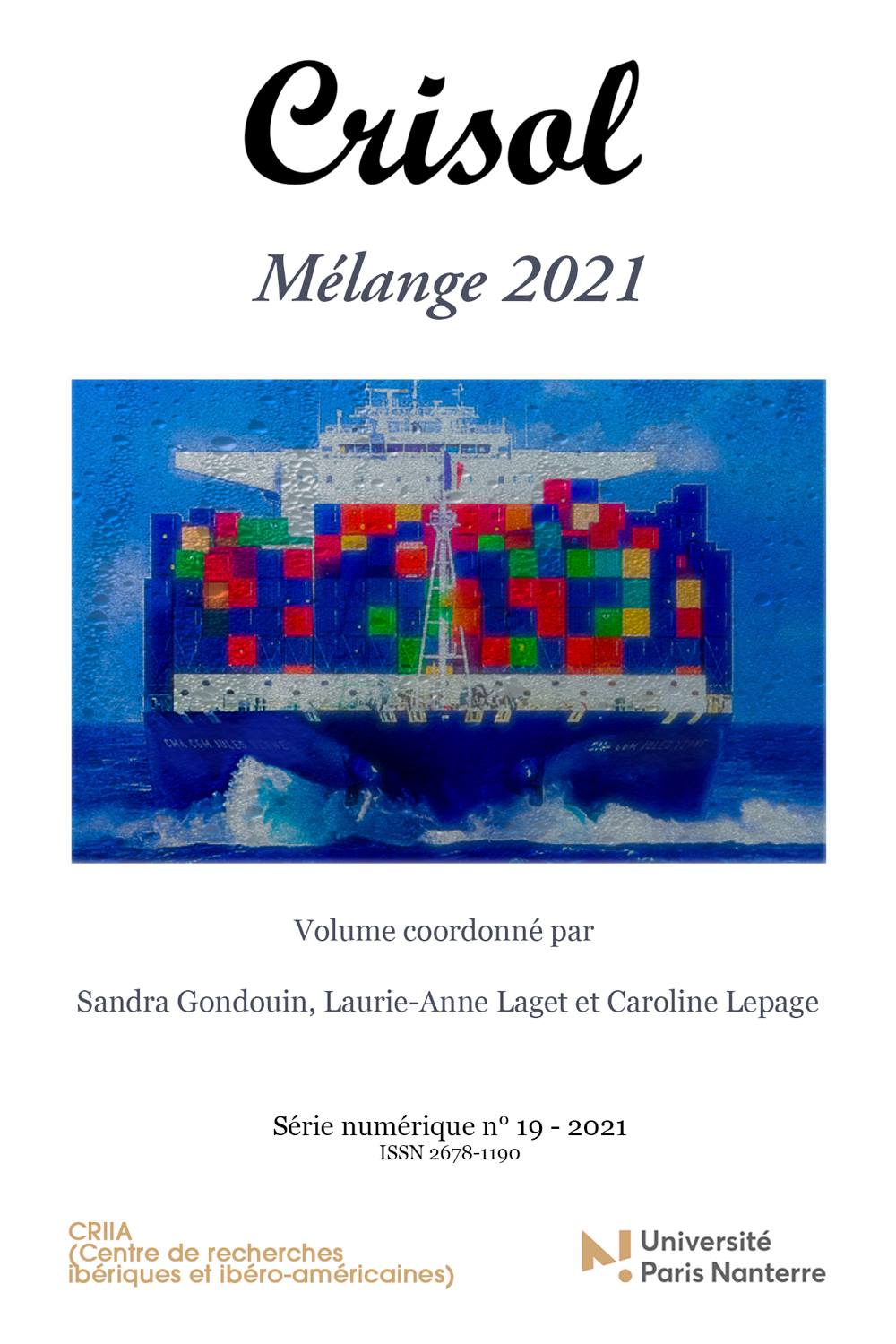
SOMMAIRE
François-Xavier Guerry (Université Bretagne Sud), «“Ella era el mercader y la mercaduría, ella era la tienda y la tendera” –Le vocabulaire érotique marchand dans le cycle célestinesque»
Bernard Darbord (Université Paris Nanterre), «Gil Vicente, O pranto de Maria Parda (Lisbonne, 1522): réflexion sur le texte»
Félix Terrones (Instituto Riva Agüero–PUCP), «Diario de viaje a París (1900) de Horacio Quiroga o la trayectoria hacia el desencanto»
Elsa Fernández (Université Paris Nanterre), «Los juegos transtextuales al servicio de la ideología: el caso de Chaves Nogales, periodista de la Revolución rusa»
Clara Berdot (laboratoire LIS (Lettres, Idées, Savoirs) - EA 4395 de l’UPEC), «“De cent façons différentes et même contradictoires”: le kaléidoscope magistro-discipulaire dans quelques fictions borgésiennes»
Amadeo López Université (Paris Nanterre), «Recepción de Cien años de soledad en España –1967-1975»
David Barreiro Jiménez Université (Université Paris Nanterre), «Barcelone et Gabriel García Márquez: le printemps du patriarche»
Gaëlle Hourdin (Université Toulouse – Jean Jaurès), «L’Elegia al Che : une esthétique de la litote dans le poème visuel brossien»
Ricardo Torre (Université Paris-Est Créteil), «Le tango dans l’œuvre de Marcelo Cohen: de la tradition à la science-fiction»
Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «Contratapas contrarias: figure d'auteur dans les premières et quatrièmes de couverture de Rodolfo Fogwill»
Marisol Luna Chávez (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) et Víctor Díaz Arciniega (Universidad Autónoma Metropolitana), «Guadalupe Dueñas a contraluz de sus contemporáneas. Los temas de su narrativa»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), «Saveurs, significations et resignifications dans la tétralogie des «Quatre saisons» de Leonardo Padura Fuentes»
Françoise Moulin-Civil (CY Cergy Paris Université), «Interculturalité et paratopie identitaire: le cas de la littérature et de la culture cubano-américaines»
Cécile Brochard (Université de Caen-Normandie), «Incarner les minorités dans le roman africain hispanophone et afro-brésilien: perspectives transatlantiques (María Nsué Angüe et Conceição Evaristo)»
Angélica Amancio (Université Jean Loulin – Lyon 3), «Les références intertextuelles et l’histoire des objets dans L’odeur du siphon, de Lourenço Mutarelli»
Sophie Large (Université de Tours), «Guadalupe Nettel et le boom: héritage ou contre-héritage?»
Paula Klein (IMAGER/Université de Paris-Est-Créteil et FoReLLIS/Université de Poitiers), «Archivo y secretos de familia en La sombra del púgil (2008) de Eduardo Berti»
María José Fernández Vicente (Université de Bretagne Occidentale), «Le cœur a ses raisons. Réflexions sur la place des émotions dans la pensée occidentale»
Claire Laguian Université Gustave Eiffel, «Couvrir le paratexte, occulter les processus migratoires: texte et image au service de l’impossibilité du voir dans La noche de Europa de Dionisio Cañas»
Diana Sarrade Cobos (Université de Bordeaux), «Les revendications environnementales des peuples indigènes en Équateur: une lutte locale à dimension globale»
Audrey Louyer (Université de Reims Champagne-Ardenne / CIRLEP), «La Micropedia d’Ignacio Padilla: déclinaisons d’un fantastique polymorphe»
Benoît Santini (Université du Littoral Côte d’Opale), «Migraciones en la obra de dos jóvenes autores chilenos: Charapo de Pablo D. Sheng (2016) y Éxodos de Jorge Cid (2018)»
Corinna Gepner (traductrice), «Comprendre ou ne pas comprendre»
Axelle Vatrican (Université de Toulon), «Sobre las preguntas encubiertas: el ejemplo de saber en español»
***
Compte-rendu de lecture
Compte-rendu de lecture (Alexandra Oddo): Anne Monssus, La salsa cubaine en Europe et en Amérique. Comment danse-t-on « a lo cubano » ?
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
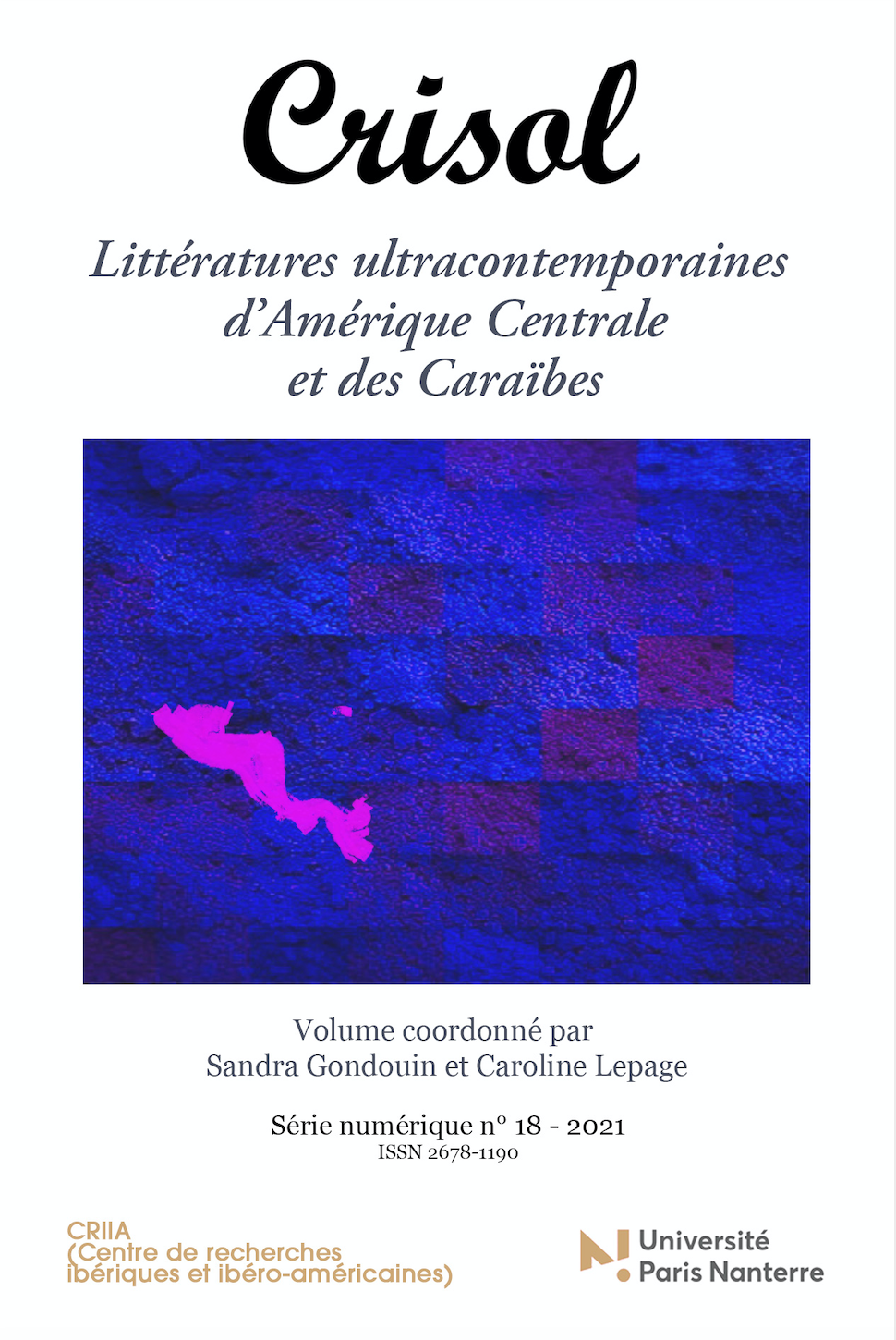 Littératures ultra-contemporaines d'Amérique Centrale et des Caraïbes
No 18 (2021)
Littératures ultra-contemporaines d'Amérique Centrale et des Caraïbes
No 18 (2021)En 1997 el escritor guatemalteco Arturo Arias afirmaba en la revista Kipus lo siguiente: “Un fantasma recorre la totalidad de la narrativa centroamericana: el fantasma de las literaturas invisibles. Una literatura invisible es una que nadie lee, nadie comenta, con la cual nadie dialoga, a la cual nadie toma en cuenta…”
Podría creerse que esto ha cambiado: desde el 2013 existe el Festival anual Centroamérica Cuenta, organizado principalmente por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez; han surgido revistas especializadas en literatura centroamericana como Istmo, Ístmica, Centroamericana, y está la publicación de los 6 tomos de Hacia una historia de las literaturas Centroamericanas. Podría parecer que las literaturas centroamericanas se han integrado al mundo globalizado.
No es la impresión que yo tengo. El Festival Centroamérica Cuenta, año con año, deja por fuera muchísimos narradores, poetas y dramaturgos centroamericanos y en cambio abunda en autores no centroamericanos (europeos, latinoamericanos). Esto podría ser una exigencia de los patronizadores, no sabemos, pero la sensación que muchos autores y autoras tenemos es que en Centroamérica Cuenta, Centroamérica NO cuenta.
Por otro lado, si bien existen las revistas mencionadas, su ámbito de difusión es muy reducido. Y respecto a que nuestra literatura se ha integrado al mundo globalizado, me temo que eso es así solamente para los autores que ya en 1997 estaban “globalizados”: Gioconda Belli, Rodrigo Rey Rosa, Sergio Ramírez, Horacio Castellanos Moya, por ejemplo.
Seguimos siendo una literatura invisible e invisibilizada para el resto del mundo a pesar de que hay muchos autores y autoras nuevas escribiendo con excelente calidad. Tenemos proyectos novedosos y geniales como el de la Editorial de Mujeres Abecedaria, estrictamente virtual y orgullosamente centroamericana.
Uno de los factores que contribuyen a esta invisibilización es que entre autores los centroamericanos no nos leemos y por lo tanto no nos ayudamos, no creamos “masa crítica”. Somos un área balcanizada. Los libros no circulan entre los diferentes países. Esto empezó a ser así a finales de los años noventa, cuando en general la literatura latinoamericana dejó de trascender fronteras, cuando ya no encontrábamos en nuestras librerías los libros de Editorial Sudamericana o de Losada, cuando murió el proyecto de EDUCA, que hacía circular los libros centroamericanos.
La razón tiene que ver, creo yo, con el neoliberalismo, que dejó al mercado la distribución de los autores. Los libros no circulan porque es más barato que se queden en su “mercado natural”, es decir, en el país del autor. Y en general nuestros países son poco lectores salvo de éxitos comerciales globalizados muy bien orquestados desde afuera, que son los que llenan los estantes de nuestras principales librerías.
Por supuesto que no todo es negro y hay editoriales como Penguin Random House que se esfuerzan en hacer circular los libros. Como ejemplo pongo mi experiencia con mi más reciente novela: Tocar a Diana. Interesó en Guatemala y entre la Editorial Penguin Random House y una organización llamada Alianza me invitaron a presentar la novela y a dar un taller. Incluso sentí una mayor acogida hacia mi novela en Guatemala que en mi propio “mercado natural”. Ojalá todas las demás editoriales hicieran esos esfuerzos y hubiera en las principales librerías de cada país (Sophos en Ciudad de Guatemala, El Hombre de la Mancha en Ciudad de Panamá, La Internacional en San José) un rincón de literatura centroamericana.
Por el momento mi conclusión es: sí, hemos avanzado un poquito. Pero demasiado poco. A los autores nos falta unión, generosidad -y en esto coincide conmigo Dante Liano, el escritor guatemalteco que vive en Italia pero publica en Guatemala- y vernos como colegas, no como competencia. Que en Centroamérica Cuenta, los centroamericanos contemos de verdad. Pero estamos muy lejos de integrarnos al mundo globalizado. El sistema de mercado y la orquestación comercial de Best Sellers mundiales traducidos o españoles es otro gran obstáculo. A veces siento que la literatura centroamericana, a pesar de que cuenta con excelentes autores y autoras de todas las edades, avanza al ritmo de Zenón, sí, el de la paradoja, que intenta salir de una habitación pero como cada vez su paso tiene que ser más pequeño que el anterior, nunca sale. Ojalá proyectos como Abecedaria y los esfuerzos de Editoriales como Penguin Random House cambien el ritmo de Zenón de la literatura centroamericana.
Anacristina Rossi
(Sandra Gondouin et Caroline Lepage remercient Ilona Ohana, Anne-Laure Potier et Lizeth Rayo Trujillo pour leur aide dans la mise en forme de ce volume)
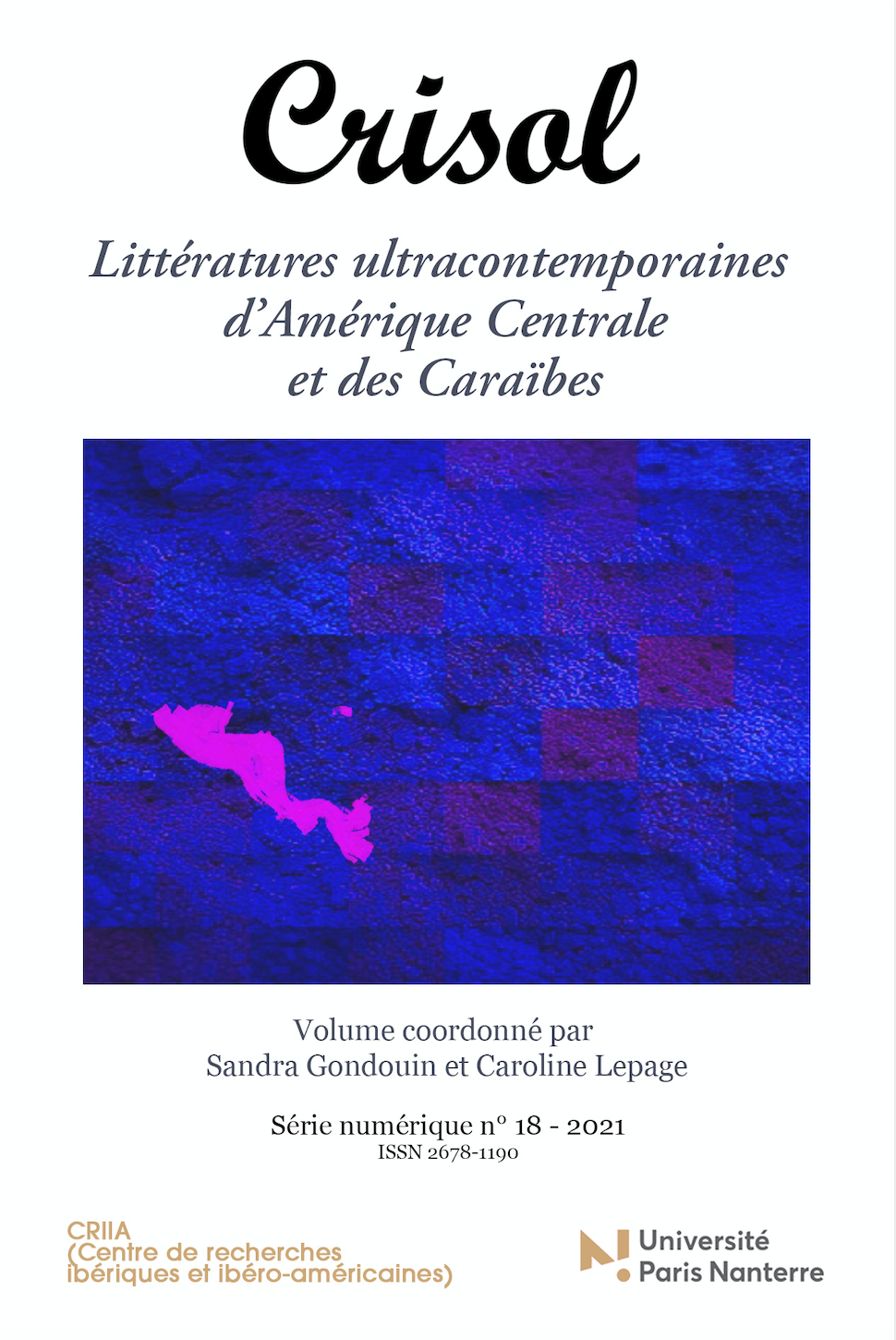
SOMMAIRE
Dante Liano (Università Cattolica di Milano), «Cambio de Paradigma»
Emanuela Jossa (Università della Calabria), «Cuatro formas de volver a casa. Escrituras centroamericanas del regreso»
Nathalie Besse (Universite de strasbourg - cher ur 4376), «Les romans nicaraguayens: entre désillusion et nouvelles résistances»
Nathalie Besse (Université de Strasbourg - cher ur 4376), «Tongolele no sabía bailar de Sergio Ramírez: entre pouvoirs et rébellions, la contribution du roman»
Davy Desmas (Université Toulouse Jean Jaurès (CEIIBA) / INU Champollion), «Cuídese de las fantasías, y ocúpese de la invención». La fugitiva de Sergio Ramírez ou l’illusion de l’hommage»
Caroline Lepage, Elsa Fernández et Diana Gil Herrero (Université Paris Nanterre – UR Études Romanes – CRIIA / HLH), «Féminisme et tentation classiste: le cas ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género – Panamá (2017)»
Audrey Louyer (Université de Reims Champagne-Ardenne / CIRLEP), «Les «cuentos» de Claudia Hernández: de l’autre côté du miroir»
Sophie Large (Université de Tours, ICD – EA 6297), «Subalternités et puissance d’agir: genre et sexualité dans El verbo J de Claudia Hernández»
Michela Craveri (Università Cattolica del Sacro Cuore), «Propuestas críticas en la poesía maya del nuevo milenio. Redes existenciales en la obra de Rosa Chávez»
Sara Carini (Università Cattolica Dde Sacro Cuore), «La poesía de Shirley Campbell Barr: reescribir el cuerpo, compartir su historia»
Sandra Gondouin (Université de Rouen Normandie ERIAC) et Jessica Pagazani (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), «Corporalité et autofiction: écrire la mémoire du corps dans Tocar a Diana (2019) d’Anacristina Rossi»
Émilie Boyer (Aix Marseille Université, CAER, Aix en Provence), «Mito precolombino y literatura juvenil: Quetzaltli, la lágrima del Creador de Javier Suazo Mejía»
Catherine Pélage (Université d’Orléans, Laboratoire REMELICE EA 4709), «Perspectivas artísticas caribeñas ultracontemporáneas: una aproximación a las performances literarias de Rita Indiana (República Dominicana)»
Dante Barrientos Tecún (Aix Marseille Université, CAER, Aix-en-Provence), «Paisajes y poesía de la costa Atlántica centroamericana: Tambor de pueblo (2013) de Carlos Castro Jo»
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
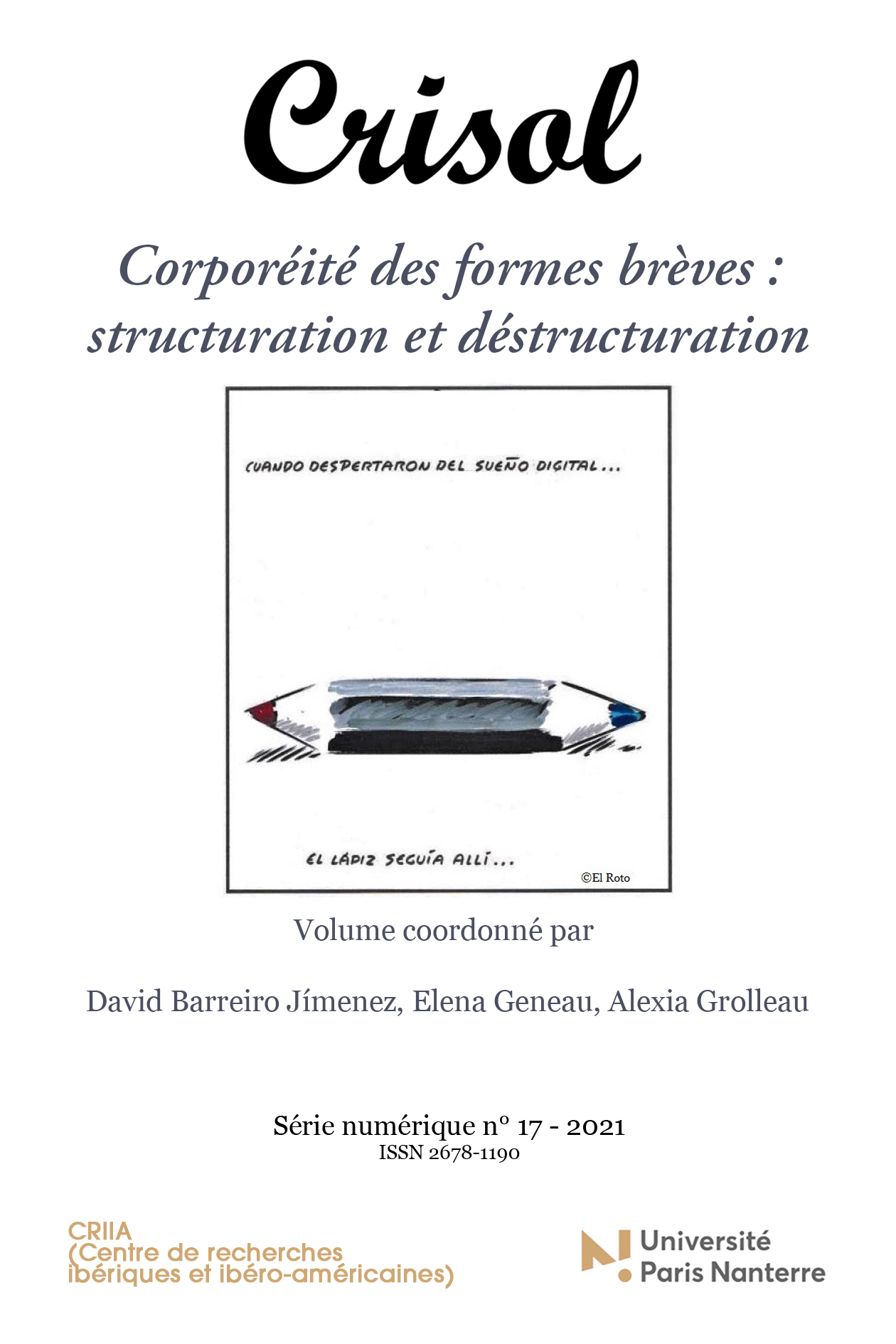 Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration
No 17 (2021)
Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration
No 17 (2021)Dans le cadre de ses travaux de recherche sur la littérature de langue espagnole, le GRELPP (Groupe de Recherche en Littérature, Philosophie et Psychanalyse) de l’Université Paris Nanterre publie le volume Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration. Le présent ouvrage est le fruit du colloque international du même nom ayant eu lieu le 19 et 20 avril 2018, à l’Université Paris Nanterre. Il se propose principalement de topographier, recenser et étudier les caractéristiques des formes brèves du texte et de l’image. En tant que canalisateurs formels et culturels de multiples formes de dire le temps et l’espace de la vie moderne, les formes brèves, telles des brèches protéiformes et mouvantes, ouvrent des perspectives sans cesse renouvelées; les interstices qu'elles (re)présent leur permettent de détruire l’idée d’une réalité ordinaire, constituée d'un seul bloc. Il s’agit, par ailleurs, d’un outil transversal qui combine, associe, voire transcende différents genres.
Lorsque George Poulet définit la forme brève comme «une ombre, une esquisse, une silhouette» (1), il met en avant son aspect éthéré, difficilement saisissable, à la fois visible et diffus. Bien que la relation comparative et contrastive entre chacune des manifestations des formes brèves paraisse toujours complexe, une délimitation des frontières du sujet s'impose. En effet, « le bref » se caractérise par sa polymorphie –laquelle brouille et confond sa définition–, il peut être de longueur variable et prendre différentes apparences. Aussi, il convient de tenir compte de la distinction entre le court, «plus long, plus prolixe, plus volumineux» (2), et le bref. Les formes le plus souvent répertoriées sont l'aphorisme, le micro-récit, le récit, le conte, la nouvelle, la poésie, l'épigraphe, le dicton ou encore, la devinette. Ces shots littéraires –aussi courts qu’intenses– font que chaque coup de plume doit gagner par knockout (3), là où, selon Julio Cortázar, le roman gagne aux points. Cependant, aujourd’hui encore, les formes brèves, versatiles et inclassables, ne constituent toujours pas un genre à part entière. En effet, elles se parent non seulement des couleurs des autres genres, mais aussi des atours de l'univers imagé, pour construire leur corporéité. Leur hybridité, issue tant de la transtextualité que de l’intermédialité, remet en cause, d'une certaine façon, les formes d'expression classiques (le roman, la poésie, le théâtre, le journalisme). Toutefois, les formes brèves ne se cantonnent pas à «dire le moderne» : contrairement aux idées reçues, qui affirment que leur extension les empêche d'embrasser une expression exhaustive, elles sont capables de dire le réel –et, plus précisément, l’intime– en cassant les codes littéraires préétablis et en fixant, au passage, de nouveaux codes par le biais duquel il est possible d’accéder à l’expression de l’indicible. En cela, elles semblent atteindre ce qui n'est jamais véritablement atteint par les autres formes littéraires en dehors de l'habitude d'un dire trop connu, toujours retrouvé et exprimé de la même manière. Bien que situées au bas de l'échelle sélective de la littérature classique, les formes brèves constituent toujours un projet d'écriture novateur et alternatif, peut-être la quintessence et l'une des composantes les plus stimulantes du renouveau littéraire.
Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration réunit dix-huit articles de chercheuses et de chercheurs hispanistes et américanistes de diverses nationalités. Les contributions traitent des formes brèves de l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Espagne, la France, le Guatemala, le Mexique, le Pérou et l’Uruguay et mènent une réflexion depuis des corpus et des champs théoriques et disciplinaires variés –la peinture, la littérature, la linguistique, l’histoire, le cinéma– et couvrent une large période allant du XVIe au XXIe siècle.
Ce volume s'organise en plusieurs parties afin de pouvoir montrer la diversité totalisatrice du genre.
Dans la première partie, intitulée «La typologie et les multiples vérités des formes brèves», Bernard Darbord recense, en guise de présentation et d’introduction, la typologie de l’ensemble des formes brèves, tandis qu’Antonia López étudie le cas spécifique du proverbe.
Dans «Sous le titre Coup de crayon: la substance plastique des formes brèves», Lina Iglesias (Université Paris Nanterre) et David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre) présentent la conférence du dessinateur satirique espagnol Andrés Rábago García (El Roto) sur son œuvre et ses leitmotivs.
Dans la troisième partie, «La prosodie des formes brèves», Gökçe Ergenekon (Université Lyon III) explore à son tour l’esthétique de la poésie de René Char, tandis qu’Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre) propose une approche intermédiale novatrice entre cinéma et poésie en étudiant le recueil de Roxana Miranda Rupailaf, Invocación al Shumpall et le court métrage de Gerardo Quezada El Shumpall.
La poésie ouvre la voie vers la quatrième partie, «La synergie du bref dans le théâtre», où Marjorie Colin (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III) traite des ambivalences de la brièveté dans l’univers beckettien, alors qu’Inès Guégo Rivalan (Université Paris Nanterre) montre la valeur sémiotique du bref en étudiant Diálogos de Federico García Lorca.
Dans la cinquième partie, nous avons rassemblé, sous le titre «Le bref à l’orée du temps et des genres», des articles qui abordent la brièveté dans les nouvelles, les bulletins, les essais et, finalement, les supports numériques. Ainsi, Florence Raynié (Université de Toulouse II – Jean Jaurès) analyse les formes brèves dans les romans et les nouvelles de Lope de Vega en s’interrogeant sur leurs caractéristiques entre tradition et modernité. Par la suite, Caroline Berge (Université Paris Nanterre) présente les bulletins de l’auteur équatorien César Dávila Andrade et sa nature hybride à la croisée des genres de la poésie et du théâtre. Puis, Javier Rodríguez Hidalgo (Université d’Angers) travaille l’essai dans l’œuvre de Julio Camba et s’interroge sur le statut de la chronique journalistique en tant qu’essai bref. Finalement, Martín Felipe Castagnet (Universidad Nacional de la Plata – Argentine) réfléchit sur les nouvelles façons de lire un texte bref à partir de l’analyse des blogs et de Twitter en Argentine.
Dans la sixième partie, «Les espaces du bref: bifurcations et convergences», nous proposons un voyage symbolique par le labyrinthe de la brièveté dans le Cône Sud. Dans un premier temps, Ricardo Torre (Université Paris Est – Créteil) analyse le blog de microrécits d'Andrés Neuman «Microrréplicas» en évoquant leur caractère intermédial et interculturel ainsi que la force des hyperliens propres au milieu digital. Ensuite, Pablo Silva Olazábal (écrivain et journaliste – Uruguay) fait un tour d’horizon de la microfiction uruguayenne en s'intéressant à quatre auteurs canoniques.
Dans la partie suivante, «Le dynamisme des formes brèves: de l’oscillation à l’éclat», quatre articles mettent en lumière l’imaginaire du mouvement et le dynamisme des formes brèves. Géraldine Monterroso (Cornell University – New York) analyse le mouvement des mouches, expressions minimales de l’esthétique littéraire d’Augusto Monterroso dans Movimiento perpetuo. Par la suite, Irène Kristeva (Université de Sofia – Bulgarie) s’interroge sur la force des Petits traités pour percer «comme un jet» la surface du quotidien dans les essais de Pascal Quignard. Puis, Javier Perucho (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) ouvre la voie sur les études de l’aphorisme mexicain, le «parent pauvre de la République Littéraire» et rend compte de la production aphoristique d’une dizaine d’auteurs contemporains. Enfin, Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) et Elsa Fernández (Professeure du secondaire) démontrent que le dynamisme des formes brèves peut aussi servir les intérêts politiques des revendications féministes présentes dans le volume collectif ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. México.
Ce volume se termine par une exploration de La salle des machines des formes brèves. Raúl Brasca, Carlos Amézaga, Jacques Fuentealba et Ana García Bergua, interrogés par Elena Geneau (Université Paris Nanterre), abordent les formes brèves et leur architecture depuis la perspective auctoriale.
Nous remercions tout particulièrement Andrés Rábago García de nous avoir accordé le droit de publier son dessin dans la couverture. Son image, forme brève par excellence, révèle de manière synthétique l'hommage à Monterroso et son microrécit « Le dinosaure », ainsi que l'oscillation entre tradition et modernité des formes brèves.
Elena Geneau, Alexia Grolleau et David Barreiro Jiménez
En el marco de las actividades de investigación sobre literatura en castellano, el laboratorio GRELPP (grupo de investigación de literatura, filosofía y sicoanálisis) de la Universidad Paris Nanterre publica el volumen Corporeidad de las formes breves: estructuración y destructuración. La presente obra es el resultado del coloquio internacional del mismo nombre, que tuvo lugar los días 19 y 20 de abril de 2018 en la Universidad Paris Nanterre. Se propone principalmente topografiar, enumerar y estudiar las características de las formas breves en textos e imágenes. Como canalizadores formales y culturales de las múltiples formas de expresión del tiempo y del espacio de la vida moderna, las formas breves, cuales brechas proteiformes y fluctuantes, abren perspectivas en constante renovación y por medio de estos intersticios, permiten erradicar la idea de una realidad ordinaria hecha de un solo bloque. Además, son una herramienta transversal que combina, asocia e incluso trasciende diferentes géneros.
Cuando George Poulet define la forma breve como «una sombra, un boceto, una silueta» (1), subraya su aspecto etéreo, difícil de captar, visible y difuso a la vez. Aunque la relación comparativa y contrastiva entre cada una de las manifestaciones de las formas breves es siempre compleja, es necesario delimitar sus fronteras. En efecto, «lo breve» se caracteriza por su polimorfismo –lo que enturbia y confunde su definición–, puede tener una longitud variable y adoptar distintas apariencias. Además es conveniente tener en cuenta la distinción entre lo corto, «más largo, más detallado, más voluminoso» (2), y lo breve. Las formas más citadas son el aforismo, el microrrelato, el relato, el cuento, la nouvelle, el poema, el epígrafe, el refrán o incluso la adivinanza. Estos shots literarios –tan cortos como intensos– hacen que cada trazo de pluma deba de ganarse por knockout (3), allí donde la novela, según Julio Cortázar, gana por puntos. Sin embargo, aún hoy, las formas breves, versátiles e inclasificables no constituyen un género en sí. De hecho, no solo se engalanan con los colores de otros géneros, sino también con los atuendos del universo de la imagen, para erigir su corporeidad. Su hibridez, derivada tanto de la transtextualidad como de la intermedialidad, cuestiona en cierto modo las formas clásicas de expresión (la novela, la poesía, el teatro, el periodismo). No obstante, las formas cortas no se limitan a «hablar de lo moderno»: contradiciendo la creencia popular, que afirma que su extensión les impide abarcar una expresión exhaustiva; estas formas son capaces de expresar lo real –y más precisamente, lo íntimo– quebrantando los códigos literarios preestablecidos y fijando, en este proceso, nuevos códigos a través de los cuales es posible acceder a la expresión de lo indecible. Como resultado, parecen conseguir lo que nunca logran realmente las otras formas literarias, que acostumbran a decir las cosas de forma demasiado conocida, siempre presentadas y expresadas del mismo modo. Aunque situadas en la parte inferior de la escala selectiva de la literatura clásica, las formas breves siguen constituyendo un proyecto de escritura innovador y alternativo que bien puede ser la quintaesencia y uno de los componentes más estimulantes de la renovación literaria.
Corporeidad de las formas breves: estructuración y destructuración reúne dieciocho artículos de investigadores hispanistas y americanistas de diversas nacionalidades. Hemos recopilado contribuciones sobre las formas breves de Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Las reflexiones se llevan a cabo desde diversos corpus y campos teóricos y disciplinarios –pintura, literatura, lingüística, historia, cine– y abarcan un amplio período que va desde el siglo XVI al siglo XXI.
Este volumen está organizado en varias partes, para poder mostrar la diversidad totalizadora del género.
En la primera parte, titulada «La tipología y las múltiples verdades de las formas breves», a modo de presentación e introducción Bernard Darbord enumera la tipología del conjunto de formas breves, mientras que Antonia López estudia el caso concreto del refrán.
Bajo el título «Trazo de lápiz: la sustancia plástica de las formas breves», Lina Iglesias (Universidad Paris Nanterre) y David Barreiro Jiménez (Universidad Paris Nanterre) presentan la conferencia del dibujante satírico español Andrés Rábago García (El Roto) sobre su obra y sus leitmotivs.
En la tercera parte, «La prosodia de las formes breves», Gökçe Ergenekon (Universidad Lyon III) explora a su turno la estética de la poesía de René Char, mientras que Alexia Grolleau (Universidad Paris Nanterre) propone un enfoque intermedial innovador entre el cine y la poesía mediante el estudio del poemario de Roxana Miranda Rupailaf, Invocación al Shumpall y el cortometraje de Gerardo Quezada El Shumpall.
La poesía abre paso a la cuarta parte, «La sinergia de lo breve en teatro», donde Marjorie Colin (Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris III) aborda las ambivalencias de la brevedad en el universo beckettiano, mientras que Inès Guégo Rivalan (Universidad Paris Nanterre) muestra el valor semiótico del escrito a partir del estudio de Diálogos de Federico García Lorca.
En la quinta parte hemos reunido, bajo el título «Lo breve a la linde del tiempo y de los géneros», artículos que abordan la brevedad en noticias, boletines, ensayos y, finalmente, medios digitales. Así, Florence Raynié (Universidad de Toulouse II – Jean Jaurès) analiza las formas breves en las novelas y cuentos de Lope de Vega cuestionando sus características entre tradición y modernidad. Caroline Berge (Universidad Paris Nanterre) presenta a continuación los boletines del autor ecuatoriano César Dávila Andrade y su carácter híbrido, en el cruce de los géneros poesía y teatro. Luego, Javier Rodríguez Hidalgo (Universidad de Angers) estudia el ensayo en la obra de Julio Camba y cuestiona el estatus de la crónica periodística como ensayo corto. Finalmente, Martín Felipe Castagnet (Universidad Nacional de la Plata – Argentina) reflexiona sobre las nuevas formas de leer un texto breve a partir del análisis de blogs y Twitter en Argentina.
En la sexta parte, «Los espacios de lo breve: bifurcaciones y convergencias», proponemos un viaje simbólico por el laberinto de la brevedad del Cono Sur. En primer lugar, Ricardo Torre (Universidad Paris Est – Créteil) analiza el blog de microrrelatos «Microrréplicas» de Andrés Neuman evocando su carácter intermedial e intercultural, así como la fuerza de los hipervínculos propios del mundo digital. A continuación, Pablo Silva Olazábal (escritor y periodista – Uruguay), ofrece un panorama de la microficción uruguaya centrándose en cuatro autores canónicos.
En la sección siguiente, «El dinamismo de las formas cortas: de la oscilación al esplendor», cuatro artículos dan testimonio del imaginario del movimiento y del dinamismo de las formas breves. En primer lugar, Géraldine Monterroso (Universidad de Cornell – Nueva York) analiza el movimiento de las moscas, expresiones mínimas de la estética literaria de Augusto Monterroso en Movimiento perpetuo. Posteriormente, Irène Kristeva (Universidad de Sofía – Bulgaria) cuestiona la fuerza de los Petits traités para perforar «como un chorro» la superficie de lo cotidiano en los ensayos de Pascal Quignard. Luego, Javier Perucho (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) abre el camino al estudio del aforismo mexicano, el «pariente pobre de la República Literaria» y nos informa sobre la producción aforística de diez autores contemporáneos. Por último, Caroline Lepage (Universidad Paris Nanterre) y Elsa Fernández (Profesora de secundaria) demuestran que el dinamismo de las formas breves también puede servir los intereses políticos de las reivindicaciones feministas presentadas en el volumen colectivo ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. México.
Este volumen se termina con una exploración de La sala de máquinas de las formas breves. Raúl Brasca, Carlos Amézaga, Jacques Fuentealba y Ana García Bergua, entrevistados por Elena Geneau (Universidad Paris Nantrre), abordan las formas breves y su arquitectura desde la perspectiva autorial.
Nuestro especial agradecimiento a Andrés Rábago García (El Roto) por habernos cedido el derecho a la publicación de su dibujo en la portada. Su imagen, forma breve por excelencia, revela a manera de síntesis tanto el homenaje a Monterroso y su microrrelato «El dinosaurio», como la oscilación entre tradición y modernidad de las formas breves.
Elena Geneau, Alexia Grolleau y David Barreiro Jiménez
(1) Georges Poulet, Études sur le temps humain 2, Paris, Éditions du Rocher, Plon, 1952, p.81-121.
(2) Alain Montandon, Les formes brèves, Paris, Hachette, 1992, p.4.
(3) Julio Cortázar, «Algunos aspectos del cuento», Obra crítica/2, - 2ª éd. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2014, p.347.
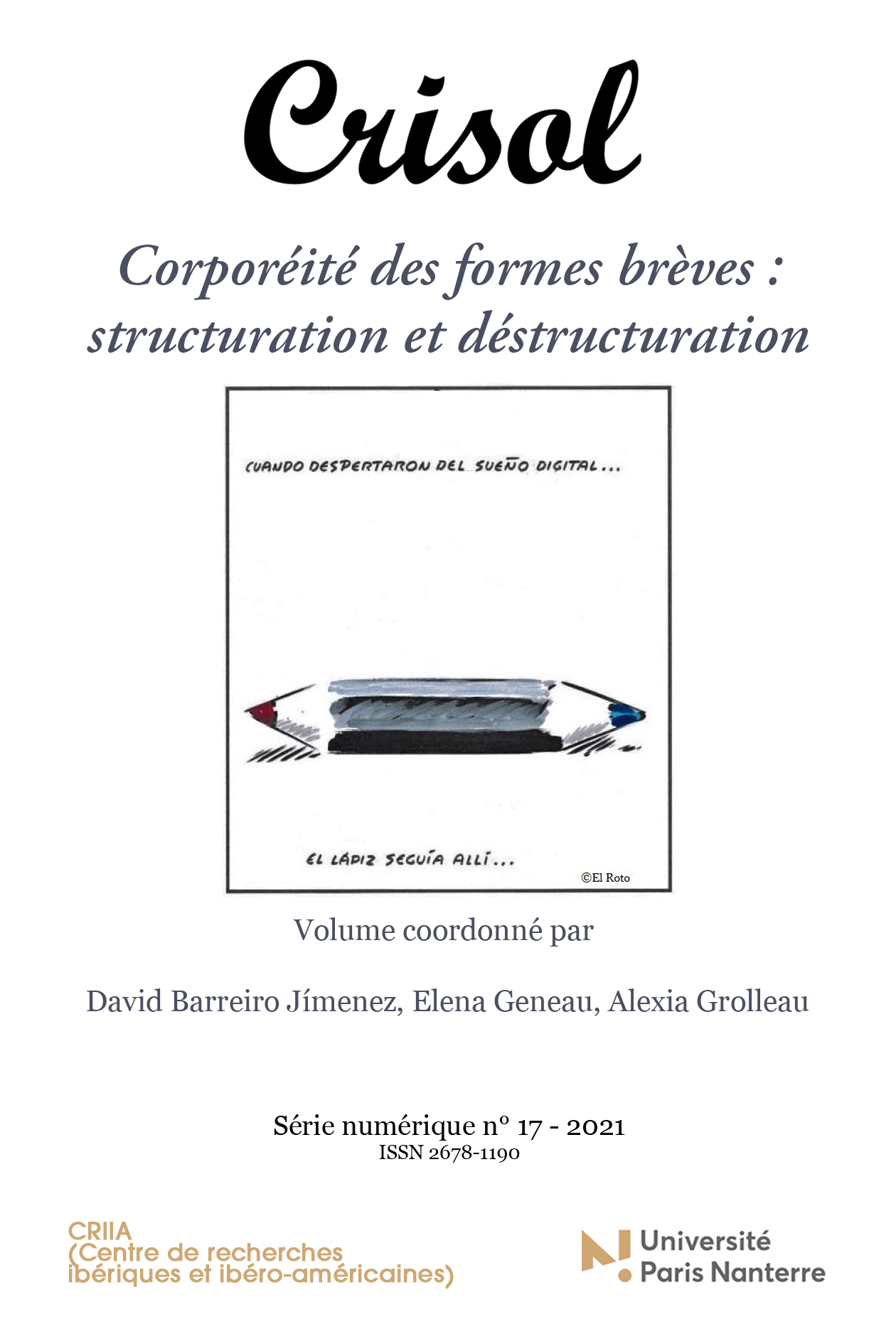
SOMMAIRE
1- La typologie et les multiples vérités des formes brèves
Bernard Darbord (Université Paris Nanterre), «Typologie des formes brèves»
Antonia López (Université Paris Nanterre), «Le proverbe: une forme brève pour de multiples vérités»
2- Coup de crayon: la substance plastique des formes brèves
Andrés Rábago García, dit «El Roto» (Dessinateur, El País – Espagne), conférence «Cortocircuitos». Introduction de Lina Iglesias (Université Paris Nanterre); présentation et transcription de David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre).
3- La prosodie des formes brèves
Gökçe Ergenekon (Université Lyon III), «L'éclair et l'éclat: poétique de la brièveté dans la poésie de René Char »
Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre), «Zoom sur El Shumpall: quand le vers rencontre la bobine»
4- La synergie du bref dans le théâtre
Marjorie Colin (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III), «Corporéité des formes brèves: la forme brève dans le théâtre de Beckett»
Inès Guégo Rivalan (Université Paris Nanterre), «Sémiotique du bref dans les Diálogos de Federico García Lorca. La dynamique du tableau»
5- Le bref à l'orée du temps et des genres
Florence Raynié (Université de Toulouse II – Jean Jaurès), «Les formes brèves dans les romans et les nouvelles de Lope de Vega: tradition ou modernité?»
Caroline Berge (Université Paris Nanterre), «Boletín y elegía de las mitas à la croisée des genres»
Javier Rodríguez Hidalgo (Université d’Angers), «Julio Camba, ¿ensayista? la crónica periodística como ensayo breve»
Martín Felipe Castagnet (Universidad Nacional de la Plata – Argentine), «“Pero sea corta”: la literatura en la época de la lectura y edición digital»
6- Les espaces du bref: bifurcations et convergences
Ricardo Torre (Université Paris Est – Créteil), «Mucho más que microrréplicas. Intermedialidad e inter-culturalidad en el blog de microrrelatos de Andrés Neuman»
Pablo Silva Olazábal (Écrivain et journaliste – Uruguay), «Breve paseo microficcional por la literatura uruguaya»
7- Le dynamisme des formes brèves: de l'oscillation à l'éclat
Geraldine Monterroso (Cornell University – New York), «El movimiento perpetuo: las moscas de Monterroso»
Irène Kristeva (Université de Sofia – Bulgarie), «Les "armes de jet" du Petit traité: la brièveté, la corporéité, l’explosivité»
Javier Perucho (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), «Lava de volcán. Erupciones del aforismo mexicano»
Caroline Lepage et Elsa Fernández (Université Paris Nanterre), «¡Basta! Mexique, un projet novateur et alternatif»
8. La salle des machines des formes brèves
Elena Geneau (Université Paris Nanterre), «Las formas breves desde la perspectiva autorial de Raúl Brasca, Carlos Amézaga, Jacques Fuentealba y Ana García Bergua».
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
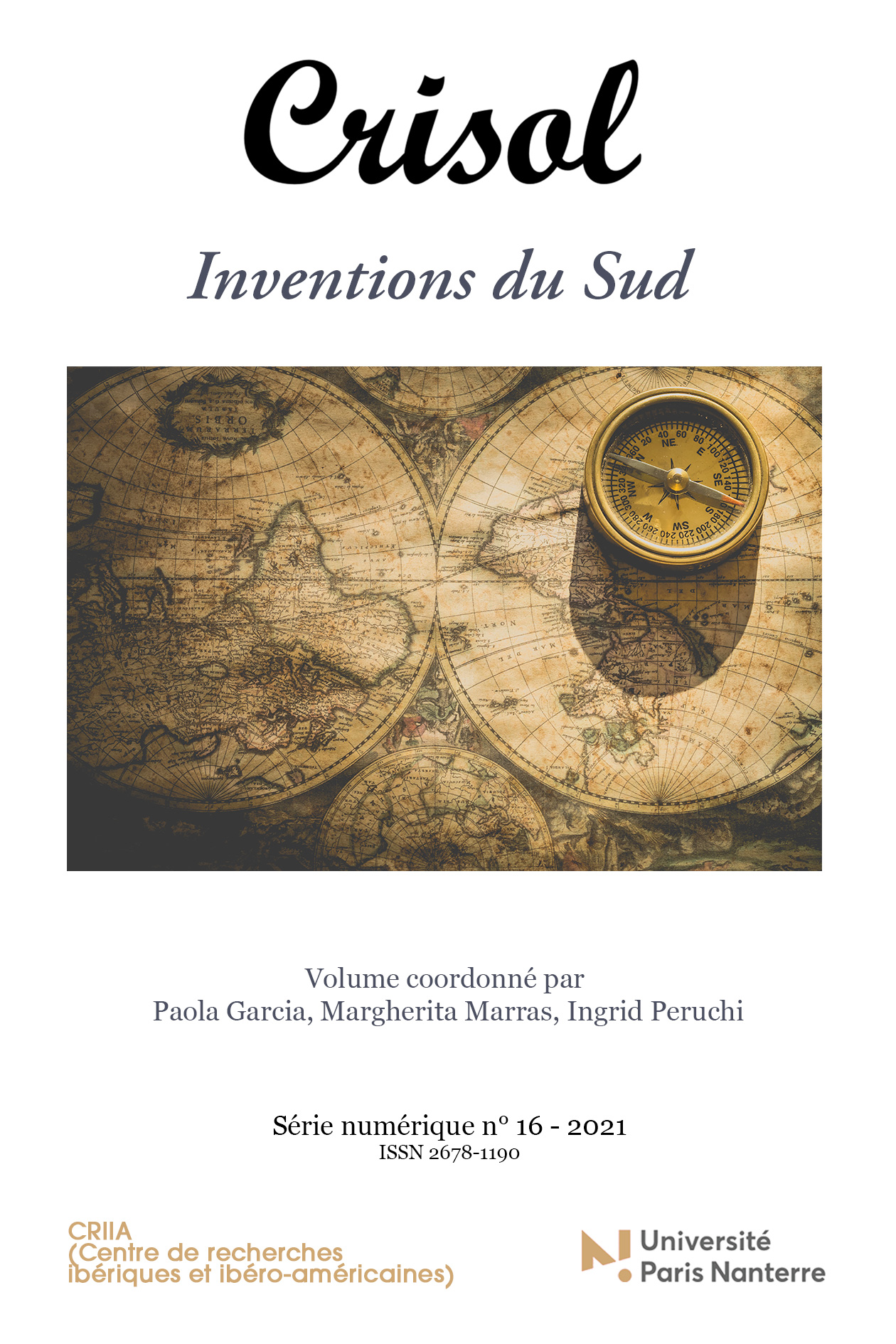 Inventions du Sud
No 16 (2021)
Inventions du Sud
No 16 (2021)Ce numéro monographique de la revue Crisol, intitulé Inventions du Sud, rend compte d'un projet collectif transversal qui, pendant plusieurs années, a alimenté nos recherches au sein du laboratoire d'Études romanes. Ce fut d'abord « Actuel(s) Sud(s). Dynamiques et transformations dans l’aire romane », une grande orientation de fond qui sous-tendait les activités communes aux trois aires linguistiques et culturelles de l’unité de recherche (hispanophone, italophone et lusophone) et aux trois équipes qui les représentent : le CRIIA, le CRIX et le CRILUS. Rappelons ici, notamment, deux importantes journées-séminaires, consacrées à Invention et réinvention du sud et des suds dans les pays de langues romanes (3-4 novembre 2016), qui ont été précédées par des réunions d'un groupe de réflexion, et qui ont vu la participation d'une bonne vingtaine d'enseignants-chercheurs, doctorants et docteurs de l'Unité. Pour poursuivre nos réflexions autour de la construction et des représentations du Sud, nous avons accueilli comme professeur invité, en 2017, Roberto Dainotto (Duke University), qui a donné deux conférences : « L’éthique du Sud et l’Esprit (romantique) de l'anticapitalisme » et « Le rôle conceptuel du Sud dans le développement d'une idée de l'Europe », puis en 2018, avec le même statut de professeur invité, Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel) et Elsa Lechner (CES Coimbra) : leurs conférences et interventions ont porté respectivement sur la légende noire et l'approche imagologique de la question du Sud (« A propos des stéréotypes et de l'imagologie », et « Banditisme littéraire au Mexique au XIXe siècle. El Zarco, le bandit aux yeux bleus »), et sur les récits de migrations, notamment intra-européennes en direction Sud-Nord (« L’émotion de la langue : la langue comme lien identitaire et culturel dans les milieux de l’émigration » et « (Dé)constructions des dichotomies sud/nord dans des ateliers biographiques avec migrants »). Lors de ces rencontres il a beaucoup été question des « imaginaires » du Sud, ce qui nous a conduit à repenser l’orientation de notre projet et à l’envisager de façon plus collective et plus ambitieuse : grâce à la solide contribution des collègues précédemment cités, nous avons élaboré un projet intitulé ArcSouth – « Archéologies du Sud : construction et usages des Suds dans l’Europe moderne et contemporaine ». Son point de départ était le constat qu’aujourd’hui on relève dans l’espace politique européen une nette résilience des idées nationales et nationalistes, ainsi que de fortes tensions ethniques, raciales et sociales. Or, que celles-ci soient internes à l’Europe ou qu’elles mettent en jeu les rapports avec d’autres espaces politico-géographiques, ces tensions s’expriment dans un langage opposant volontiers un Nord vertueux, productif, pragmatique, et un Sud réfractaire à l’organisation moderne du travail et des relations sociales, un Nord valorisé et dominant, et un Sud dominé et subalterne. Si elle est connue comme une opposition de lieux communs, cette dichotomie continue sans aucun doute à avoir des conséquences politiques et sociales, pratiques et concrètes, comme on le voit couramment dans la vulgate économique autour de la notion d’austérité, qui va au-delà de son seul sens budgétaire, pour mettre en regard des conduites. Pourtant cette vision dichotomique ne va pas de soi ; elle exploite et reprend pour le réinventer un imaginaire sur l’Europe du Sud qui s'est constitué au fil des siècles mêlant données « naturelles » et clichés. La vision du Sud prend ainsi corps dans des représentations artistiques et des textes, et plus généralement dans des formations discursives qui participent de la construction d’une identité européenne par la spatialisation et l’ordonnancement de ses composantes. Notre projet d’« archéologie du Sud » entendait décrire les productions sémiotiques et conceptuelles du Sud qui sous-tendent ces processus symboliques, et qui en retour s’en nourrissent. Autrement dit, notre objectif était de mieux comprendre (notamment dans une perspective diachronique) les conditions d’apparition et de réapparition ainsi que la matérialisation de la dichotomie nord-sud, pour analyser les usages qui en sont faits, et les effets (attendus et/ ou avérés) de ces usages, dans l'Europe moderne et contemporaine. ArcSouth a été présenté en 2017 en vue de l’obtention d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche pour le Montage de Réseaux Scientifiques (MRSEI/ANR), en partenariat avec huit autres partenaires européens (universités de Cologne, Bologne, Madrid, Cadix, Neuchâtel, Coimbra, Bari, Cagliari). L'Agence Nationale de la Recherche a reconnu l’intérêt de notre projet, en constatant qu’il correspondait bien aux préoccupations sociales et européennes actuelles, notamment du fait que nous proposions de nous pencher sur l'image des Suds à travers les migrations et le métissage, mais aussi que nous prévoyions de produire des instruments méthodologiques et des concepts nouveaux ; son format, cependant, ne correspondait pas aux exigences des gros projets H2020 que nous aurions dû viser. Nous avons préféré poursuivre dans d'autres directions. Notre grand axe de recherche a pu se décliner dans d'autres projets transversaux (par exemple, le projet UPL Mondialités mineures, vers une géopolitique des savoirs et des littératures qui a donné lieu à la récente anthologie Penser la différence culturelle du Colonial au Mondial, où la question du Global South est très présente), ou par aire linguistique (par exemple, un volume de la revue « Narrativa » plus spécifiquement consacré à l'Italie contemporaine, Les nouvelles frontières du Sud, est sorti en 2018). Le projet commun de l'UR Études Romanes a trouvé son aboutissement avec le colloque Inventions du Sud. Quand le Sud construit le Sud, quand le Sud construit le Nord, quand le Sud se construit comme Nord... (champs hispanophone, lusophone, italophone), organisé à Nanterre en juin 2019, dont le présent volume publie une sélection des communications. Sans vouloir mettre un point final à nos réflexions et nos recherches, ce colloque – et partant ce volume – se propose de faire le point sur les acquis théoriques et conceptuels, sur les méthodologies, sur les problématiques que nous avions abordées tout au long de ces quatre années. Dans notre rôle de directeurs du laboratoire Études Romanes au cours de la période concernée, nous avons accompagné et animé ces réflexions et ces recherches, nous avons participé à l'organisation scientifique des manifestations organisées. C'est donc avec satisfaction que nous voyons se concrétiser en cet ouvrage les résultats de nos travaux collectifs.
Silvia Contarini et Christophe Couderc
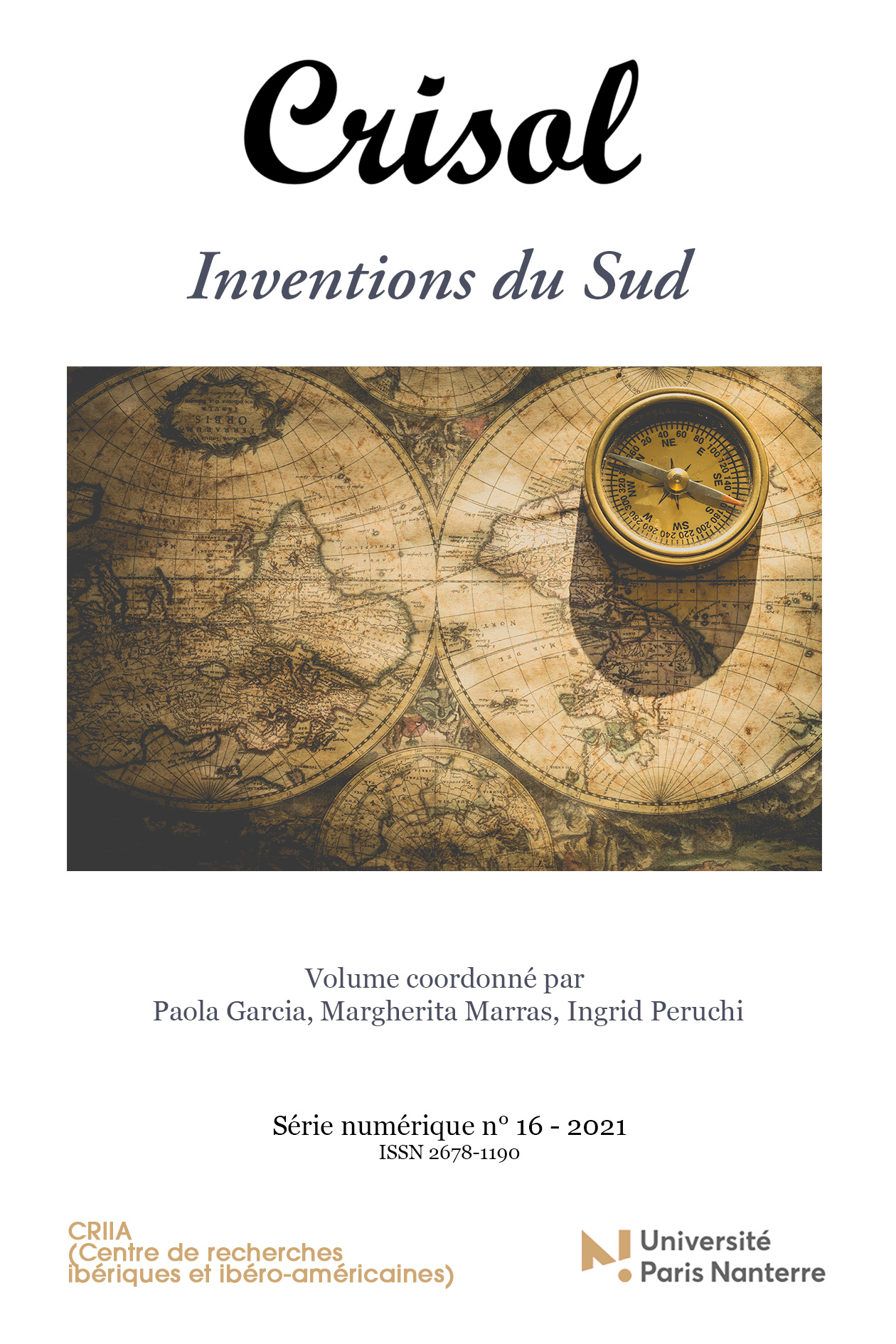
SOMMAIRE
Françoise Dufour (La Langagière), «Du «Nord» au «Sud»: translation terminologique et impérialisme du sens»
Lorenzo Ravano (Université Paris Nanterre), «La notion de global South et l’histoire de la pensée politique»
Ramona Onnis Université (Paris Nanterre – EA 369 / CRIX), «Le Sud est-il le lieu de l’altérité? Pensées méridienne et antiméridienne»
Alessandro Benucci (Université Paris Nanterre – CRIX), «“Il Bel paese”: variations sur ce thème entre l’oubli et le souvenir, le passé et l’avenir»
Margherita Marras (Avignon Université - CRIX, Université Paris Nanterre), «Les différentes représentations du Sud et des gens du Sud dans les discours léguistes (Ligue du Nord et Ligue pour Salvini Premier)»
Giuliana Benvenuti (Università di Bologna), «Miti di Sicilia. Il commissario Montalbano di Camilleri e lo stereotipo dell’uomo mediterraneo»
Dalila Chine-Lehmann (Université Paris Nanterre), «Le refus de "n'être rien". Représentations du Sud dans les manuels de Sciences Sociales mexicains (1972-1988)»
Marie Lecouvey (Université Paris Nanterre) et Helia Bonilla (Dirección de Estudios Históricos, INAH México), «Le Mexique, pays du Nord? Auto-représentation des Mexicains dans deux publications illustrées (1854)»
Jorge Villaverde (CRIMIC- Sorbonne Université), «Une approche imagologique du Sud: voyage et tourisme dans un empire informel»
Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel), «Estereotipos nacionales en la novela bizantina española de entresiglos: la Selva de aventuras de Jerónimo Contreras (1582) y El peregrino en su patria (1604) de Lope de Vega»
Sandra Assunção Université (Paris Nanterre – UE 369/ CRILUS), « L’invention de la nation métisse dans Gabriela, girofle et cannelle de Jorge Amado»
Crisol remercie les réviseurs externes de ce volume :
Silvia CONTARINI (Université Paris Nanterre)
Graça DOS SANTOS (Université Paris Nanterre)
Magali DUMOUSSEAU (Avignon Université )
Laurent LOMBARD (Avignon Université)
Franco MANAI (University of Aukland)
Giulia MANERA (Université de Guyane)
Carlos TOUS (Université de Tours)
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
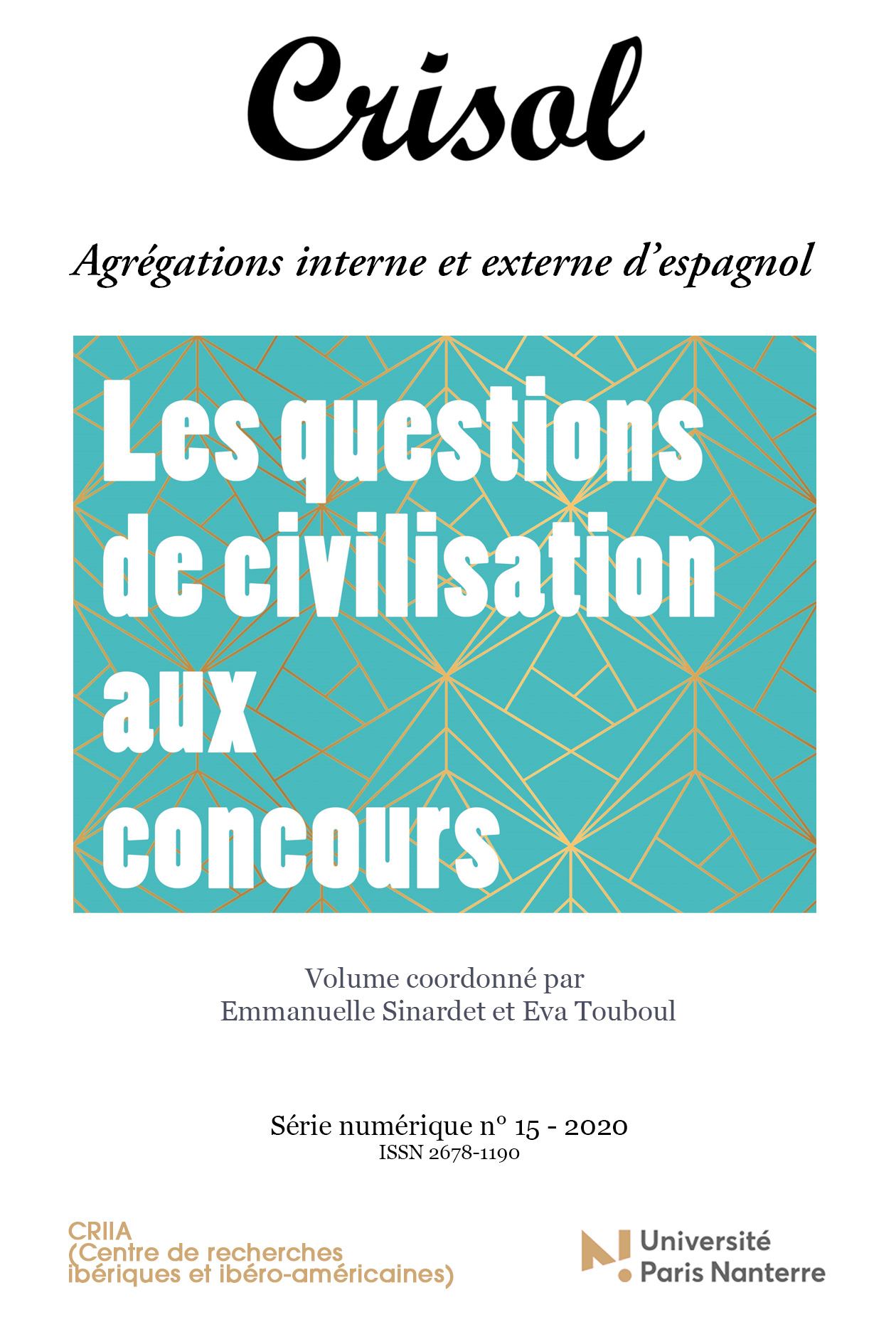 La civilisation aux concours - Amérique latine, Espagne
No 15 (2020)
La civilisation aux concours - Amérique latine, Espagne
No 15 (2020)Ce volume de Crisol prolonge la journée d’études consacrée aux questions de civilisation aux concours de la session 2020, qui sont maintenues au programme de la session 2021 de l’agrégation externe. Cette journée d’études, co-organisée par le CRIIA de l’Université Paris Nanterre et par l’IdA Institut des Amériques, s’est tenue le samedi 11 janvier 2020.
Le sujet de civilisation espagnole contemporaine marque un tournant dans l’histoire récente de l’hispanisme, en mettant en lumière un media considéré pendant longtemps comme peu digne d’une étude scientifique : la bande dessinée. Les travaux de Viviane Alary, Roselyne Mogin-Martin ou Benoît Mitaine, en France, ont déjà ouvert la voie depuis plus de vingt ans à la reconnaissance de cet objet d’études à la fois artistiques, littéraires et civilisationnelles. C’est cette dernière perspective qu’adopte le programme de l’agrégation externe d’espagnol, en proposant d’étudier l’élaboration d’une mémoire de l’après-guerre civile au moyen d’un support de culture populaire : la bande dessinée pour adultes. Les quatre ouvrages proposés couvrent presque 40 ans de création mais aussi de réflexion sur ce que fut l’après-guerre pour l’immense majorité de la population espagnole, depuis des points de vue différents, du fait de la personnalité de leurs auteurs, et de leur méthode de travail. Comme le rappelle Pierre-Alain De Bois dans l’article qu’il lui consacre, Paracuellos (1977-2003), la série de Carlos Giménez, s’appuie dans un premier temps sur les souvenirs de son auteur ; assez rapidement cependant, elle devient un support commun de mémoire, en ajoutant et entremêlant les récits d’autres témoins, au point de devenir une sorte de chronique collective d’une enfance sous le franquisme, dans les foyers de l’Auxilio Social. Autre forme de mémoire collective, celle des prisonnières républicaines dans les geôles franquistes que représentent Jorge García et Fidel Martínez dans Cuerda de presas (2005) : l’auteur et le dessinateur, nés à la fin des années 1970, n’ont évidemment rien vécu de ce qu’ils narrent, mais s’appuie sur les témoignages recueillis par d’anciennes victimes de la répression auprès de leurs co-détenues ; la plupart des femmes qui apparaissent dans les brefs récits de ce recueil sont des anonymes, ce qui offre à leur histoire un pouvoir de représentativité très fort. Les deux œuvres restantes s’ancrent à la fois plus dans la fiction, tout en conservant un souci de réalisme, et donc de dimension documentaire très marquée. Ainsi Los surcos del azar (2013) dans lequel Paco Roca imagine et chronique la rencontre entre un dessinateur espagnol quadragénaire et un ancien soldat républicain, incorporé par la suite aux Forces Françaises Libres et resté vivre en France sous une fausse identité, et le récit que ce dernier fait de son expérience de la guerre. Camille Pouzol interroge le passage de témoin(s) dans ce roman graphique, en montrant que les ressources particulières du genre, mêlant image et texte, sont particulièrement bien exploitées par le dessinateur valencien, dans son projet de créer une illusion de vérité, qui rende hommage à des hommes trop longtemps oubliés. Eduardo Hernández Cano s’intéresse quant à lui au scénariste de El Artefacto Perverso, Felipe Hernández Cava, en rappelant que ton intérêt pour cette période de l’immédiat après-guerre n’apparaît pas de manière soudaine à l’occasion de son travail avec le dessinateur Federico del Barrio, mais qu’il s’agit d’une constante depuis ses débuts pendant la Transition. Son article rappelle aussi combien cette question de la mémoire du système répressif mis en place par le régime franquiste a été prégnante dans l’apparition et le développement en Espagne d’une bande dessinée adulte, et qu’Hernández Cava, individuellement ou dans le cadre de collectifs, y a pris une part importante.
Le sujet de civilisation portant sur l’Amérique latine, « Explorations, conquêtes et revers de conquête : les confins amérindiens de l’Amérique du Sud (années 1530 - années 1600) », partage avec le sujet de civilisation espagnole l’ambition et l’intérêt de mettre en lumière des éléments et thématiques peu traités par l’historiographie « classique ». Il invite ainsi à déplacer le regard vers des espaces peu étudiés en tant que tels, situés sur les marches australes de l’empire au 16e siècle, et vers des acteurs invisibilisés et dont il s’agit de mettre en évidence l’agentivité, les populations amérindiennes. Employer le terme de « confins », plutôt que celui de « marge » ou de « périphérie » n’est pas innocent : il s’agit bien de dépasser la traditionnelle et réductrice dichotomie centre/périphérie, selon laquelle la périphérie serait un prolongement du centre, dépourvu de dynamique propre, ou bien un espace d’importance secondaire face à un centre où s’exprimeraient les principaux enjeux et acteurs d’une époque. Car, pour reprendre l’expression de Reynaud dans son essai Société, Espace et Justice publié en 1981, si le centre est là où les choses se passent, alors ces confins présentés comme lointains doivent être considérés comme des centres. En effet, il s’y passe beaucoup de choses qui éclairent d’un jour nouveau les processus de la conquête et de la colonisation espagnoles. L’étude de ces confins contribue, comme le fait Matthew Restall dans son célèbre Seven Myths of the Spanish Conquest publié en 2003, à remettre en question la légende historiographique d’une Conquête éclair, en montrant les difficultés, les défaites et les échecs de celle-ci et son caractère inachevé dans les années 1610. Ces confins s’avèrent aussi des centres lorsque s’y nouent les rivalités géopolitiques entre puissances européennes, dans le détroit de Magellan par exemple, situé aux confins des confins qu’est le sud chilien, mais pourtant espace stratégique de l’accès au Pacifique. C’est précisément ce que s’emploie à montrer Hélène Roy, dans son article « Les confins amérindiens au cœur du pouvoir : stratégie de carrière des conquérants et enjeux géopolitiques pour la Monarchie hispanique. Le cas d’Álvar Núñez Cabeza de Vaca (XVIe siècle) ». Si elle admet que les confins sont des territoires aux marges, échappant totalement ou en partie au contrôle de la Couronne, c’est pour mieux souligner qu’il existe une géopolitique des confins qui se met en place en réponse aux poussées expansionnistes de rivaux européens dans les Indes. Hélène Roy montre également que ces confins signifient des enjeux importants pour la politique intérieure du Pérou, car ils représentent, dans la seconde moitié du 16e siècle, les derniers réservoirs possibles de richesses dans le vice-royaume. Les soldats exclus des butins des premières vagues de conquête peuvent espérer y réaliser leur rêve de richesses et d’honneurs, comme l’atteste, du reste, le déplacement continu des horizons mythiques de l’Eldorado ou de la Cité des Césars vers ces espaces. Parce qu’ils permettent de « descargar la tierra » – pour reprendre l’expression utilisée dès les années 1540 –, les confins contribuent à la consolidation d’un édifice colonial encore fragile au Pérou, en raison des différends et guerres civiles. Pour sa part, dans l’article « Une poétique des confins : La Araucana (Chili, second XVIe siècle) », Aude Plagnard revient sur une caractéristique essentielle des confins amérindiens étudiés, leur instabilité non seulement militaire, mais aussi politique et culturelle. Elle observe alors comment les acteurs de la conquête y produisent de nouveaux récits, en particulier poétiques, devant contribuer à les inscrire dans une tradition épique, alors même qu’ils subissent échecs et défaites. Aude Plagnard s’appuie sur le cas chilien et en particulier sur le poème épique La Araucana, car l’œuvre joue un rôle essentiel dans la construction d’une matrice discursive où les « revers de conquête », pour reprendre l’intitulé su sujet de l’agrégation, servent la construction d’une figure de l’adversaire araucan à la mesure des exploits espagnols et participent du récit d’une glorieuse épopée chilienne. Aude Plagnard y voit là le trait majeur d’une « poétique des confins », où les récits restent forcément inachevés, puisque les adversaires résistent héroïquement à l’expansion coloniale de la Couronne et que la Conquête reste inachevée.
Avec ce volume 15 de Crisol, nous espérons à la fois donner des outils aux candidats à l’agrégation à la session 2021 pour se préparer au concours, mais aussi participer à la construction d’une réflexion sur ces deux sujets qui, espérons-le, continueront d’inspirer la recherche en civilisation latino-américaine et espagnole dans les prochaines années.
Emmanuelle Sinardet, Eva Touboul
La journée d'étude et les débats sont disponibles en video ici:
- Amérique
- Espagne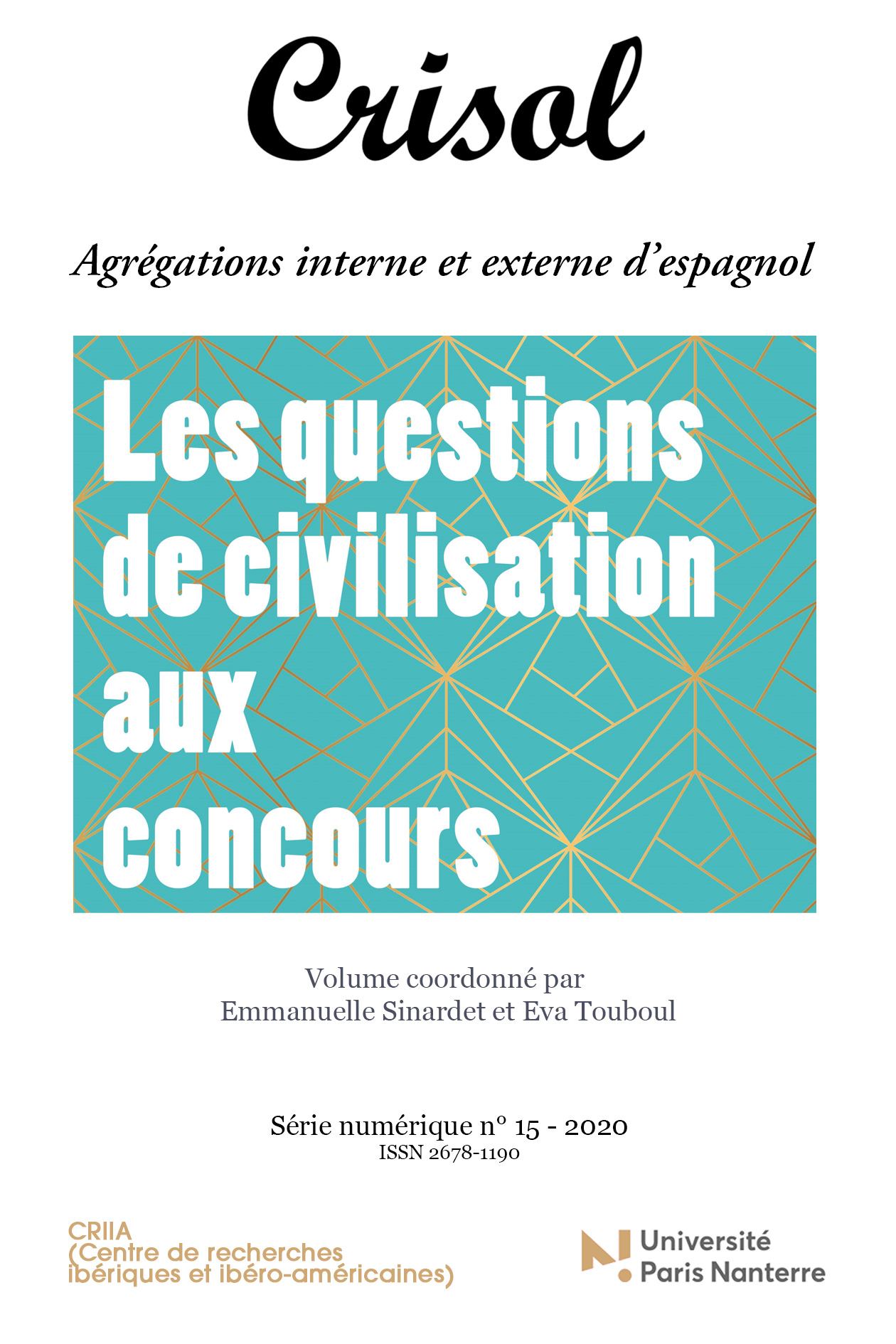
SOMMAIRE
Pierre-Alain De Bois, "La bande dessinée Paracuellos: entre mémoire individuelle et mémoire collective d’une enfance sous le franquisme"
Camille Pouzol, "Los surcos del azar ou les jeux de témoin : les différents "je" et le langage bédéïque entre mémoire et hommage"
Eduardo Hernández Cano, "Memoria y mercado de la historieta. Cuatro obras en su campo cultural"
Hélène Roy, "Les confins amérindiens au cœur du pouvoir : stratégie de carrière des conquérants et enjeux géopolitiques pour la Monarchie hispanique. Le cas d’Álvar Núñez Cabeza de Vaca (XVIe siècle)"
Aude Plagnard, "Une poétique des confins : La Araucana (Chili, second XVIe siècle)"
***
Compte-rendu de lecture
Compte-rendu de lecture (Emmanuelle Sinardet): Guápulo d’Alfredo Noriega, roman quiténien endeuillé
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr
-
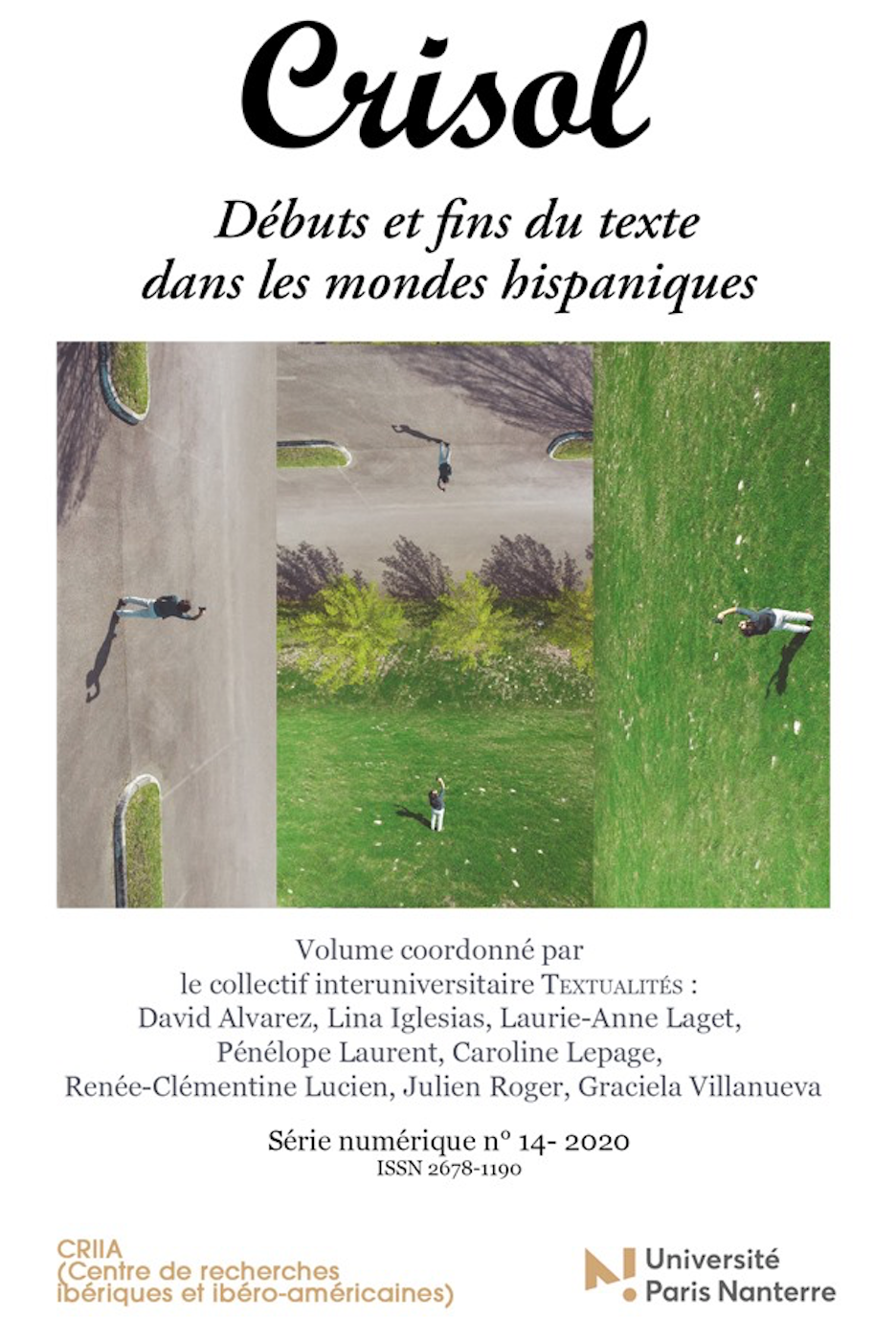 Débuts et fins du texte dans les mondes hispaniques
No 14 (2020)
Débuts et fins du texte dans les mondes hispaniques
No 14 (2020)«Principio y final del texto, polos inestables de la linealidad»
En uno de sus célebres cuentos (que el narrador presenta no como relato fantástico sino como relato verídico), Jorge Luis Borges imagina un misterioso libro de arena que incluye un número infinito de páginas siempre diferentes. Ese libro, que comienza despertando en el protagonista una enorme curiosidad y un irrefrenable deseo de posesión, acaba convirtiéndose en su cárcel y en su pesadilla, horror del que el poseedor (el poseído) sólo logra alejarse un poco cuando consigue desprenderse de su indeseable tesoro depositándolo sobre uno de los húmedos anaqueles del sótano de la Biblioteca Nacional. El libro de arena no tiene ni principio ni fin. Objeto obsceno que infama y corrompe la realidad, el libro monstruoso no sólo es incomprensible sino que además irradia sinsentido. Y es que el hombre sólo puede pensar en el contexto de un kairos que, como lo bien observa Frank Kermode en El sentido de un final, bosqueja, en el recorrido que va de un tic a un tac, un orden. El chronos absolutamente inaprehensible e imprevisible impide el pensamiento. El hombre sólo puede encontrar sentido a lo que lee y a lo que vive en un marco en que puedan percibirse o inventarse principios y finales, por extraños o sorprendentes que estos puedan parecer.
El objetivo de este volumen es reflexionar, a partir de la producción literaria y audiovisual del mundo hispánico, sobre el principio, sobre el final y sobre la articulación entre estos bordes textuales. El artículo que abre el volumen aclara los términos desde el punto de vista teórico y, siguiendo a Andrea del Lungo, considera que el principio y el final de un texto son polos inestables de una linealidad cuya precariedad es indisociable del enigma de la significación y del sentido. La primera parte del volumen, titulada "Incipere non discitur", reúne una serie de artículos que estudian el funcionamiento del incipit en la literatura clásica (el teatro de Lope de Vega, el Quijote de Avellaneda), en la literatura del siglo XIX (la novela de Emilia Pardo Bazán, la poesía hispanoamericana) y en la producción literaria y audiovisual del siglo XX (novela, poesía, videojuego). La segunda parte del volumen, titulada "Leer desde el principio hasta el final", reúne una serie de artículos que estudian la tensión entre los dos bordes del texto en la literatura clásica (las crónicas de Alvar Núñez Cabeza de Vaca), en la novela española del siglo XIX (la novela de Emilia Pardo Bazán) y en la producción literaria y audiovisual de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI (la novela Rayuela y los cuentos de Queremos tanto a Glenda de Julio Cortázar, la poesía del argentino Juan L Ortiz, la ficción cinematográfica del argentino Hugo Santiago, la narrativa de la chilena Lina Meruane y las novelas de los argentinos Samanta Schweblin y Hernán Ronsino y del cubano Leonardo Padura).
Graciela Villanueva (Université Paris-Est-Creteil, Imager)
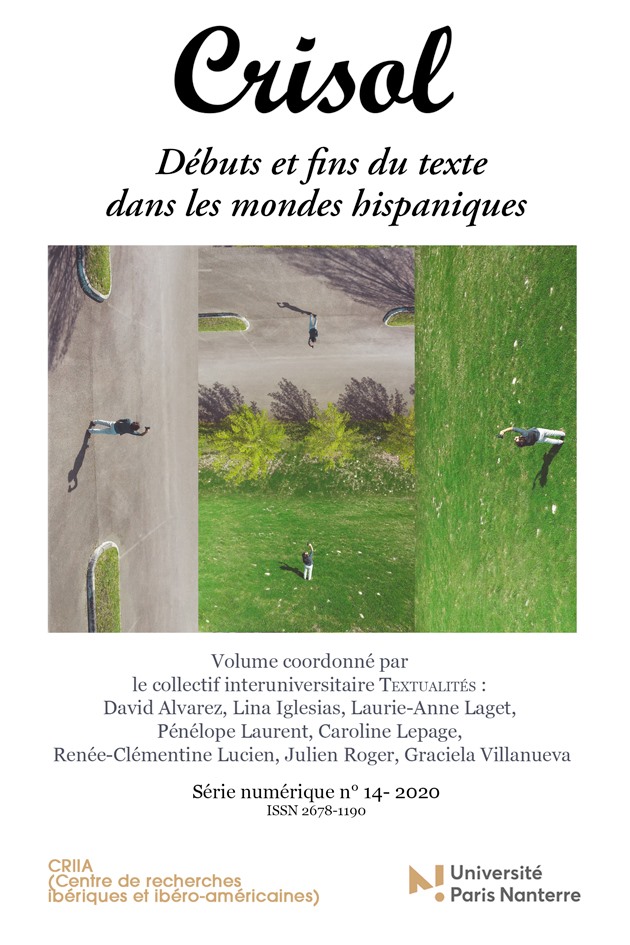
SOMMAIRE
Introduction
Graciela Villanueva (Université Paris-Est-Creteil, Imager), «Principio y final del texto, polos inestables de la linealidad»
I. Incipere non discitur
A este respecto puedo recordar aquí la leyenda que preside en grandes letras de oro la sala de párvulos de la Escuela de Ballet de nuestro querido Teatro Colón, y que no bien aprendíamos a leer nos hacían descifrar nuestros maestros, inculcándonos pacientemente su significado (pues estaba, y está, en latín) : INCIPERE NON DISCITUR. O sea : « No se aprende a empezar », frase cuya moraleja es : « Se empieza », César Aira, El volante (1992)
Philippe Meunier (Université Lumière Lyon 2), «Lo que está en juego en el íncipit teatral. El caso de La dama boba de Lope de Vega»
David Álvarez Roblin (CEHA – Université de Picardie Jules Verne), «Le début du Don Quichotte d’Avellaneda et ses enjeux»
Yves Germain (CRIMIC – Sorbonne Université), «Le paratexte ludique et paradoxal de La desheredada»
Sylvie Turc-Zinopoulos (Université Paris Nanterre Criia– Études Romanes), «L’incipit de La Tribuna (1883) de Emilia Pardo Bazán»
Hervé Le Corre (CRICCAL Université Paris 3 Sorbonne-nouvelle), «Commencer le poème. De quelques incipit dans la poésie hispano-américaine du XIXe siècle»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre – Études Romanes / CRIIA-GRELPP), «Les débuts hors la norme: étude de 5 cas»
Lina Iglesias Université Paris Nanterre – Études Romanes – CRIIA / GRELPP, «À la croisée de la poésie et de l’Histoire: l’incipit chez David González et Joan Margarit»
Emmanuel Vincenot (Université Gustave Eiffel – LISAA), «Début du texte, début du jeu : le cas de Rime [Tequila Works, 2017]»
II. Leer desde el principio hasta el final
«Signori, devo premettere che a me nei libri piace leggere solo quello che c'è scritto; e collegare i particolari con tutto l'insieme; e certe letture considerarle come definitive; e mi piace tener staccato un libro dall'altro, ognuno per quel che ha di diverso e di nuovo; e soprattutto mi piacciono i libri da leggere dal principio alla fine. Ma da un po' di tempo in qua tutto mi va per storto: mi sembra che ormai al mondo esistano solo storie che restano in sospeso e si perdono per strada», Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979)
Hélène Roy (Université de Poitiers / CRLA-Archivos), «Les deux débuts et les deux fins de Naufragios (1542) d’Álvar Núñez Cabeza de Vaca»
Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université – Crimic, Iuf), «Du naturalisme à la satire politique: le début et la fin de La Tribuna d’Emilia Pardo Bazán»
Joséphine Marie Université (Paris-Est Marne-la-Vallée UGE/LISAA -EMHIS), «Où commence la fin, où finit le début? Des possibles lectures de Rayuela et du cas 55»
Sergio Delgado (Université Paris Est Créteil, IMAGER), «La intemperie sin fin»
Julien Roger (Sorbonne Université - CRIMIC / EA 2561), «Commencer et finir dans Queremos tanto a Glenda de Julio Cortázar»
Andra Barbu (Chercheuse associée ERIAC Université de Rouen), «Lire hors de vue. Où commence et où finit l’histoire de «Mal de ojo» et Sangre en el ojo de Lina Meruane?»
Pénélope Laurent (Sorbonne Université –CRIMIC), «Distancia de rescate, de Samanta Schweblin (2014). En el filo de la palabra»
Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «Buenos Aires transfigurée: analyse des séquences d’ouverture et de clôture dans Invasión et El cielo del centauro de Hugo Santiago»
Laura Gentilezza (Université Paris-Est IMAGER-CREER/ Red Li. Ri. Co.), «Principios y finales en el íncipit de un proyecto literario: notas sobre Ronsino»
Clémentine Lucien (CRIMIC-EA 2561 – Sorbonne Université-Faculté des Lettres), «La transparencia del tiempo de Leonardo Padura: Où l’ouverture est aussi fermeture»
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
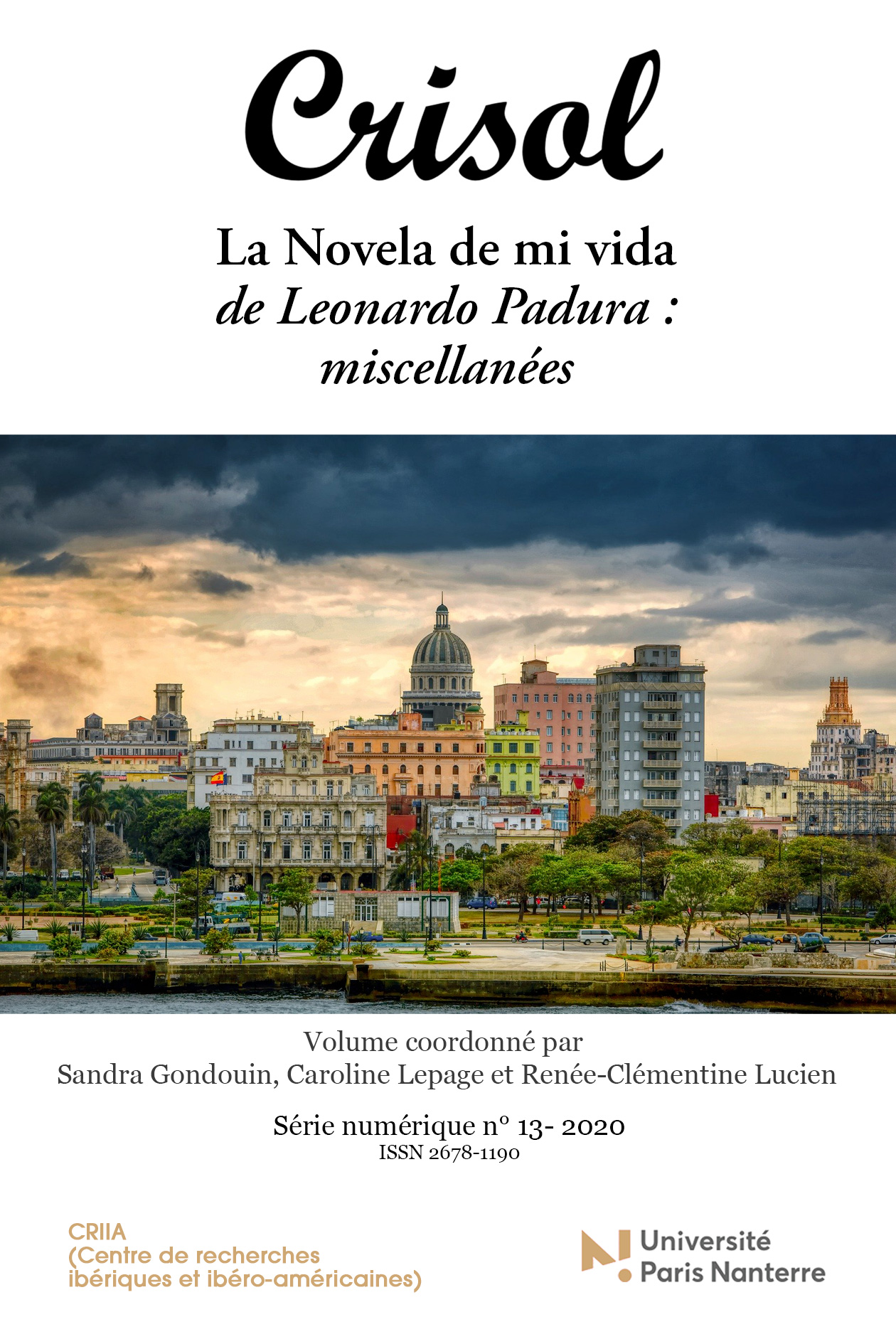 La novela de mi vida de Leonardo Padura: miscellanées
No 13 (2020)
La novela de mi vida de Leonardo Padura: miscellanées
No 13 (2020)Ce numéro 13 de Crisol–série numérique prend une forme inédite, puisqu'il s'agit d'un volume ouvert et en mouvement: de nouvelles contributions viendront progressivement s'y ajouter au cours des deux prochaines années. Ce projet a effectivement été pensé dans le cadre de la préparation au concours de l'Agrégation externe d'espagnol 2021-2022 et il a semblé aux coordinatrices, d'une part, utile de mettre la matière critique disponible immédiatement à la disposition des étudiants-candidats; d'autre part, de laisser une porte aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs à qui les belles voix croisées de José María Heredia, José de Jesús Heredia, Fernando Terry et Los Socarrones viendraient inspirer des réflexions plus tardives. À ces derniers, invitation est donc lancée. N'hésitez pas à envoyer vos contributions.
Avis aux lecteurs: vous l'avez compris, il faudra venir régulièrement ici pour voir s'il y a une ou plusieurs nouvelles livraisons ou vous abonner à la page Facebook du CRIIA (@CRIIANanterre) où nous annoncerons chaque mise à jour.
Bonne lecture !
Sandra Gondouin, Caroline Lepage, Renée-Clémentine Lucien
(Nous remercions Diana Gil Herrero et Guilliane Thiébault pour leur aide dans l'étape des relectures)
1.jpg)
SOMMAIRE
Fabrice Parisot (Université de Perpignan Via Domitia-CRESEM), «La novela de mi vida al desnudo. Entrevista con Leonardo Padura Fuentes»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre–CRIIA) et Elena Zayas (Université d'Orléans), «Entretien avec la traductrice de La novela de mi vida en français»
Graciela Villanueva (Université paris Est Créteil / Imager (UR 3958), «Visualizar la estructura de La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura»
Elena Zayas (Université d'Orléans), «Une île, une écriture: deux territoires rêvés de l’œuvre romanesque de Leonardo Padura»
Elena Zayas (Université d'Orléans), «El arte de borrar fronteras: ficción e historia en La Novela de mi vida de Leonardo Padura»
Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre Études Romanes – CRIIA-HLH), «Des enjeux de la première de couverture dans la réception de La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura Fuentes. Analyse comparative des premières de couverture des premières publications en grand format aux éditions Tusquets (Espagne) et Métailié (France)»
Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre Études Romanes – CRIIA-HLH), «1, 2, 3, partez! Des enjeux du triple et du double dans le début pluriel de La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura»
Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre Études Romanes – CRIIA-HLH), «“Il était une fois le conte de ma vie de dictateur” – Des enjeux micro et macro d’une analyse architextuelle de La novela de mi vida (2002)»
Nelly Le Naour (GRIAHAL), «Résonance et dissonance dans les représentations de La Havane dans La novela de mi vida, de Leonardo Padura Fuentes»
Néstor Ponce (Université Rennes 2 Centre d’Etudes des Langues et Littératures Anciennes et Modernes-CELLAM), «Socarronería y sociedad: una forma de leer la realidad cubana en La novela de mi vida y La transparencia del tiempo»
Caroline Lepage et Diana Gil Herrero (Université Paris Nanterre), «De la première à la dernière ligne de la ligne 1: La novela de mi vida de Fernando Terry»
Caroline Lepage, Diana Gil Herrero et Élodie Peeters (Université Paris Nanterre), «Quelques éléments de réflexion autour de la réception de La novela de mi vida (Leonardo Padura) en France»
Ivette Fuentes ((VIVARIUM, CCPFV) La Habana), «José María Heredia: Oda a la naturaleza del alma cubana»
Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «Utopie et hétérotopies dans La novela de mi vida, de Leonardo Padura»
Michèle Guicharnaud-Tollis (Université de Pau et des Pays de l’Adour / Laboratoire ALTER), «L’exil fondateur dans La Novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura»
Raúl Caplán (Université Grenoble-Alpes ILCEA4), «Nadie es profeta en su tiempo: la revolución cubana en La novela de mi vida de Leonardo Padura Fuentes»
Graciela Villanueva Université (Paris Est Créteil / Iimager –UR 3958), «Violencia sin filtro en La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura»
Cécile Marchand (Le Mans Université), «Este oscuro objeto del deseo en La novela de mi vida de Leonardo Padura»
Corinne Mencé-Caster (Sorbonne Université), «La novela de mi vida: un roman écrit en cubain?»
Clara Dauler (Université Des Antilles – Pôle Martinique), «La cubanité littéraire au prisme du roman historique dans La novela de mi vida de Leonardo Padura»
Fabrice Parisot (Université de Perpignan Via Domitia/CRESEM), «Des lettres dans le roman: le jeu de la correspondance épistolaire dans La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura Fuentes»
Paula García Talaván (Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid), «Literatura y memoria de la identidad cultural cubana: La novela de mi vida»
David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre), «La narrativa especular en La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura »
Julia de Ípola (ENS-Ulm – Sorbonne Université), «¿La novela de tu vida? El lector ideal en lasecuencia 42 de La novela de mi vida de LeonardoPadura Fuentes»
Julia de Ípola (ENS-Ulm – Sorbonne Université), «“Porque la cubana es…”: cubanía y personajes femeninos en La novela de mi vida de Leonardo Padura Fuentes»
Julia De Ípola (ENS-Ulm – Sorbonne Université), «José de Jesús, o Padura malgré lui. Rechazo y reflejo en la quinta secuencia narrativa de La novela de mi vida»
Clara Chevalier Cueto (ENS-Ulm – Sorbonne Université), «“Hijos de Cuba” o “hijos de puta”: los lazos paternofiliales en La novela de mi vida de Leonardo Padura Fuentes»
Clara Chevalier Cueto (Sorbonne Université – ENS-ULM), «Un poeta en Miami: la parábola de Eugenio Florit en la secuencia 41 de La novela de mi vida»
Clara Chevalier Cueto (Sorbonne Université – ENS-ULM), «“Un tiempo preciso y un espacio inconmovible”: análisis de la última secuencia narrativa de La novela de mi vida»
Sophie Marty (Université d’Orléans / Sorbonne Université), «Polyphonie et dialogisme dans La novela de mi vida»
Renée Clémentine Lucien (Sorbonne Université), «Les visages du Mexique dans El mar y los destierros de La novela de mi vida, la quête inaboutie de José María Heredia»
Laura Gentilezza (Université Paris-Est Créteil – CREER IMAGER), «Heredia et Padura: au seuil de l’intime»
Cecilia Reyna (Université Paris Nanterre), «“¿es usted muy inocente o muy socarrón?”: la educación de la mirada y la trans/misión académica de la literatura en la sección novena de la segunda parte de La novela de mi vida de Leonardo Padura»
Liliana Riaboff (CRIIA-HLH), «Recordar para corregir: de la deslegitimación a la legitimación histórica en la sección 31 de La novela de mi vida»
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
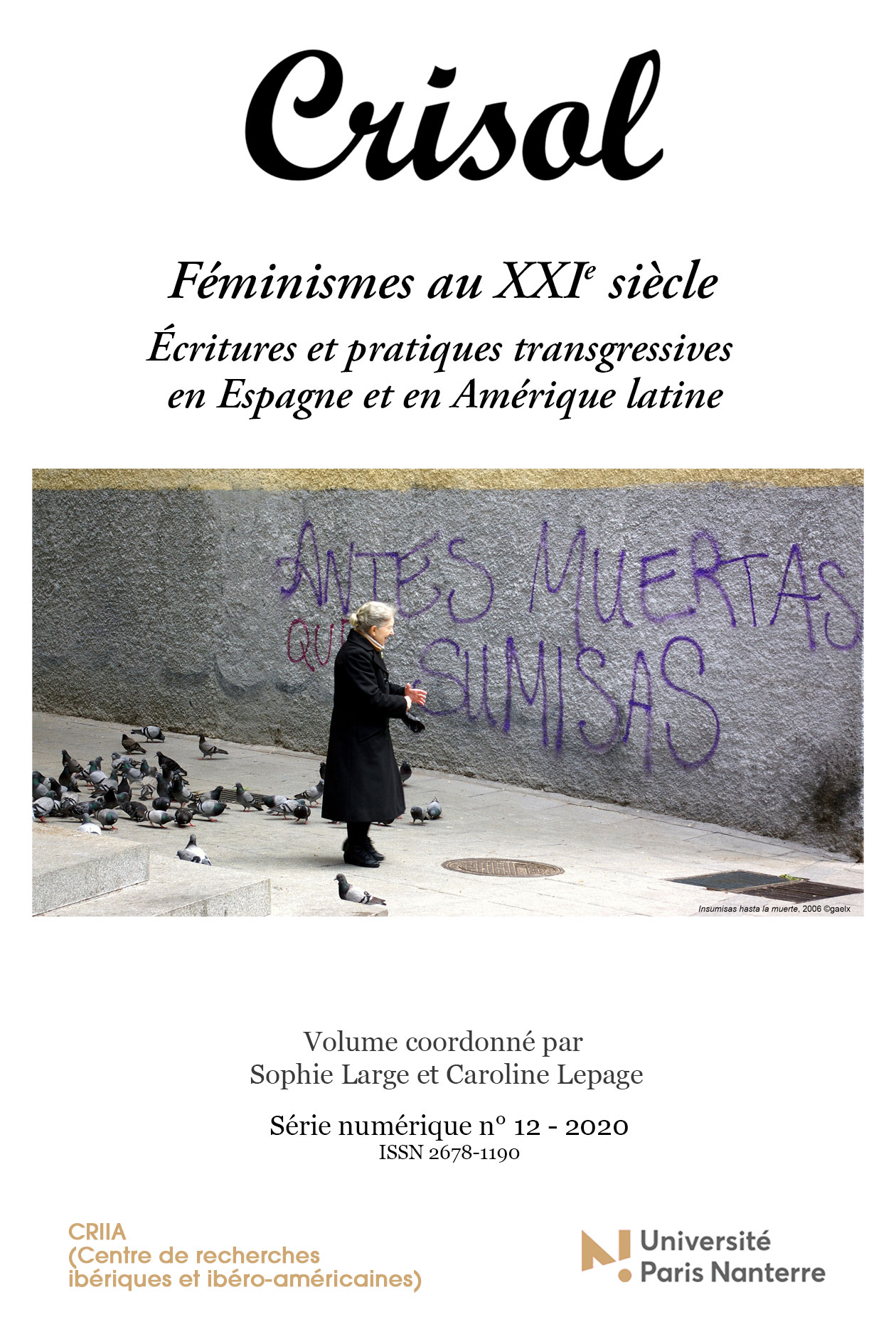 Féminismes au XXIe siècle – Écritures et pratiques transgressives en Espagne et en Amérique Latine
No 12 (2020)
Féminismes au XXIe siècle – Écritures et pratiques transgressives en Espagne et en Amérique Latine
No 12 (2020)Le 8 mars 2020, juste avant l’éclatement de la crise mondiale liée à la Covid-19 et le confinement de deux tiers de l’humanité, les féministes remplissaient à nouveau les rues, en particulier dans les grandes villes latino-américaines et à Madrid. Peut-être, comme l’écrit Paul B. Preciado, étions-nous à ce moment-là à la veille d’une révolution mondiale, d’un «nouveau cycle révolutionnaire transféministe décolonial» (1). Ces dernières années, en effet, nous avons assisté à une puissante réinvention des féminismes, à la concrétisation d’une troisième, voire quatrième vague d’un mouvement de plus en plus hétérogène et complexe, au point qu’il est difficile désormais de le définir, tout comme il est aventureux de saisir les subjectivités qui s’y reconnaissent (2). Le déplacement et la complexification du sujet politique femme, l’appropriation du cyberespace, l’intersectionnalité de genre, race et classe, l’inclusion des subjectivités queer et trans, la réappropriation, voire la réinvention du corps, les nouvelles épistémologies pour dire des sexualités et des identités multiples et non normatives, le renouvellement des formes d’activisme et d’expression politique (en particulier en ce qui concerne la dénonciation de la violence machiste), le croisement avec les luttes anticapitalistes et décoloniales… voici quelques caractéristiques de ce mouvement qui prenait l’espace public juste avant l’éclatement de la crise. Or, comme le met en évidence l’analyse qu'en fait Preciado, si les nouveaux féminismes placent à nouveau les définitions du corps au centre du débat politique, autant que la crise que nous traversons le fait tout autant, transformant le corps en nouveau champ de bataille —ce corps désormais suspect et obligé de se distancer, de s’isoler des autres—, fragmentant les luttes, dynamite les possibilités de révolte. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’extrême droite espagnole a tout de suite accusé les manifestations du 8 mars à Madrid d’être un puissant vecteur de propagation du virus (3). La métaphore du corps comme vecteur de contamination, du corps dangereux, sale, que les communautés homosexuelles ont bien connu en particulier pendant les années de la crise du VIH, réémerge avec force et se lit désormais à une échelle généralisée et planétaire.
Dans ce contexte, ce dossier se présente comme un instantané des épistémologies, pratiques et langages féministes à un moment très précis de l’histoire du mouvement. Un moment d’une inventivité extraordinaire, que ce soit au niveau des langages, des pratiques, des questionnements ou de son articulation avec le politique. En particulier, les différents articles insistent d’une façon ou d’une autre sur la puissance transgressive de ces féminismes qui font éclater les normativités qui définissent les corps et les subjectivités, en particulier le binarisme de sexe et de genre, transgression qui prend ici un sens profondément politique puisqu’elle constitue à la fois un outil de dénonciation des oppressions et de dépassement de celles-ci.
L’artivisme, qui combine pratique artistique et militantisme, se développe avec force dans les milieux féministes latinoaméricains (4) et constitue un outil particulièrement riche et original, en particulier pour les collectifs LGTBQ+ : il permet de repenser les corps et les sexualités tout en constituant à la fois un moyen d’expression des nouvelles épistémologies, de dénonciation et de déconstruction des normativités binaires. Comme le décrit l’article d’Alexia Grolleau, l’hétérosexualité normative est ainsi mise en évidence et moquée dans la performance Post-porno infinito filmée par la réalisatrice chilienne Katia Sepúlveda. L’artiste se livre ici à un détournement ironique des codes de la pornographie qui fait éclater non seulement le binarisme hétérosexuel, mais aussi l’énonciation des lieux du plaisir ou la division entre l’humain et la machine. L’artivisme de valeria flores, étudié par Thérèse Courau, prend un sens plus explicitement politique en pointant du doigt les continuités autoritaires entre la dictature et la démocratie en Argentine et au Chili. Son travail sur la visibilisation des formes de vie et des subjectivités non cis-hétéro-patriarcales met en lumière la violence inhérente à la culture hétéropatriarcale véhiculée, en particulier, par l’école, laquelle fonctionne comme un puissant vecteur de violence symbolique (5) qui discipline à la fois les corps, les subjectivités et les désirs en rejetant du côté de l’abjection les identités non normatives. Tout aussi politiques sont les performances post-pornographiques de l’artiste chilienne Maria Basura analysées par Eléonore Parchliniak: sa performance Fuck the fascism rend explicite un système de domination multiple (capitalisme, colonialisme, fascisme) à travers le “viol” des statues de colonisateurs et dictateurs. De cette façon, la performance inverse la logique du viol de guerre et met à nu la violence et l’horreur de l’histoire qui sous-tend les sociétés post-coloniales et néolibérales dans lesquelles nous vivons.
Si ces articles explorent les potentialités de dénonciation et d’inventivité du Post-porno relu à la lumière de l’artivisme, Emmanuelle Sinardet revient plutôt aux racines de cet artivisme à travers l’analyse d’une des œuvres les plus polémiques du collectif de femmes boliviennes Mujeres creando, pionnières de cette forme d’expression à la fois artistique et politique. L’analyse de l’œuvre Milagroso altar blasfemo, ainsi que des polémiques qui ont accompagné son exhibition à Quito en 2017, explore les potentialités épistémologiques de cet artivisme féministe en le resituant dans une histoire longue de lutte contre la domination coloniale. Le choix de la forme du retablo, le détournement des codes et des langages de la religion catholique, le déplacement du masculin (le Christ) par une vierge aux allures de déesse païenne, font de cette œuvre un lieu complexe où se combinent dénonciation des différentes institutions (l’Eglise catholique et le système colonial marchant ici main dans la main) qui ont historiquement opprimé les femmes, en particulier indigènes, et revendication féministe. Les polémiques suscitées par l’œuvre mettent aussi en évidence la dispute entre des langages et des visions du monde radicalement incompatibles: la transgression féministe apparaît ainsi comme un puissant révélateur des antagonismes qui articulent le champ symbolique et politique dans la société équatorienne.
Les féminismes de cette «quatrième vague» font ainsi de la transgression et du détournement une arme politique et utilisent aussi le «retournement du stigmate», qui donna lieu entre autres à la dénomination même de queer. Le sujet qui se construit à travers ces luttes, comme le signale Marie-Agnès Palaisi en suivant Hannah Arendt dans son analyse du sujet juif, est un «paria conscient», qui fait du ghetto où l’on tente de l’enfermer un espace d’empowerment. Dans la lecture que fait l’auteure de Minificción para niñas LGBTI de Sayak Valencia, le cyberespace fonctionne ainsi comme un espace imaginaire de liberté, une hétérotopie où récupérer une enfance et une identité volées, où ces sujets qui ont été construits comme «inappropriés», mais se revendiquant comme «inappropiables» par la norme hétérosexuelle peuvent réécrire leur propre «herstory». C’est encore la transgression qui est au cœur de la pratique et des langages féministes du collectif madrilène des Scum Girls étudié par Karine Bergès; des féministes très jeunes, pour lesquelles le cyberespace fonctionne à la fois comme une école de féminisme et comme un lieu d’expression et d’énonciation. Or, l’auteure s'interroge sur le sens et la portée politique de la transgression portée par ces jeunes femmes, qui se révèle parfois superficielle : elle consiste surtout en la spectacularisation des corps et en la production de slogans et performances qui peinent à aller au-delà de la provocation, ce qui pourrait être expliqué par le profil sociologique des jeunes militantes. On trouve ces mêmes questionnements dans l’article de Caroline Lepage sur la célèbre personnage de BD espagnole Lola Vendetta. Si le personnage créé par Raquel Riba Rossy (et qu’on peut interpréter comme étant en fait son alter ego) a contribué à populariser le féminisme en Espagne, et a provoqué également les réactions misogynes et machistes de ses détracteurs, il s’agit finalement, sous ses apparences transgressives, d’un féminisme mainstream et édulcoré, qui ne met en question ni l’hétéronormativité obligatoire, ni le système capitaliste, ni même, finalement, une sentimentalité traditionnelle fallocentrée, comme le montre l’auteure dans une analyse très complète qui prend en compte non seulement l’analyse narrative et iconographique de la BD, mais aussi ses conditions de production, sa réception et sa mise en scène médiatique.
On est loin ici, finalement, des risques pris par les performeuses et artivistes qui réinventent un nouveau langage et de nouvelles corporalités et sexualités, provoquant à la fois fascination et rejet, questionnant en profondeur un système qui broie la différence, mettant à nu les différentes oppressions et dominations dans lesquelles nous sommes toutes et tous imbriqués. Finalement, à travers ce dossier on peut relire à nouveaux frais les questions déjà posées par les féministes des années 1970: le privé (le désir, les sexualités) est politique et nos corps sont, aujourd’hui plus que jamais, un champ de bataille.
Mercedes Yusta, Université Paris 8
1. Paul B. Preciado, «Nous étions sur le point de faire la révolution féministe… et puis le virus est arrivé», Bulb, n°2, 27 avril 2020, https://bulb.liberation.fr/edition/numero-2/nous-etions-sur-le-point-de-faire-la-revolution-feministe/, consulté le 22 mai 2020.
2. Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos, Tafalla, Txalaparta, 2013; Nuria Varela, Feminismo 4.0. La cuarta ola, Penguin Random House, 2019.
3. Montserrat Galcerán, « El 8 de marzo como chivo expiatorio », El Salto diario, 3 de abril de 2020, https://www.elsaltodiario.com/opinion/montserrat-galceran-8-de-marzo-como-chivo-expiatorio, consulté le 22 mai 2020.
4. Julia Antivilo, Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías. Arte Feminista nuestroamericano. Bogotá, desde abajo, 2015.
5. Dans un sens bourdieusien : Pierre Bourdieu et J.-C.Passeron, La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris, Minuit, 1970.
Postscriptum des coordinatrices: après la mise en ligne de ce volume, le hasard des rencontres nous a fait solliciter un travail sur le reggaeton et le féminisme à Anne Monssus. Ce qui explique qu'il ne soit pas évoqué par Mercedes Yusta dans son texte de présentation.
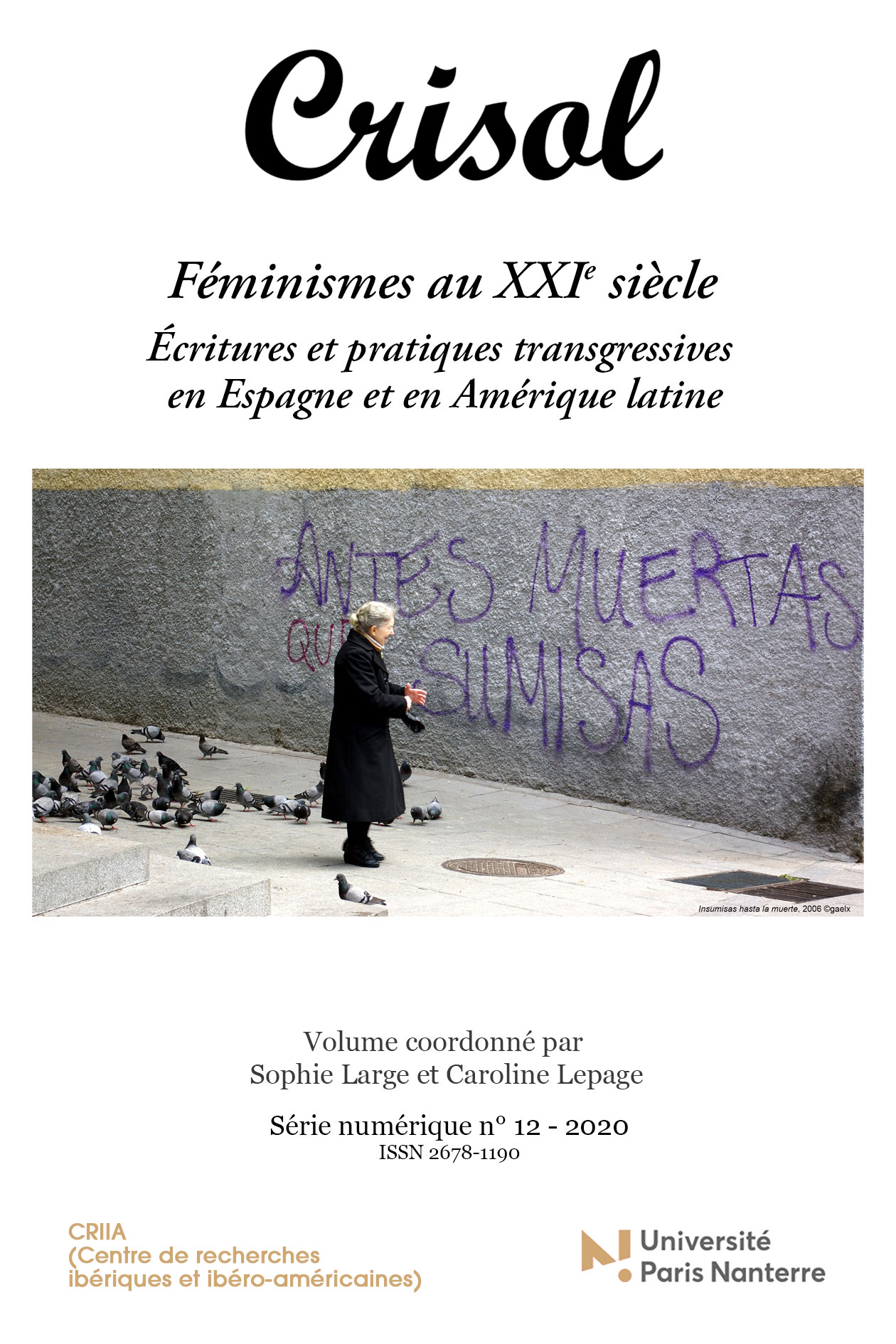
SOMMAIRE
Éléonore Parchilniak (Université Paris Nanterre), «La post-pornographie comme instrument politique»
Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre), «Post Porno infinito : un zèbre travesti, un aspirateur, un gode ceinture et du lubrifiant, une performance contre-sexuelle»
Karine Bergès (Université Paris-Est Créteil), «“Somos malas, podemos ser peores”. Transgresión y rebeldía del colectivo madrileño Scum Girls»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), «Le féminisme mainstream – ses formes, ses discours et sa réception : le cas de Lola Vendetta»
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre), «1. E. SINARDET, « Féminisme, blasphème et polémique... » Féminisme, blasphème et polémique : L’exposition à Quito (29 juillet-29 octobre 2017) du Milagroso Altar Blasfemo par le collectif bolivien Mujeres Creando»
Thérèse Courau (Université Toulouse Jean Jaurès Centre d’Études Ibérique et Ibéro-américaine –CEIIBA), «Questionner la normalisation sexo-générique : l’activisme artistique de valeria flores»
Marie-Agnès Palaisi (Université Toulouse Jean Jaurès Centre d’Études Ibérique et Ibéro-américaine –CEIIBA) «El ciberespacio : contraespacio queer frente a la « amenaza del ghetto ». Intento de lectura transfeminista de Hannah Arendt»
Anne Monssus (Université Paris Nanterre), «Le reggaeton: d’un genre musical et chorégraphique machiste à une tribune féministe»
Sophia Sablé (CEIIBA, Université Toulouse Jean-Jaurès), «Archivo rosa: archive en ligne de la lutte pour l’avortement en Argentine et processus de subjectivisation»
***
Compte-rendu de lecture
Compte rendu de lecture (Marc Zuili): Francisco Gimeno Menéndez, Historia antropológica de los romances hispanos
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
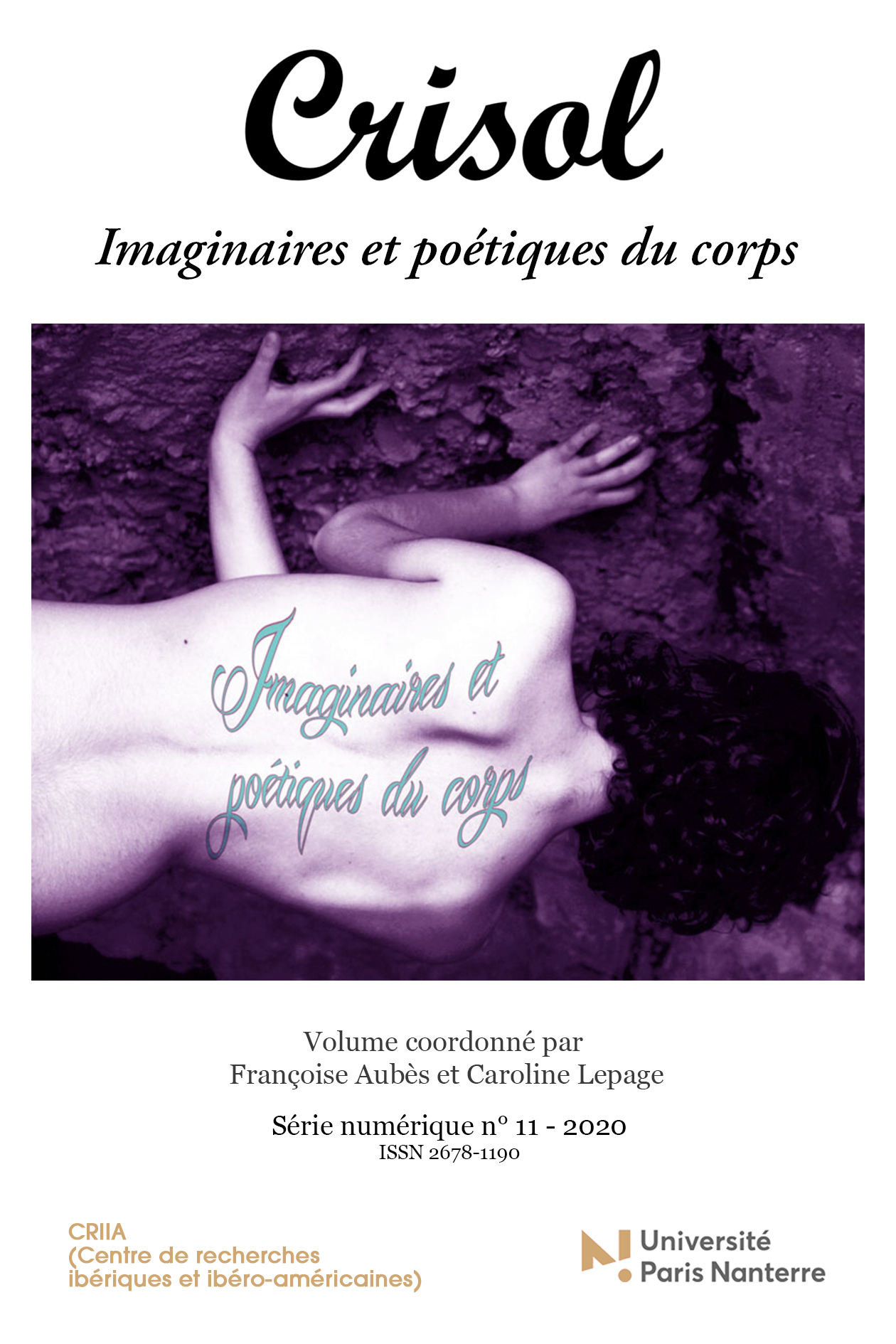 Imaginaires et poétiques du corps
No 11 (2020)
Imaginaires et poétiques du corps
No 11 (2020)Imaginaires et poétiques du corps, 11e livraison de CRISOL, réunit les contributions des chercheurs nanterrois membres du GRELPP, ainsi que celles d’autres universitaires français et étrangers. Ces contributions proposent, dans des registres divers –littérature, mais également arts plastiques, arts visuels– une lecture plurielle d’un sujet aussi ambitieux, par son amplitude sémantique et son histoire, que le corps. Rappelons simplement que cette question philosophique essentielle renvoie au débat infini sur le binôme corps/esprit, lequel avance dans l’histoire de la pensée occidentale comme un vieux couple mal accordé –«d’un côté j’ai une claire et distincte idée de moi-même, en tant que je suis seulement une chose qui pense et non étendue, et que d’un autre j’ai une idée distincte du corps, en tant qu’il est seulement une chose étendue et qui ne pense point», selon Descartes dans la sixième méditation–, jusqu’à ce que la phénoménologie apaise ces tiraillements épistémologiques en réconciliant les deux partis: le corps est cet être-au-monde qui nous définit.
Les travaux rassemblés dans ce numéro interrogent ainsi dans la variété de leurs supports et la diversité des aires culturelles et géographiques du monde hispanophone, un imaginaire et des représentations où s’entrecroisent, se répètent, réapparaissent, thèmes et motifs comme de grands invariants. Mais, par la fantaisie et l’imagination, la littérature et l’art permettent toutes les transgressions et les approches les plus déraisonnables pour mieux cerner ce sujet/objet, ce qui nous fonde et qui tient et contient notre identité, comme on le lira dans les communications de la première section: Aux confins de l’identité ou les limites du corps.
Dans la nouvelle de Gabriel García Márquez «La tercera resignación», étudiée par Andra Barbu, le narrateur post-mortem réussit l’irréalisable, soit être mort et se regarder mort, raconter la mort du dedans. Abjects, sales, souillés d’excréments, d’urine, misérables rejetés, quelle humanité pour ces corps qui pénètrent dans «les territoires de l’animal», pour reprendre la formule de Julia Kristeva? Voilà ce sur quoi s’interroge Davy Desmas à travers la lecture de Temporada de huracanes (2017), de l’écrivaine mexicaine Fernanda Melchor. El desierto y su semilla (1998), de l’Argentin Jorge Barón Biza, un récit autofictionnel qui relate la défiguration au vitriol de la mère de l’auteur, fait l’objet de deux communications. Pour Benoît Coquil, dans cette «Biografía carnal», ce «texto rostro», seule la disharmonie du grotesque peut dire le visage vitriolé et vainement reconstruit de la mère, tandis que Marián Semilla Durán estime, dans une approche psychanalytique, que la défiguration rend impossible pour le fils toute identification avec la mère. Le corps au-delà des limites de ce qui est présentable est celui que met en et sur scène l’artiste catalane Angélica Liddell, libérant dans une esthétique de l’obscène toute sa violente immanence pour Laurent Gallardo. Dans le registre de la littérature personnelle, Françoise Aubès met en parallèle deux récits: celui de l’écrivain péruvien Julio Ramón Ribeyro, qui décrit avec détestation et fascination son corps malade et pitoyable dans son journal, et celui d’Asunta, Indienne quechuaphone, qui évoque avec pudeur et résignation, l’héritage d’une culture chrétienne étayée par le péché et la punition, les souffrances physiques inhérentes, selon elle, à sa condition biologique et culturelle; sujet développé dans la deuxième section : Stigmates et reconstruction: le corps au féminin.
Sang, impureté et souillure apparaissent comme les marqueurs identitaires de personnages féminins, par exemple celui de Tamara, héroïne de Escenario de guerra (2000), de l’auteure chilienne Andrea Jeftanovic; roman-théâtre semblable au théâtre de la cruauté analysé par Éléonore Parchliniak. Les violences imposées aux corps des femmes, legs d’un patriarcat ancestral, sous-tendent les poésies de María Castrejón, selon Claire Laguian; mais la poétesse retourne cette violence: l’écriture se change en rébellion et catharsis. Dans la Caraïbe, Nancy Morejón s’emploie à déconstruire, dans ses poésies, l’image de la femme noire réduite à sa sensualité, stéréotype issu de la colonialité; le corps devient mémoire de l’esclavage, écrit Sandra Hernández. La réappropriation de ces corps féminins à l’identité préformatée passe aussi par la découverte du désir: comme dans l’irrévérencieux Devocionario, dans l’esprit de la movida espagnole des années quatre-vingt de Anna Rosetti: la masculinité du Christ en croix suscite chez une petite communiante de huit ans les premiers émois, comme l’analyse Nuria Rodríguez Lázaro.
La troisième section Habeas corpus: mémoire des disparus et pensée décoloniale montre comment la gestuelle corporelle, ainsi que les performances à visée politique tentent de redonner corps aux disparus des dictatures argentine et chilienne dans la communication de Paula Klein, aux victimes du Conflit Armé colombien dans celle de Luis Carlos Toro Tamayo; la performance –comme l’innovante performance visuelle REM (Romantic Eyes Movement) de l’Équatorien Santiago Reyes– peut être aussi, comme le démontre Ezequiel González, un geste décolonial dans l’esprit de la Futurité latinx.
Dans le corps des textes, quatrième section, aborde la dimension narratologique et textuelle du corps en littérature. Le corps est en premier lieu le dispositif essentiel dans la construction du personnage comme l’analysent de nombreuses communications : celle de Caroline Lepage décrypte le personnage de Mario Conde, enquêteur au corps chétif et bien peu glorieux, à l’instar de la Cuba à bout de souffle du «periodo especial» dans les romans policiers de Leonardo Padura. Peau semblable à l’écorce des arbres, peau écorchée d’où coule le sang semblable au latex des hévéas amazoniens, tel est le corps du cauchero Clemente Silva construit dans La Vorágine (1924) du Colombien José Eustasio Rivera analysé par David Barreiro. Dans la même lignée, le corps souffrant, christique de Roger Casement, dans El sueño del Celta (2010), de Mario Vargas Llosa est, selon Sabrina Wajntraub, une mise en abime de la colonialité qui martyrise et sacrifie le corps des indigènes travaillant pour le compte de la Peruvian Amazon Company.
Dans le fonctionnement du texte, la notion d’ethos permet de débusquer la corporéité du narrateur/auteur, car tout discours possède une voix et la voix qu’analyse Gersende Camenen dans la violence des mots est celle du Colombien Fernando Vallejo, auteur de La virgen de los sicarios (1994). Laura Gentilezza s’intéresse au geste littéraire, celui de la main qui dessine, écrit, agence des photos à l’intérieur de romans du Cône Sud, les convertissant en textes hybrides. Si l’image du corps de façon métonymique suggère dans de nombreuses communications celle d’un pays, d’une Nation, bien souvent en décomposition, elle renvoie aussi au texte en lui-même, lequel déploie ses disjecta membra comme un grand organisme vivant. Corps textuel multiforme pour Olga Lobos, le roman de Julio Cortázar Rayuela (1963) en est le paradigme, tandis que dans les romans de Josefina Vicens –El libro vacío (1958) et Los años falsos (1982) analysés par María Luna Chávez et Víctor Díaz Arciniega–, corps et écriture sont pour les deux personnages principaux les marqueurs de leur solitude et leur masculinité mexicaines.
Enfin, ces diverses approches du corps et de ses représentations seraient incomplètes sans Le regard du peintre, titre et objet d’étude de la cinquième et dernière section de ce numéro. Depuis des siècles, la peinture a imposé à notre œil les images de la beauté classique des académies humaines. Or, dans les deux communications consacrées à ce médium, le peintre rompt intentionnellement avec les codes esthétiques de son époque: c’est le cas de Leonardo Alenza y Nieto montrant le ridicule du corps décharné du suicidé romantique dans Los Románticos (1839), comme l’explique Sylvie Turc-Zinopoulos; et c’est l’option de Goya qui, rompant avec l’esthétique du sublime de ces premiers tableaux, choisit le grotesque le plus noir pour imposer les corps monstrueux des Désastres de la guerre dans la communication de Marc Marti.
Puisse la lecture de ces communications permettre d’entrevoir un peu de la vertigineuse spécularité d’un sujet d’étude comme le corps. Mais retenons aussi l’aimable définition qu’en fait Michel Foucault: le corps «ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j’avance, j’imagine, je perçois les choses en leur place».
Françoise Aubès
.jpg)
SOMMAIRE
Aux confins de l'identité ou les limites du corps
Andra Barbu (Université Rouen Normandie), «La voix cachée de nos cadavres. “La Tercera Resignación” de Gabriel García Márquez»
Davy Desmas (Université Toulouse Jean Jaurès), «Aux frontières du corps propre. De l’abjection comme stratégie de domination dans Temporada de huracanes (2017), de Fernanda Melchor»
Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «Desfiguración y configuración del grotesco en El desierto y su semilla de Jorge Baron Biza»
María A. Semilla Durán (Université Lumière Lyon 2), «Rostro y metáfora El desierto y su semilla, de Jorge Barón Biza. Destrucción y reconstrucción de identidades»
Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes), «Le théâtre d’Angélica Liddell: l’obscène et son double (Considérations à propos de Que ferai-je, moi, de cette épée ?)»
Françoise Aubès (Université Paris Nanterre), «Écriture personnelle et image de soi: Asunta et Julio Ramón Ribeyro»
Stigmates et reconstruction: le corps au féminin
Eléonore Parchliniak (Université Paris Nanterre), «Escenario de guerra: un autre “théâtre de la cruauté”»
Claire Laguian (Université Gustave Eiffel), «Violences faites aux corps chez María Castrejón: la poésie comme possible survie»
Sandra Monet-Descombey Hernández (Université de Lyon 2), «De la réécriture du corps féminin comme espace mémoriel, à la permanence du poétique»
Nuria Rodríguez Lázaro (Université Bordeaux Montaigne), «Devocionario (1985) de Ana Rossetti o la erotización del cuerpo de Cristo»
Habeas corpus: mémoire des disparus et pensée décoloniale
Paula Klein (ENS), «Le corps comme archive: activismes artistiques dans le Cône Sud»
Luis Carlos Toro Tamayo (Universidad de Antioquia), «Archivo, memoria y cuerpo, El rostro de las víctimas en la construcción de las memorias»
Ezequiel N. González (Université de Columbia), «À travers nos yeux: Santiago Reyes, la futurité Latinx et la performance contre-visuelle»
Dans le corps des textes
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), «Traitement discursif du corps: portrait de Mario Conde en superhéros et Christ cubain»
David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre), «La trame arborescente et le corps dans La vorágine: une lecture christique du personnage Clemente Silva»
Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre), «L’écriture du corps de Roger Casement dans la deuxième partie de El sueño del celta (2010) de Mario Vargas Llosa: modalités et enjeux»
Gersende Camenen (Université Gustave Eiffel), «La palabra furiosa: violencia y melancolía en La Virgen de los Sicarios»
Laura Gentilezza (Université Paris-Est Créteil), «El gesto literario: ideas sobre el cuerpo a partir de algunos autores contemporáneos del Cono Sur. Costamagna, Ronsino, Delgado, Celedón»
Olga Lobo (Université Grenoble-Alpes), «Un libro, dos libros, muchos libros. Rayuela, una historia de cuerpos mutantes»
Marisol Luna Chávez (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) et Víctor Díaz Arciniega (Universidad Autónoma Metropolitana), «Cuerpo textual e identidad simulada en El libro vacío y Los años falsos de Josefina Vicens»
Le regard du peintre
Sylvie Turc-Zinopoulos (Université Paris Nanterre), «Romantisme, folie et corps dans Los románticos (1839) de Leonardo Alenza y Nieto Peinture de genre et littérature de mœurs»
Marc Marti (Université Côte d’Azur), «Goya et le corps: du sublime à l’horreur»
***
Comptes-rendus de lecture
Compte-rendu de lecture (Emmanuelle Sinardet): Élodie Vaudry, Les arts précolombiens. Transferts et métamorphoses de l’Amérique latine à la France, 1875-1945
Compte-rendu de lecture (Marc Zuili): Françoise Richer-Rossi, Alfonso de Ulloa, historiographe. Discours politiques et traductions
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
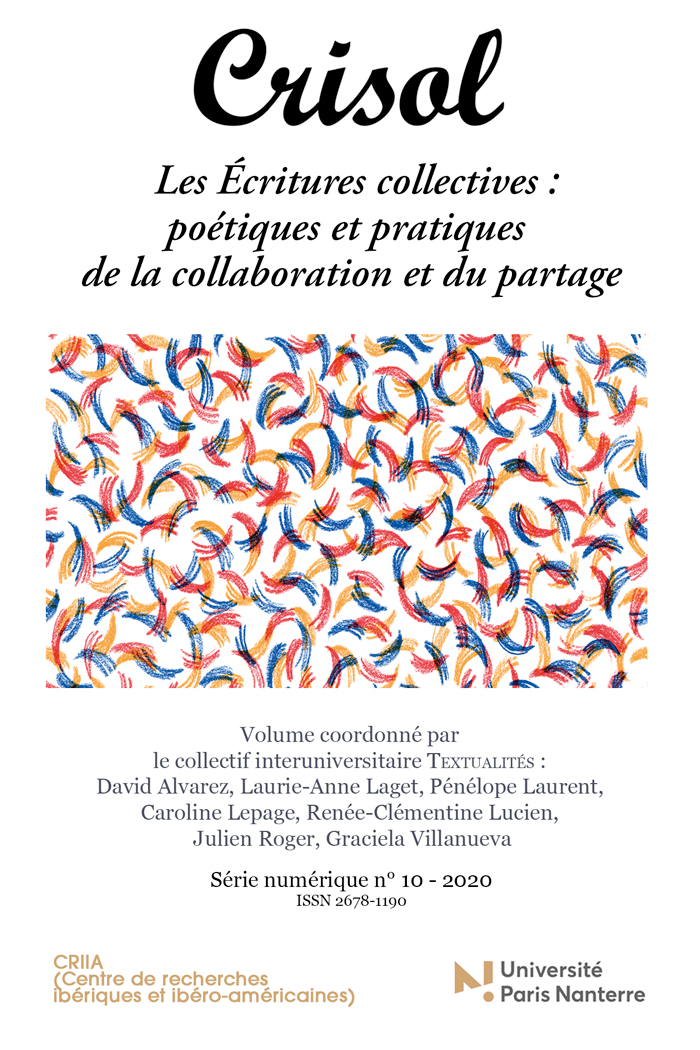 Les écritures collectives: poétiques et pratiques de la collaboration et du partage
No 10 (2020)
Les écritures collectives: poétiques et pratiques de la collaboration et du partage
No 10 (2020)Dans son compte rendu du livre « Nous est un autre. Enquête sur les duos d’écrivains » (Michel Lafon et Benoît Peeters, 2006), Jan Baetens analysait le « dévoilement » des processus et des implications de l’écriture à quatre mains qui était opéré dans l’ouvrage. Soulignant que les analyses proposées ouvraient des perspectives inédites et donnaient envie de les prolonger, soit en multipliant les exemples, soit en élargissant leur portée même, il précisait : « l’écriture en collaboration émerge petit à petit dans ce livre comme un véritable continent caché » (Critique, 2006). De fait, l’expression elle-même s’entend implicitement comme une pratique relativement inhabituelle et qui s’oppose au « modèle » communément admis de l’écrivain, seul responsable de la rédaction de son œuvre : l’écriture en collaboration a longtemps constitué un impensé de la poétique. Le présent numéro de Crisol se propose de poursuivre l’approfondissement de cette notion, entendue comme tout type d’écriture résultant d’une collaboration/d’une participation – concertée ou non, revendiquée ou issue de circonstances particulières – entre plusieurs figures d’auctorialité. À travers une quinzaine de contributions consacrées aux mondes hispaniques, ce sont les différentes facettes des productions culturelles « savantes » ou « populaires », « traditionnelles » ou « industrielles » qui sont interrogées au prisme d’un « travailler ensemble » (au sens étymologique du mot collaboration), envisagé de manière diachronique dans les périodes moderne et contemporaine. La mise en relief des évolutions de ces « écritures collectives » qui s’inscrivent dans une histoire longue, qui se poursuit aujourd’hui – par exemple avec la prolifération des séries (sans que le phénomène de la série soit pour autant une nouveauté) ou la production d’œuvres « transmédiatiques » qui ont pour conséquence de dissoudre la figure du créateur au bénéfice d’une pluralité d’acteurs – montre l’intérêt d’une telle réflexion. L’ensemble des contributions interroge donc la notion d’auteur (autorité, auctorialité, auteurité sont, pour le français, autant de termes qui se proposent d’affiner le questionnement), la réévaluation de l’instance d’écriture incitant aussi à considérer l’œuvre non comme immuable mais plutôt comme une continuation ou une suite, travaillée par des processus de recomposition, le tout nourrissant la vision d’un « plurivers » culturel, riche, complexe et très dynamique.
Les formes, les mécanismes et les enjeux des écritures collectives en littérature sont abordés sous plusieurs angles. Se situant dans le sillage des travaux de Lafon et Peeters, une première approche est celle de l’analyse de romans écrits par des duos d’écrivains (comme Silvina Ocampo et Bioy Casarès ou Julio Cortázar et Carol Dunlop). Démonstration est faite que si la dimension ludique est une composante indiscutable de la collaboration (celle du lecteur incluse) dans la production contemporaine, cette dernière ne s’y limite pas. L’incidence est aussi notable sur la poétique elle-même du récit, qui peut donner lieu à une « collaboration au carré ». Mais, surtout, la collaboration révèle l’écrivain à lui-même.
Une autre perspective est celle de l’anthologie – originelle « collection de fleurs choisies » – étudiée comme production d’une écriture collective. Les anthologies mexicaines (de Lauro Zavala) présentées dans un des articles sont constituées de micro-récits fictionnels. Le lecteur est donc soumis à la pré-lecture de l’anthologiste-cueilleur qui sélectionne ses feuilles et ne se contente pas de les compiler. Assemblés, ces micro-textes posent la question de l’un et du multiple, de la continuité et de la discontinuité et de l’intertextualité. Mais les anthologies peuvent aussi être le fruit d’une écriture collective à tous les sens du terme lorsqu’elles émanent de collectifs, en l’occurrence d’écrivaines, (revendiqués comme tels) et qu’elles réunissent la production de femmes de toute condition et aux profils très divers. Tel est le cas des anthologies ¡Basta! Mujeres contra la violencia de género, issues d’un projet interaméricain d’écritures collectives. Enfin, une troisième déclinaison de la forme anthologique a trait à une part immatérielle de la culture, à savoir les créations littéraires orales cubaines, dont la collecte a été réalisée entre 1984 et 1990. L’intra et l’intertextualité qui nourrissent les variations qui apparaissent dans ces productions sont autant d’éléments partagés de l’héritage littéraire de l’île. Il convient d’y ajouter la collaboration entre le narrateur et le transcripteur qui opère une « traduction » de la forme orale à l'écrit, complétée par un appareil de notes associé à une origine géographique. Avec des objectifs différents (jeu intertextuel, transtextuel, mouvements féministes, patrimonialisation des objets culturels), ces anthologies induisent un nouveau regard et de nouvelles lectures sur les objets fractals par excellence qui en résultent.
La « pratique seconde » qu’est la traduction peut aussi relever d’une écriture en collaboration à travers les liens, parfois complexes, qui se nouent entre écrivain et traducteur. C’est ce que montre l’analyse de la relation entre l’auteur argentin, Manuel Puig, et Albert Bensoussan lors de la traduction en français du roman El beso de la mujer araña (1977-1979). Au-delà de l’évocation des conditions matérielles et de la méthode de travail, l’étude des mécanismes de « l’écriture traductive » de Bensoussan met en relief la dimension affective des échanges et les projections imaginaires et symboliques qui alimentent le travail commun, dans une opération de « transmutation des voix ».
L’un des intérêts de cette livraison de Crisol tient aussi, nous l’avons indiqué plus haut, à la prise en compte de la dimension diachronique dans l’essai de définition et les évolutions des acteurs /auteurs de ces écritures en collaboration, qui se sont aussi déployées dans le nouvel espace de diffusion de l’information écrite qu’a constitué la presse à partir du XVIIIe siècle.
L’étude d’un cas précoce dans la presse culturelle espagnole (Variedades de ciencias, literatura y artes) permet de mettre au jour le fonctionnement et la pratique d’une écriture collective dans ce périodique. Dans les premières années du XIXe siècle, de manière inédite, une modalité de travail collectif a été envisagée, avec la constitution d’une sorte d’équipe de rédaction avant la lettre, avec des domaines de spécialité divers alors qu’à l’époque, le journal était généralement assumé par un seul nom quand celui-ci était mentionné (les contenus fussent-ils écrits par d’autres). Un siècle plus tard, dans les années 1920, un grand quotidien madrilène, Heraldo de Madrid, lançait, lui un projet d’écriture collective sous le nom la « Novela sin final ». L’initiative, réussie, visait, cette fois, à impliquer le lecteur dans la vie littéraire du moment : il était incité à devenir auteur. L’article éclaire un aspect des liens qui se sont tissés entre presse et littérature et analyse l’ambition du journal de créer, sur le fond de censure imposé par la dictature de Primo de Rivera, un espace de création littéraire à destination du plus grand nombre en même temps que d’expression et d’interaction sociale.
L’étude de la notion d’écriture collective considérée au prisme de la production littéraire castillane du Moyen Âge et du Siècle d’Or se révèle tout aussi stimulante.
Pour la période médiévale, l’analyse de l’évolution de l’écriture fait apparaître que seule l’émergence de l’auteur comme figure individualisée permet d’envisager l’écriture collective comme une pratique spécifique, dans laquelle l’œuvre n’est pas immuable mais dépend d’une part d’une succession de figures auctoriales (scriptor, compilator, commentator, autor) et d’autre part d’un complexe processus de composition. L’un des premiers exemples, dans la catégorie poétique, fut celui des « preguntas y respuestas », qui connut un grand succès parmi les poètes de cour du règne de Jean II.
À partir d’une analyse de texte, le réexamen du projet littéraire de Nicolás Núñez (1496), continuateur de la Cárcel de amor de Diego de San Pedro (1492), suite possiblement élaborée à partir du Tractado de amores de Arnalte y Lucenda (1491) du même San Pedro s’intéresse à une œuvre à quatre mains dont le succès est attesté par les vingt-huit rééditions entre 1496 et la fin du XVIe siècle. La notion de « fidélité »/« infidélité », termes en usage pour qualifier la relation littéraire d’un continuateur à l’auteur premier dont le texte est repris, est aussi développée. Cette continuation précédait de quelques années l’œuvre qui fait coïncider de façon emblématique, au XVIe siècle, composition littéraire et continuation : La Célestine, dont le personnage principal a lui-même été l’objet d’un processus de typification de la part de six continuateurs de l’œuvre modèle (1534-1570). Outre l’analyse dudit processus, les éléments qui font passer un personnage de la catégorie de personnage à celle de type sont aussi considérés.
Contrairement aux idées (ou aux images visuelles) reçues qui associent création et solitude ou création et écrit, la réalité de la production poétique et de la vie intellectuelle à la Renaissance est aussi collective et orale, comme en témoignent les cancioneros. L’analyse de la forme glosa permet, en particulier, de mettre en relief l’art de l’improvisation qui se développe alors, authentique fabrique collective de poésie non seulement parce qu’elle s’appuie sur les œuvres préexistantes mais aussi parce qu’elle est produite par un groupe. De ce point de vue, l’image des abeilles, que l’on doit à la plume de Montaigne, dit mieux que toute autre cette dimension collective.
Revisitant la relation – souvent analysée comme conflictuelle – de Cervantès avec Avellaneda qui, en 1614, avait donné une suite à la première partie du Don Quichotte, une autre étude examine si la notion d’écriture en collaboration peut être opératoire pour rendre compte de la relation entre ces deux auteurs. Passant en revue quatre modalités possibles de cette collaboration dans la seconde partie de Don Quichotte que publie Cervantès en 1615, l’analyse montre les rapports contradictoires de ce dernier avec son concurrent, entre déni, collaboration effective, pour paradoxale qu’elle soit, et complémentarité dialectique.
Enfin, le cinéma qui repose, par définition, sur le travail d’une équipe (montage, éclairage, sonorisation, production, distribution, etc.) même si dans l’usage le « grand public » ne retient souvent que les noms des acteurs et du réalisateur, donne lieu à l’évocation de deux formes d’écritures collectives dans une production latino-américaine, particulièrement dynamique et impliquée dans les questions d’histoire et de société. Une étude s’intéresse au cinéma documentaire d’une réalisatrice salvadorienne contemporaine, Marcela Zamora Chamorro, et à la thématique de la violence présente dans ses documentaires. Sa production est analysée comme résultant d’un double travail de collaboration : au niveau de la diégèse et au niveau de la réalisation. Ce double apport se fonde sur une solidarité et une confiance entre les personnes sur le plan idéologique, socle indispensable pour que la parole se libère de la parole et que le travail de mémoire se développe. À partir d’un corpus d’une cinquantaine de films (fiction et documentaire) produits dans quatorze pays, une autre étude propose une analyse sémiotique de la représentation de la transidentité dans le cinéma latino-américain. La réflexion s’intéresse, en particulier, à trois idéologèmes constitutifs dans le processus d’individuation du personnage trans dont la « scène de convergence médiatique », cette dernière permettant la mise en relief de l’interaction de la « culture participative » dans ces films.
Catherine Heymann
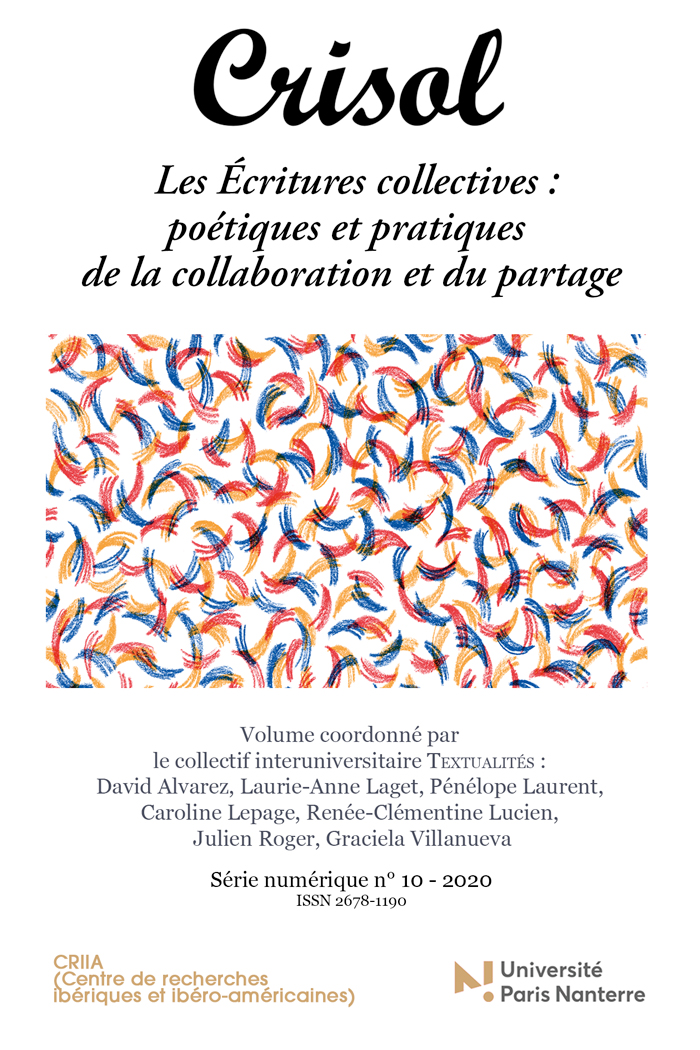
SOMMAIRE
Benoît Peeters (Université de Lancaster), «Des duos d’écrivains à l’écriture collective: quelques pistes»
Écritures en collaboration
Julien Roger (Sorbonne Université – CRIMIC), «Silvina Ocampo+Bioy Casarès= Los que aman, odian 1+1=3»
Victoria Famin (Université Lumière Lyon 2), «Julio Cortázar y Carol Dunlop, Los autonautas de la cosmopista –La escritura de una complicidad aventurera»
Irma Vélez (Sorbonne Université), «Le cinéma trans comme écriture sociale et médiatique de l’autodétermination»
Écritures collectives
Marie-José Hanaï (Université de rouen normandie, eriac), «De l’un au multiple: l’écriture collective de l’anthologie (Les anthologies mexicaines de micro-récits)»
Renée-Clémentine Lucien (Sorbonne Université - CRMIC), «Créations littéraires populaires à Cuba, écouter, transcrire, traduire»
Maud Le Guellec (Université de Lille - Laboratoire CECILLE / EA 4074), «Les Variedades de ciencias, literatura y artes (1803-1805): du journaliste solitaire à la première équipe de rédaction espagnole?»
Gersende Camenen (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), «Manuel Puig et Albert Bensoussan. Les débuts d'une collaboration»
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) et Elsa Fernández (Université Paris Nanterre), «¡Basta! Mujeres contra la violencia de género, un projet collectif interaméricain d’écritures collectives»
Graciela Villanueva (Université Paris-Est, IMAGER / EA 3958), «El cine documental como escritura en colaboración: el caso de Marcela Zamora Chamorro»
Séverine Grelois (Université Paris-Est, IMAGER / EA 3958), «Des nains et des abeilles: glosa, parodie et lieux communs ou la fabrique collective de la poésie du Siècle d’Or»
Continuations
Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université), «Impliquer le lecteur dans la vie littéraire: le projet d’écriture collective de la «Novela sin final» dans Heraldo de Madrid (1926-1927)»
Pénélope Cartelet, (Université de Lille - Laboratoire CECILLE / EA 4074), «La notion d’écriture collective dans le Moyen Âge castillan: d’un manque de pertinence à la naissance d’une pratique spécifique»
François-Xavier Guerry (Sorbonne université, clea), «Du personnage Celestina au type célestinesque. Stéréotypie et innovations dans un cycle littéraire du Siècle d’or (1499-1570)»
Olivier Biaggini (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (lecemo-crem), «Nicolás Núñez, alter ego de Diego de San Pedro: la Cárcel de amor révisée au prisme d’Arnalte y Lucenda»
David Alvarez Roblin (CEHA – Université de Picardie Jules Verne), «Cervantès, Avellaneda et la suite de Don Quichotte: du règlement de comptes à l’écriture en collaboration»
***
Comptes-rendus de lecture
Compte-rendu de lecture (Emmanuelle Sinardet): Michael Handelsman, Representaciones de lo afroy su recepción en Ecuador. Encuentros ydesencuentros en tensión
Compte-rendu de lecture (Gisèle Prost): Variations sur le secret dans le monde hispanophone, Dardo Scavino et Marc Zuili (dir.)
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
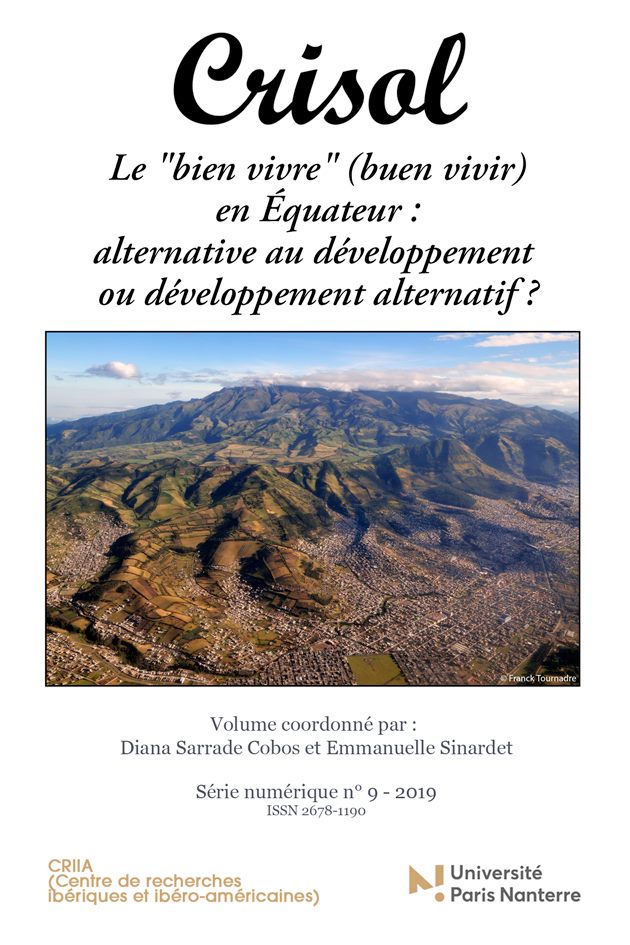 Le "bien vivre“ (Buen vivir) en Équateur : alternative au développement ou développement alternatif ?
No 9 (2019)
Le "bien vivre“ (Buen vivir) en Équateur : alternative au développement ou développement alternatif ?
No 9 (2019)Ce numéro thématique de Crisol rassemble les interventions présentées lors de la journée d’études internationale « Le bien vivre en Équateur : alternative au développement ou développement alternatif ? », organisée le 7 décembre 2018 par le Centre d’études équatoriennes du Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines (CRIIA) de l’Université de Nanterre. Dix ans après la proclamation du bien vivre comme principe recteur par la Constitution équatorienne, il est aujourd’hui opportun d’esquisser un premier bilan des processus de conceptualisation et d’institutionnalisation. L’objectif de cette rencontre était de mettre en évidence la polysémie de la notion du buen vivir et les ambiguïtés qui en résultent, à la lumière de sa déclinaison et de ses tentatives d’application dans les politiques publiques. Au travers des réflexions publiées ici, il apparait que l’Équateur reste aujourd’hui dans une dynamique développementiste, dans laquelle le bien vivre ne constitue pas encore une réelle alternative. Si d’un point de vue théorique, les avancées sont importantes, un long chemin reste encore à parcourir pour la mise en place d’actions étatiques cohérentes.
Diana Sarrade Cobos et Emmanuelle Sinardet
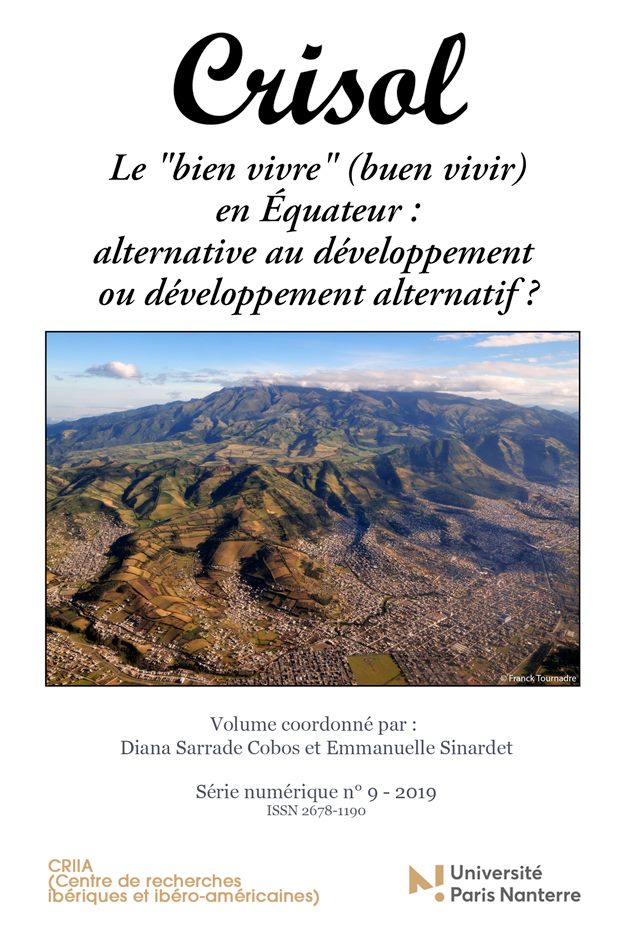
SOMMAIRE
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre), Diana Sarrade Cobos (Université de Bordeaux), Avant-propos
Diana Sarrade Cobos (Université de Bordeaux), Introducción
Salomé Cárdenas Muñoz (CESPRA-EHESS/CNRS), «El “Buen vivir” en Ecuador: etnogénesis, interacciones y transferencias discursivas entre lo glocal y lo nacional»
René Ramírez Gallegos (Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra), «Los "bienes relacionales" en la socioecología política de la vida buena»
Andrés Chiriboga-Tejada (Institut d’Études Politiques de Paris/iep – sciences po), «La gestion de la liquidité dans l’économie du Bien Vivre»
Betty Espinosa (FLACSO Sede Ecuador), «¿Buen vivir en Ecuador? Avances y controversias sociales y ambientales, 2007 a 2017»
Elena Ciccozzi (Chercheuse Associée – CREDA, Sorbonne Nouvelle), «El Buen Vivir a la prueba del Neoextractivismo. Ambigüedades del progresismo ecuatoriano y continuidad con el Neoliberalismo»
Pablo Cardoso (Universidad de las Artes, Guayaquil) et Ana Lucía Torres (Institut de Santé Publique - Pontificia Universidad Católica del Ecuador), «Politiques Publiques du “Buen Vivir” et systèmes traditionnels de connaissance: le cas des sages-femmes et le Système National de Santé en Équateur»
***
Compte-rendu de lecture
Compte-rendu de lecture (Marc Zuili): Suzanne Varga, Le sous-texte mythographique de la poésie lyrique au Siècle d’Or espagnol
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
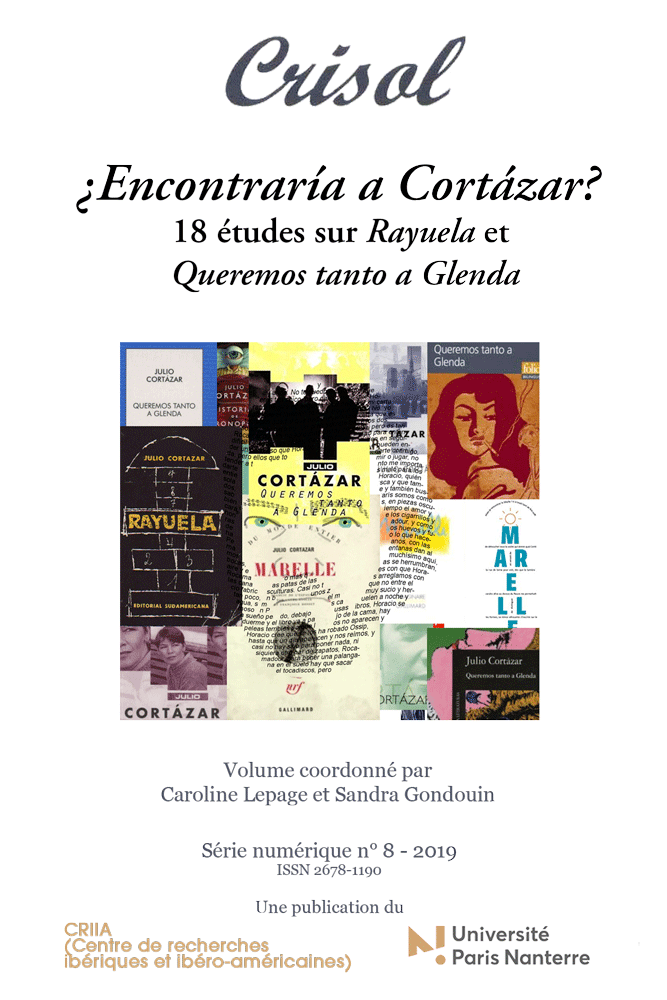 ¿Encontraría a Cortázar? 18 articles sur “Rayuela” et “Queremos tanto a Glenda”
No 8 (2019)
¿Encontraría a Cortázar? 18 articles sur “Rayuela” et “Queremos tanto a Glenda”
No 8 (2019)Les programmes des concours du CAPES et de l’Agrégation sont toujours l’occasion d’immersions profondes dans l’univers d’un auteur pour les étudiants, qui en conservent généralement un souvenir tenace pendant de nombreuses années. Gageons que les personnages arpentant les méandres de Rayuela auront semé dans leur esprit des petits cailloux qui continueront de prendre sens par le biais de réminiscences inattendues, dans d’autres lectures ou, encore mieux, au gré d’une promenade dans les rues de Paris ou de Buenos Aires… Et c’est aussi, pour les enseignants-chercheurs qui les accompagnent, l’occasion de découvrir des textes qu’ils n’avaient pas encore lus, voire qu’ils n’auraient jamais eu l’idée d’ouvrir – absorbés par leurs domaines de spécialités et peut-être trop immobilisés dans leurs zones géographiques de prédilection –, ou alors, dans le cas de ces monuments du patrimoine de la littérature en langue espagnole, de les re-découvrir avec le recul, parfois de plusieurs décennies, et dans un cadre fort exigeant qui leur fait aller au cœur d’une œuvre, parcourir ses architectures et creuser ses plus infimes détails, à travers les exercices universitaires de la dissertation, de l’explication de texte et de la leçon, certes bien moins scolaires et stérilisants pour la lecture et l’interprétation qu’on le prétend. Cet ouvrage, ¿Encontraría a Cortázar? 18 études sur Rayuela et Queremos tanto a Glenda, est donc né, d’une part, de la volonté de proposer aux candidats des pistes utiles pour aborder les fictions cortazariennes telles qu’elles se déploient dans des titres en l’occurrence publiés à presque vingt ans d’écart ; d’autre part, de permettre aux enseignants-chercheurs préparateurs de mener à bien des réflexions, parfois très personnelles, sur leur mémoire de lecteur et sur cette re-lecture particulière. Il va de soi que revenir – encore ! diront sans doute certains – sur des œuvres ayant fait l’objet de tant d’études n’est pas chose aisée, mais les contributeurs-trices de ce numéro 8 de Crisol-série numérique ont relevé le défi en privilégiant des approches dont la diversité rend compte, à elle seule, de l’étendue et de la variété des réactions, idées et thèses que peut générer une écriture aussi foisonnante que celle du fameux Cronope.
Dans une première partie, nous avons souhaité dessiner la figure de l’auteur à travers le regard de ses lecteurs, mais aussi à travers celui qu’il lui-même jeté sur ses écrits. Face au monument que représente Rayuela, cet hymne à la quête de sens et de soi, cette invitation à vivre pleinement le jeu de l’existence, Alain Sicard (Université de Poitiers) et Dina Grijalva (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa) démontrent de façon très personnelle que la lecture de Cortázar peut modifier notre vision du monde comme elle a modifié le paysage littéraire contemporain, dans les Amériques comme en Europe. Ces chercheurs nous font partager leur rencontre avec un ouvrage hors normes et le fruit d’années de vie commune avec lui, comme Victoria Ríos Castaño (Coventry University-RU) lorsqu’elle se penche à travers les déclarations de l’auteur sur la genèse et la réception de Rayuela, ou Miguel Herráez (UCH de Valencia-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación) sur le choc que représenta la réception de l’œuvre dans l’Espagne franquiste des années 60.
Puis, nous avons cherché à travers la seconde partie du volume à mettre en lumière les thèmes, motifs et discours à l’œuvre dans Rayuela comme dans Queremos tanto a Glenda. David Jiménez Barreiro (Université Paris Nanterre) étudie ainsi le personnage d’Horacio Oliveira, anti-héros d’un « anti-roman », et la construction de ce personnage à partir d’une polyphonie narrative. Par ailleurs, les nouvelles composant Queremos tanto a Glenda ayant été étudiées de façon moins exhaustive que l’ambitieuse Rayuela, Julien Roger (Sorbonne Université) privilégie un aspect encore peu traité et pourtant significatif de ces récits : la présence des animaux en tant que figures de transtextualité au sein de l’ouvrage. Deux articles se focalisent aussi plus précisément sur l’analyse littéraire d’une nouvelle : celui de Benoît Coquil (Université Paris Est-Créteil), qui analyse l’espace souterrain dans « Texto en una libreta » et les possibles lectures politiques du récit, et celui de Sandra Gondouin (Université de Rouen-Normandie) et Andra Barbu (Université de Rouen-Normandie), qui voient dans la métalepse à l’œuvre dans « Historias que me cuento » la figure de l’anneau de Moebius, chère à Cortázar.
Bien entendu, la question de l’écriture, de la poétique des œuvres étudiées et de leurs structures sont également au cœur des réflexions proposées ici ; elles font l’objet de la troisième partie du volume. Elvire Gómez Vidal (Université Bordeaux Montaigne) étudie ainsi la complexe architecture de Rayuela en dessinant les « clés de voûte » parmi l’enchevêtrement de ses chapitres ; un enchevêtrement que Marta Inés Waldegaray (Université de Reims Champagne-Ardenne) observe également en faisant dialoguer les deux ouvrages et en mettant en lumière le tissage des voix énonciatives qui les caractérise. De même, Olga Lobo (Université Grenoble-Alpes) évoque la structure complexe de Rayuela en choisissant l’image d’une « double spirale » sur laquelle elle revient à travers les déclarations critiques de l’auteur, tandis que Paula Klein (École Normale Supérieure) analyse la façon dont celui-ci renouvelle l’objet-livre et revalorise le quotidien, ses objets et ses rebuts, pour modifier la perception esthétique du lecteur. Ces diverses études éclairent donc la composition novatrice et intriquée de Rayuela, mais aussi de Queremos tanto a Glenda, avec la toile de son réseau d’intertextualité et d’intermédialité devenant le filtre de la réalité selon l’analyse d’Antoine Ventura, ou les multiples plans énonciatifs se superposant dans « Historias que me cuento » et dont Eduardo Serrano Orejuela (Universidad del Valle / Cali) rend compte de manière très vivante. Celui-ci met en effet en scène d’un dialogue entre un étudiant et son enseignant, un procédé inspiré de la fiction critique de Pierre Bayard.
Enfin, dans une quatrième et dernière partie, Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), Soline Martinez (Université Paris Nanterre), Yann Seyeux (Université Paris Nanterre) et Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre) proposent une microlecture au sein de Rayuela et mènent une enquête minutieuse en trois volets – diégétique, littéraire et philosophique – pour comprendre ce qu’a bien pu devenir le chapitre 55, mystérieusement absent (en apparence) du parcours de lecture proposé par le « Tablero de direcciones » et rendre compte de la portée de cette disparition ***
Caroline Lepage et Sandra Gondouin
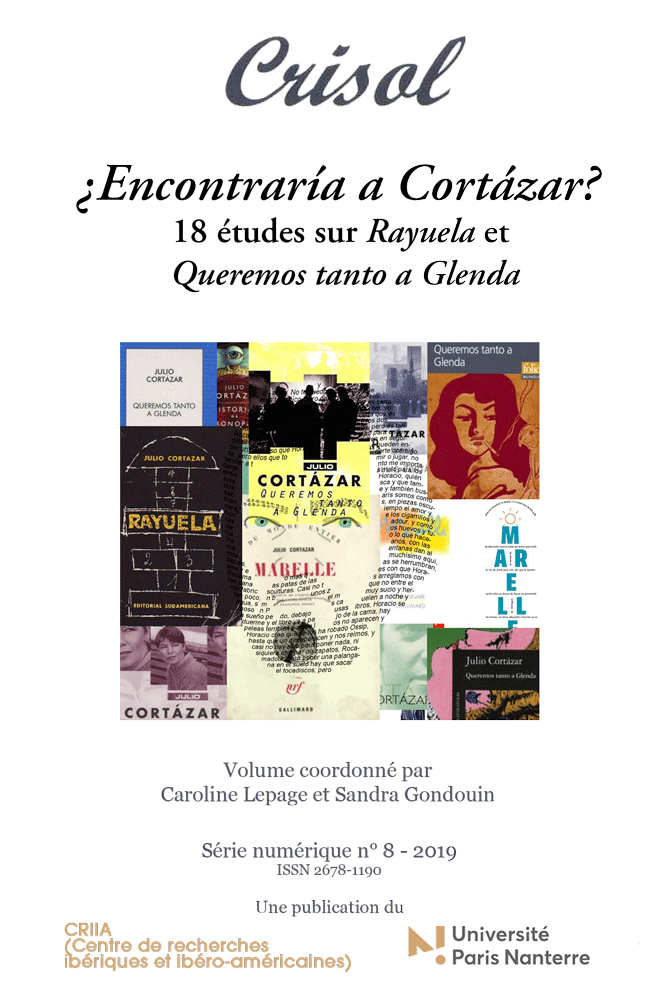
SOMMAIRE
1- Cortázar d'après ses lecteurs et lui-même
Alain Sicard (Université de Poitiers), «Rayuela: bitácora de una relectura»
Dina Grijalva (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa), «Mi universo Rayuela»
Miguel Herráez (UCH de Valencia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación), «El fenómeno del Boom y Rayuela como referencia de discurso dislocado»
Victoria Ríos Castaño (Coventry University/RU), «Rayuela selon Cortázar: de l’éxperience métaphysique à la réception du lecteur»
2- Thèmes, motifs et discours dans Rayuela et Queremos tanto a Glenda
Olga Lobo (Université Grenoble-Alpes. I.L.C.E.A.4), «Rastreos por la doble espiral de Rayuela. Itinerarios de lectura a partir de ficciones, cartas, ensayos, Cuaderno de Bitácora y (algunas) referencias críticas»
Benoît Coquil (Université Paris Est Créteil), «Du jeu dans la machinerie. À propos de « Texto en una libreta » (Queremos tanto a Glenda)»
David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre), «Horacio Oliveira, la construcción de un personaje de antinovela»
Julien Roger (Sorbonne Université), «Les animaux, figures de transtextualité dans Queremos tanto a Glenda»
Sandra Gondouin et Andra Barbu (Université de Rouen Normandie/ERIAC), «Sous les paupières, la réalité? «Historias que me cuento» de Julio Cortázar: une métafiction sous forme d’anneau de Moebius»
3- Questions d’écriture dans Rayuela et Queremos tanto a Glenda
Elvire Gómez Vidal (Université Bordeaux Montaigne), «Rayuela, “la gran rosa policroma”»
Eduardo Serrano Orejuela Olga (UNIVERSIDAD DEL VALLE / Cali - Colombia), «HISTORIAS QUE TE CUENTO – Planos enunciativos en “Historias que me cuento”, de Julio Cortázar»
Antoine Ventura (Université Bordeaux Montaigne), «Intertextualidad literaria y artística en Queremos tanto a Glenda de J. Cortázar»
Paula Klein (École normale supérieure), «“Changer la vie”: poétique du regard et redécouverte du quotidien dans Rayuela (1963) de Julio Cortázar»
Marta Waldegaray (Université de Reims Champagne-Ardenne CIRLEP/EA 4299), «Brouillé, dansant, enchevêtré… mirada e ilusión enunciativa en la ficción cortazariana»
Cecilia González Scavino (Université Bordeaux Montaigne), «Los usos poéticos de la interferencia en Rayuela»
4- Une micro-lecture dans Rayuela
Caroline Lepage, Soline Martinez, Yann Seyeux et Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre – EA Études Romanes / CRIIA – GRELPP), «Mais où est passé 55? (Le statut et les sens du chapitre 55 de Rayuela)/Volet 1 –la diégèse»
Caroline Lepage, Soline Martinez, Yann Seyeux et Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre – EA Études Romanes / CRIIA – GRELPP), «Mais où est passé 55? (Le statut et les sens du chapitre 55 de Rayuela)/volet 2 –le projet littéraire»
Caroline Lepage, Soline Martinez, Yann Seyeux et Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre – EA Études Romanes / CRIIA – GRELPP), «Mais où est passé 55? (Le statut et les sens du chapitre 55 de Rayuela)/volet 3 – le projet philosophique»
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
Publiée: 2019-05-16 -
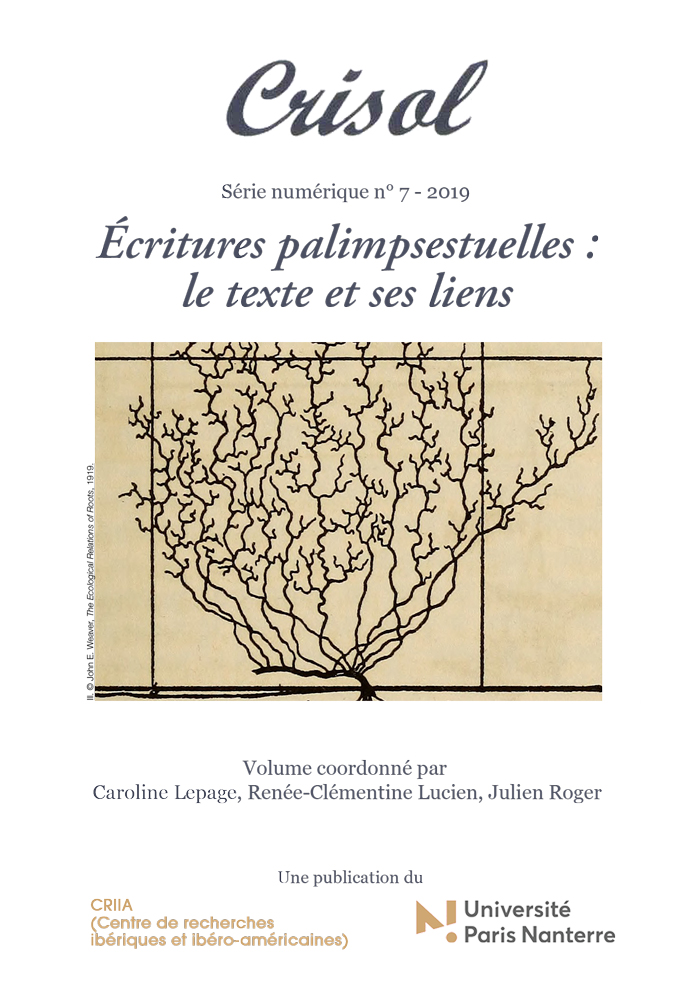 Les écritures palimpsestuelles: le texte et ses liens
No 7 (2019)
Les écritures palimpsestuelles: le texte et ses liens
No 7 (2019)De par l’influence paradoxale de la circulation du sens, le texte fait sauter le verrou du temps orienté et irréversible. Qui songerait à nier que l’Ulysse de James Joyce ne serait pas ce qu’il est sans l’Odyssée ? Et pouvons-nous dire que nous lisons l’Odyssée de la même façon après avoir lu l’Ulysse de James Joyce ? En prenant les choses autrement on devrait affirmer que l’Ulysse de James Joyce était programmé par le sémiotope de l’Odyssée, ou encore que l’Ulysse est une des versions récentes de l’Odyssée (Fragments sur le texte, 2002, p. 60).
À un an du décès de Gérard Genette (11 mai 2018), la présente publication témoigne de la vitalité de son œuvre théorique, dont l’importance dans la révolution intellectuelle de la « nouvelle critique », dans le sillage du magistère de Roland Barthes, n’est plus à démontrer. Ses écrits, qui s’étendent sur plus de 40 ans, ont connu un succès inusité dans le champ de la théorie littéraire, grâce en particulier à l’élaboration d’un système, finement ciselé, de notions bien définies, qui balisent totalement l’analyse textuelle.
Ma génération, qui suivait de près celle de l’auteur des Figures, parlait couramment la langue genettienne, et la transmettait fidèlement aux étudiants, ravis de devenir à leur tour des experts dans le maniement des préfixes grecs et latins (auto-, hétéro-, homo-, intra-, extra-, hypo-, hyper-, meta-, pré-, post-, trans-, inter-), et de quelques termes succulents, à employer sans modération : palimpseste, architexte, mimologique, immanence et transcendance. En lisant le bouquet des études qui constituent le présent volume, je constate avec satisfaction que, toutes générations confondues, les critiques universitaires continuent de manier avec dextérité le système bâti par Gérard Genette. Plus éclectiques que le maître, les hispanistes ici présents ne se limitent pas à rechercher les liens qui unissent, souterrainement, deux ou plusieurs textes littéraires, leur conférant ainsi des sens imprévisibles et souvent magiques. Ils s’intéressent à de multiples champs de la création esthétique : peinture, gravure, arts graphiques, cinéma, photographie, chanson contemporaine, rap, modalités du discours historique ou mythique. Cette mise en consonance de savoir-faire pluriels, et parfois très hétérogènes, répond à la volonté de faire époque, certes, mais aussi et en même temps à celle de montrer que la critique évolue avec le champ culturel où elle s’inscrit.
Milagros Ezquerro, mai 2019
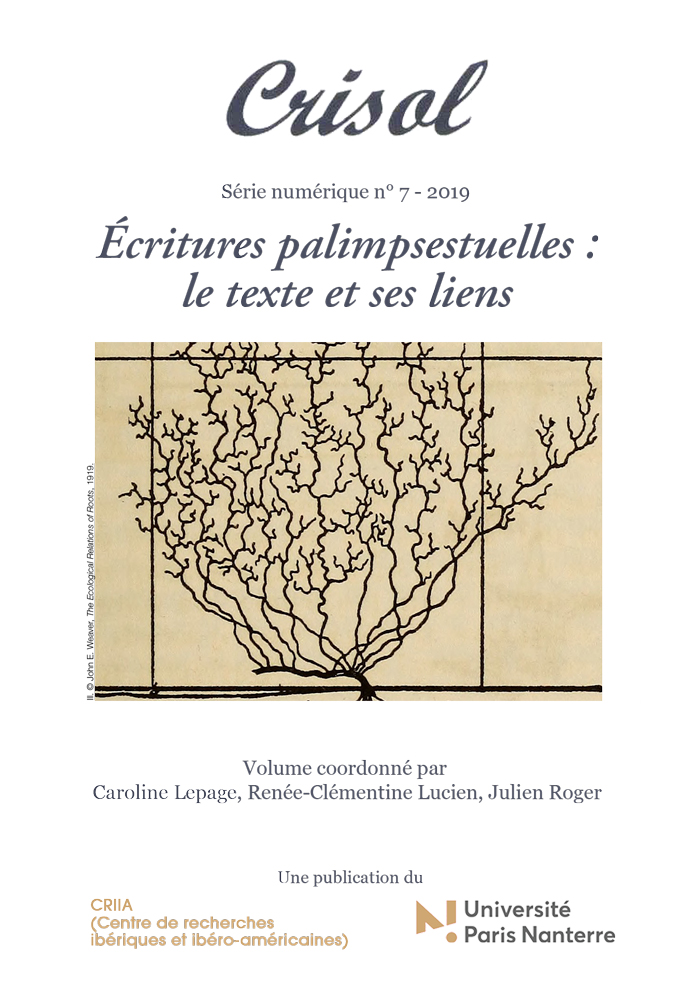
SOMMAIRE
L’intertexualité et la réécriture
David Álvarez Roblin (Université de Picardie – Jules Verne), «L’intertextualité problématique des contes de fous dans le Quichotte de 1615»
Julien Roger (Sorbonne Université), «Un personnage transtextuel: la figure du Juif errant dans l'œuvre de Leopoldo Lugones»
Caroline Lepage et Elena Geneau (Université Paris Nanterre), «Borges, García Márquez dans et depuis Kalpa imperial (1983), de Angélica Gorodischer»
Liliana Riaboff (Université Paris Nanterre), «Des sirènes et des lamantins dans l’œuvre de Gabriel García Márquez : dérives entre hyper et autotextualité»
Anne Garcia (Université Paris-Est Créteil), «Appropriation? Approximation? Prégnance de l’hypotexte biblique et rôle de la traduction dans la pratique poétique de José Emilio Pacheco. L’exemple du Cantar de los cantares».
Elsa Fernández (Université Paris Nanterre), «Les relations transtextuelles entre Lituma en los Andes et Abril Rojo»
Éléonore Parchilniak (Université Paris Nanterre): «Palimpsestes et fantômes dans Los ingrávidos: une hantologie»
Le dialogue entre les arts: poétiques et processus de l’intermédialité et de la transgénéricité
Hervé Le Corre (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), «L’entrelacs. Poésie, images et érotisme dans retórica erótica (2002) de Liliana Lukin»
Florence Olivier (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), «La photographie à la source du récit. De Cortázar à Bolaño»
Renaud Malavialle (Sorbonne Université), «Transtextualité et transgénéricité dans le récit hispano-américain contemporain: réflexions sur les sources et formes de la modernité»
Renée-Clémentine Lucien (Sorbonne Université), «Muerte de Nadie, d’Arturo Arango, La novela de mi vida, de Leonardo Padura, et Retour à Ithaque, ou les variations d’une Odyssée sans fin»
Judite Rodrigues (Université de Dijon), «Transtextualité subversive et travail des communs: quelques mécanismes dans les œuvres de Jorge Riechmann, David Franco Monthiel et Miguel Brieva»
Sandra Gondouin (Université de Rouen – Normandie), «La rappeuse guatémaltèque Rebeca Lane entre paroles et images: transtextualité et intermédialité dans la “Cumbia de la memoria”»
Pratiques métatextuelles et intertextuelles
Mariana Di Ció (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), «El inefable centro del relato, A propósito de (Tomas para un documental) de Daniel García Helde»
Davy Demas (Université d’Albi), «La letra con sangre entra. Pratiques métatextuelles et intertextuelles dans le roman noir mexicain: renouvellement ou dégradation d’un genre?»
Graciela Villanueva (Université Paris-Est Créteil), «Trois questions sur la transtextualité genettienne à partir d’une étude de textes de la littérature argentine»
Pénélope Laurent (Sorbonne Université), «La picaresque dans Hasta no verte Jesús mío: la fiction au coeur du récit»
Emmanuel Vincenot (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), «Le grand détournement: hypertextualité filmique et parasitisme de marque»
Palimpseste et discours mémoriel
Marie Lecouvey (Université Paris Nanterre), «Quetzalcoátl messianique: chroniques coloniales et colonialisme interne dans la péninsule mexicaine (1880-1895)»
Stéphanie Decante (Université Paris Nanterre), «Guadalupe Santa Cruz, une poétique de l’écho»
Eva Touboul (Université Paris Nanterre), «La récupération de la mémoire historique: un palimpseste historiographique?»
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre), «Les scrapbooks de Purita Kalaw Ledesma (1914-2005): la transtextualité comme processus de production de l’histoire des arts philippins (1948-2000)»
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
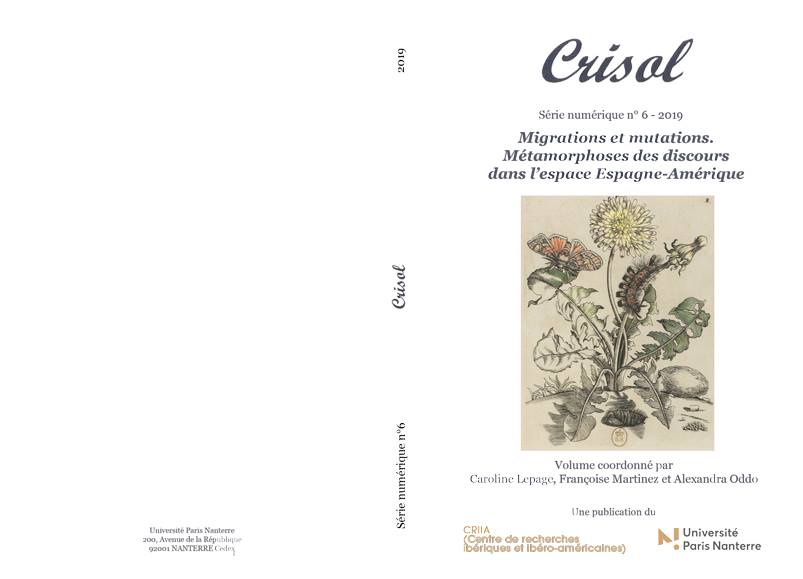 Migrations et mutations – métamorphose des discours dans l’espace Espagne-Amérique
No 6 (2019)
Migrations et mutations – métamorphose des discours dans l’espace Espagne-Amérique
No 6 (2019)Quels sont les effets des mobilités des individus, seuls ou en groupes, sur les productions écrites et orales en langue espagnole ?
À partir d’une série de réflexions interdisciplinaires qui vont puiser aux outils et aux méthodes de la linguistique, de l’histoire politique et de la littérature, ce numéro de Crisol se propose de repenser les effets des mobilités, d’observer des phénomènes de mutation, d’étrangéisation et de resignification terminologiques, dans la production de discours en langue espagnole.
Divers corpus, outils et méthodologies, sont ainsi mis au service d’une meilleure compréhension des enjeux linguistiques, historiques, politiques et littéraires suscités par la problématique migratoire associée aux mutations discursives.
Qu’il s’agisse d’analyser des mobilités textuelles et des représentations de mouvements migratoires, d’éclairer les usages et les réappropriations idéologiques de concepts aux intérêts politiques bien compris, ou de mesurer la variation diatopique dans l’aire hispanophone, la langue espagnole et les incidences des migrations sur cette langue restent le dénominateur commun de ces réflexions menées par quinze chercheurs hispanistes.
Ces mots et ces formes discursives qui migrent se dotent alors de toute une palette de nuances dans une perspective à la fois diachronique et synchronique. Leurs effets de mode, leurs abandons, leurs substitutions et resignifications, sont à déconstruire pour cerner des évolutions de la langue espagnole, amenant tout un chacun à dire et lire différemment le réel.
Caroline Lepage, Françoise Martinez, Alexandra Oddo
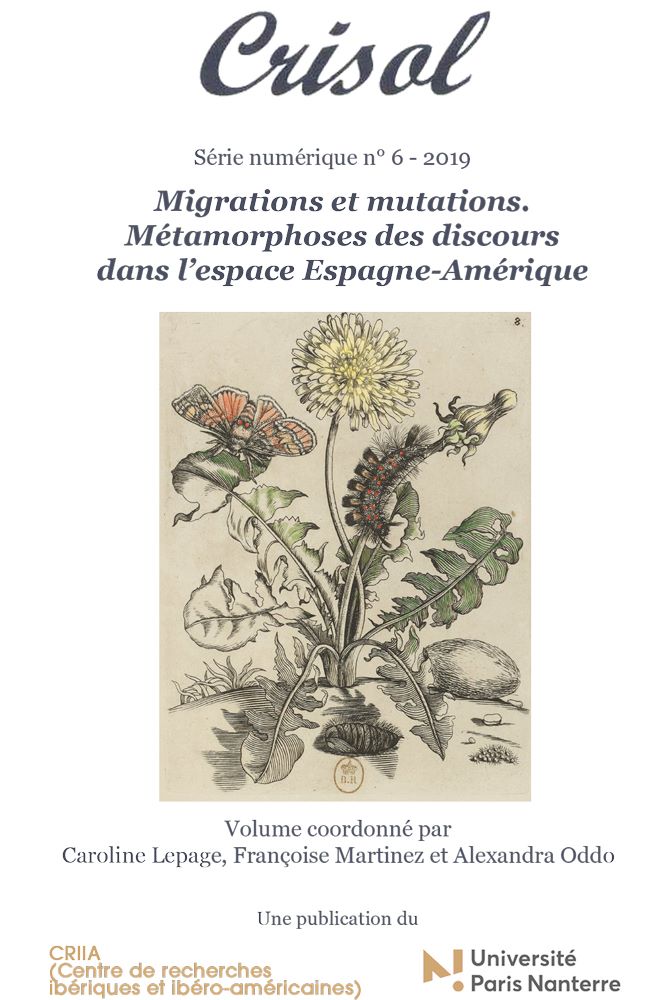
SOMMAIRE
Volet 1 : Littéralités migrantes
Pénélope Laurent (Sorbonne Université) : «Quelques cas de migrations textuelles dans la littérature argentine».Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) et Elena Geneau (doctorante Université Paris Nanterre) : «La science-fiction ou l’expérimentation radicale de la migration et des mutations (langue, discours et formes du texte)».
Graciela Villanueva (Université Paris-Est Créteil) : «Patricio Pron y el espíritu de los padres que sigue subiendo en la lluvia».
Elena Geneau (Université Paris Nanterre), «Lo epistémico y lo actancial del discurso a partir de una situación de desplazamiento corporal tangible o incorpóreo en Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castagnet y Sexografías de Gabriela Wiener»
Éléonore Parchliniak (Université Paris Nanterre), «La littérature hors de ses frontières»
Volet 2 : politiques éducatives et récupérations conceptuelles
Françoise Martinez (Université Paris 8) : «Du ‘régénérationnisme’ espagnol à la ‘régénération’ éducative bolivienne : avatars d’un concept politique».
David Macías Barrés (Université Lyon 3) : «Políticas estatales e identidades en el Ecuador: etnicidades de la Costa y “reindigenización».
Sara Dichy-Malherme (Universités de La Rochelle et Paris Nanterre) : «Du soulèvement de l'Inti Raymi à la Constitution du sumak kawsay: fonctions symboliques du kichwa dans le discours politique équatorien».
Volet 3 : transformations des lexiques, récits et discours
José Vicente Lozano (Université de Rouen) : «La lengua encarcelada por las pequeñas pantallas: de México a Madrid, pasando por Buenos Aires, cuestiones diasistemáticas de léxico, fraseología y maledictología».Stéphane Oury (Université de Metz) : «Entre migration et mutation, variations prosodiques, morphologiques et sémantiques du lexique de part et d'autre de l'océan : le cas des faux amis internes parmi les américanismes».
Benoit Coquil (Université Paris-Est Créteil) : «Lenta biografía de Sergio Chejfec : récit d'exil et étrangisation de la langue».
Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) et Elsa Fernandez (Université Paris Nanterre) : «Beatriz/Paul Preciado : des mutations et des migrations en tout genre».
Volet 4 : Variations diatopiques en diachronie
Amélie Piel (Université Paris Nanterre) : «Ruptures de concordances temporelles: variation diatopique ou réalité panhispanique».
Alexandra Oddo (Université Paris Nanterre) : «Fragmentation de la langue espagnole dans l’espace: le cas de la parémiologie latino-américaine ».
Mariana Echegaray Camacho (doctorante Université Paris Nanterre) : «Strigas, brujas, hechiceras y curanderas: l’évolution du lexique de la sorcellerie de l’Espagne au Nouveau Monde (XVII-XVIIIe siècles)».
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
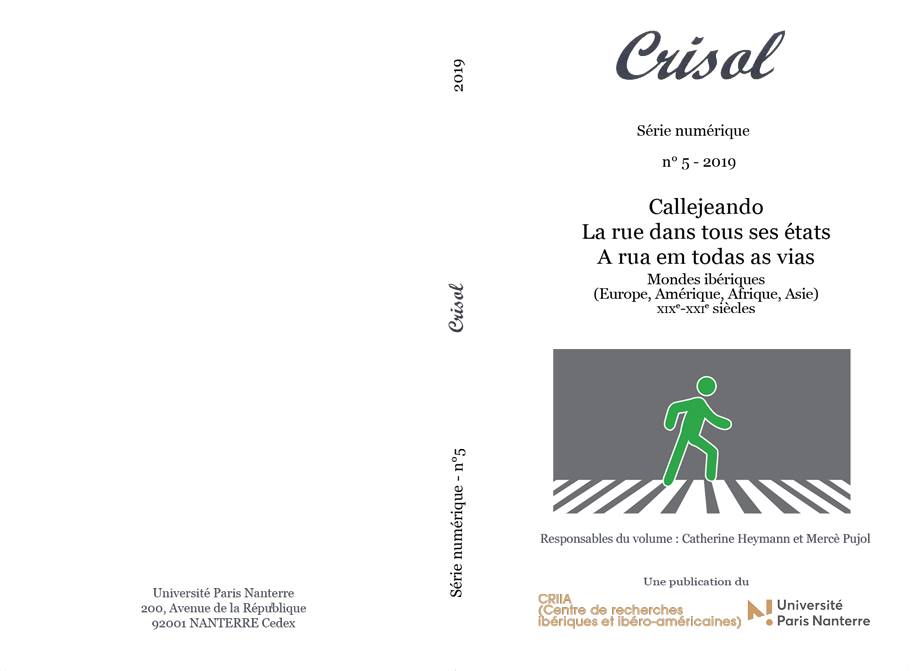 Callejeando / La Rue dans tous ses états / A rua em todas as vias
No 5 (2019)
Callejeando / La Rue dans tous ses états / A rua em todas as vias
No 5 (2019)En 2014, le Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines (CRIIA, EA 369 Études romanes) a choisi d’engager une réflexion sur « La rue ». Élément constituant de la ville, assurant la mise en relation d’espaces et de groupes sociaux distincts, la rue est une forme qui a une configuration, une architecture et une histoire aux multiples facettes. À travers le temps, elle a développé des logiques et des dynamiques propres. Ses usages, ses pratiques et ses représentations ne peuvent se comprendre sans une prise en compte de l’histoire politique, sociale, économique et culturelle et plus récemment des études sur l'histoire urbaine.
Au terme de seize séminaires auxquels ont participé l’ensemble des membres du CRIIA ainsi que des enseignants-chercheurs français et étrangers invités dans la perspective d’une approche interdisciplinaire, un colloque international a été organisé en octobre 2017 en association avec le Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde lusophone (CRILUS), membre de l’EA 369. Privilégiant l’époque contemporaine, « Callejeando/La rue dans tous ses états/A rua em todas as vias. Mondes ibériques (Europe, Amérique, Afrique, Asie) XIX-XXI » a réuni une trentaine de chercheurs confirmés ainsi que des doctorant-e-s de l’université de Paris Nanterre et d’autres universités.
Ce numéro, trilingue, est le fruit du travail collectif mené durant ces quatre années, qui a permis une réflexion très stimulante au-delà des disciplines considérées comme « classiques » dans l’hispanisme.
Si, dans les sociétés occidentales ou occidentalisées, la ville s’est transformée en permanence au cours des siècles, la seconde moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle ont marqué une étape importante. Pour expliquer ces évolutions, de nombreuses études d’histoire urbaine, s’inscrivant dans le cadre d’une opposition entre tradition et modernité, ont mis en relief le facteur démographique, l’essor industriel, les progrès techniques et ont souligné le rôle des politiques gouvernementales et des architectes, présentés comme « les » bâtisseurs de la ville moderne. Ce n’est que plus récemment, comme en témoignent plusieurs articles présents dans ce volume, que l’histoire sociale et l’histoire culturelle se sont intéressées au rôle joué par d’autres acteurs dans la transformation de l’espace public à travers l’analyse des conflits, des manifestations – sous toutes leurs formes y compris artistiques – dont la rue est tout à la fois le théâtre et l’enjeu, mettant au jour un processus tout à la fois plus complexe et plus ouvert. La rue ainsi appréhendée est celle des gens ordinaires, anonymes, des ouvriers, des contestataires, de ces « hommes de la rue » qui font pression sur les élites pour qu'elle se transforme et qu'elle leur appartienne.
Liée à l’individualisation des habitats, à la circulation des denrées alimentaires, à l’évolution des transports, la rue a connu une expansion, inégale et plus ou moins maîtrisée, au cours des XIXe et XXe siècles. Mais la « rue de l’urbaniste » n’est pas seulement cet « espace matériel aménagé » qu’a défini l’historien Maurice Garden. Elle est politique dans sa gouvernance et son organisation, emblématiques d’une volonté de régulation et de contrôle dont témoigne le tracé des villes. S’insérant dans le long processus, tout à la fois ininterrompu et discontinu, de configuration urbaine, la structuration de l’espace de la rue s’est opérée par étapes, parfois au prix de « désordres », dont rendent compte plusieurs études de cas qui portent sur le Madrid de la fin du XIXe siècle et du début du XXe : Promenade du Prado (charnière entre la zone historique et la nouvelle ville), rue du Chemin de fer (conflit latent entre l'espace et l'être humain), rues des banlieues ouvrières situées au nord de la capitale dans la période de l’entre-deux guerres mais aussi rue de la Plage à Belem, au Brésil (processus de transformation profonde au parcours conflictuel). De la même manière, dans le Madrid du début du XXe siècle, les espaces de plaisir font l’objet d’une « normalisation » comme le montre la mutation de la rue Sainte Brigitte. En revanche, dans la Lisbonne de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque, l’analyse de la cartographie de l’homosexualité masculine fait apparaître l’existence d’espaces et de rues, « invisibles à la ville normative », qui sont le territoire de ceux que la science et la loi instituent alors comme « sujets déviants » : l'homosexualité est ainsi inventée en tant que catégorie sociale.
Si le contrôle social de l’État peut s’exercer par la voie législative (répression de l’ébriété, de la mendicité ou de la prostitution en Équateur à la fin du XIXe siècle et enfermement dans des institutions de bienfaisance), la rue est aussi un espace politique symbolique dans le cadre de la lutte pour l’espace public qui s’exprime de plusieurs façons. Qu’il s’agisse des mobilisations monarchistes ou républicaines dans l’Espagne du Sexenio democrático (1868-1874) ou des manifestations joyeuses, « parenthèse enchantée » au sens propre, qui marquèrent la victoire républicaine, obtenue par les urnes en 1931, qui prirent des airs de fête et de célébration. Une autre expression symbolique est celle du choix de la toponymie urbaine des territoires du domaine linguistique catalan (plus particulièrement l’île Baléare de Majorque), analysée au prisme de la gouvernance socialiste au cours de la seconde République espagnole dans le but de construire un imaginaire collectif ou encore celle de l’espace urbain de Ceuta et Melilla, « places de souveraineté » selon la terminologie coloniale à leur sujet, où s’affrontent deux nationalismes (espagnol et marocain) à travers l’enjeu des commémorations et des monuments. Expression symbolique enfin dans les villes d’Amazonie péruvienne dont les murs reflètent les attentes et les espoirs tout autant que la lutte contre les injustices : ils font la démonstration que le processus d’intégration au territoire national est toujours en cours.
Lieu de passage, d’échanges et d’activités économiques, la rue est devenue à l’époque contemporaine un espace privilégié du spectacle urbain. Dans le Madrid du premier tiers du XXe siècle, le développement de la publicité visuelle et acoustique a mis en scène la nouvelle culture de la consommation. Dans les guides de voyage dont le nombre a commencé à augmenter dès la seconde moitié du XIXe siècle, la représentation des rues a évolué : ainsi dans le faubourg sévillan de Triana, telle rue jadis « dangereuse », est aujourd’hui « réhabilitée » et son « pittoresque » donne de la valeur à sa « mise en tourisme ».
Si la prise en compte des décisions des acteurs économiques, par leur choix de localisation, leurs investissements conditionne en partie l’évolution des paysages et des pratiques, les acteurs publics (administration, municipalités) jouent, eux aussi, un rôle important (autorisations d’ouverture d’établissements divers, de permis de construire). Dans le contrôle et la gestion des rues des zones nord et sud de la ville de Medellín se dessinent les rapports entre État, pouvoirs locaux, intérêts économiques et corruption, les plus démunis des habitants en faisant les frais, car ils sont sous domination de l'État.
D’un côté et de l’autre de l’Atlantique, hors des lieux consacrés – généralement clos – les manifestations artistiques dans la rue se sont multipliées. Dans le domaine du théâtre, les dramaturges espagnols adeptes du Nouveau Théâtre ont écrit, à partir des années 70, un théâtre d’avant-garde, tenu à l’écart de la scène commerciale, du fait de la censure et du public bourgeois, qui l'ignorait. La rue a été pour ces nouveaux auteurs, qui développaient une réflexion politique, un espace scénique alternatif de liberté et de contestation alors que la dictature espagnole se maintenait. Plus récemment, les politiques culturelles de la ville de Bilbao ont valorisé le théâtre de rue. Outre l’objectif touristique, l’une des préoccupations est d’encourager la cohésion sociale entre les différents quartiers de la ville.
Manifestant une volonté de lutter contre la privatisation de l’espace public et la dépossession d’une zone d’expression pour les habitants, les arts dits de la rue sont partis à la reconquête de cet espace public. Se réappropriant le paysage urbain devenu espace de représentation, le théâtre pluridisciplinaire et communautaire portugais (O Bando) ou la Compagnie Circolando avec sa machinerie ou Radar 360° proposent aujourd’hui de nouvelles lectures et une nouvelle perception de l’espace urbain. En investissant temporairement et symboliquement cet espace, ces manifestations réinventent ou renouent des relations avec le public et peuvent, au-delà de l’instant, contribuer à approfondir la perception de et la réflexion sur l’espace urbain. Ainsi, le street art ou « art public », essentiellement éphémère, destiné au plus grand nombre, est fondé sur la volonté d’instaurer une forme de communication et d’interaction entre un créateur et le public. En témoignent plusieurs street artistes (Ruina, Olaf Ladousse du collectif El Cartel, Noaz, Nuria Mora) face à une gestion de plus en plus privatisée de l’espace public, à l’invasion publicitaire et à une logique marchande généralisée. Dans les quartiers populaires de Lima, la production de nombreux collectifs artistiques, dont plusieurs se situent dans la mouvance Hip Hop, participe de cette réappropriation de l’espace urbain. Ces initiatives contre-culturelles solidaires visent à la reconstruction du tissu associatif et culturel, après les mandats dévastateurs du gouvernement Fujimori et tentent de résister à la gentrification de la capitale péruvienne.
Enfin, l’analyse des représentations de la rue dans le roman, qu’il soit du XIXe ou du XXe siècle, implique d’interroger la mimesis autant que la liberté créatrice : par exemple celles qui sont à l’oeuvre dans le premier roman naturaliste de Benito Pérez Galdós (La desheredada), peu attiré par la description des milieux populaires et plus intéressé à faire que la rue serve la construction de la subjectivité de son personnage principal en même temps qu’elle constitue une fabrique inépuisable de l’imaginaire galdosien. Ou celle de la tétralogie havanaise de Leonardo Padura qui, dérogeant au code du genre du roman noir, propose un espace de la rue pratiquement dépolitisé et presque décontextualisé, « déréalisé », ce qui n’est pas le moindre de ses paradoxes. Pour sa part, le roman de Maria Ondina Braga, Nocturno em Macau (1991), qui relève de la veine intimiste, s’intéresse à l’expérience du mouvement de l’individu à travers le territoire dont la rue est un des éléments constitutifs et à la représentation de la rencontre avec l’autre culturel, sujet impossible à « situer ».
D’autres représentations littéraires et cinématographiques mettent en scène une rue qui, plus qu’un décor, est un espace de l’apprentissage politique, un « lieu de tous les dangers » mais aussi de « tous les possibles ». La rue devient un espace de résistance en particulier en temps de dictatures (par exemple celle de Salazar au Portugal), comme le montre la création d’Álvaro Cunhal et Urbano Tavares Rodrigues ou celle des cinéastes du Novo Cinema des années 1960. Dans plusieurs micro-récits chiliens du XXIe siècle au cœur desquels des collectifs d’écriture placent les questions de mémoire en contexte post-dictatorial, la rue, espace d’expression et du vivre-ensemble, est interrogée au prisme de la présence-absence des victimes.
Catherine Heymann et Mercè Pujol
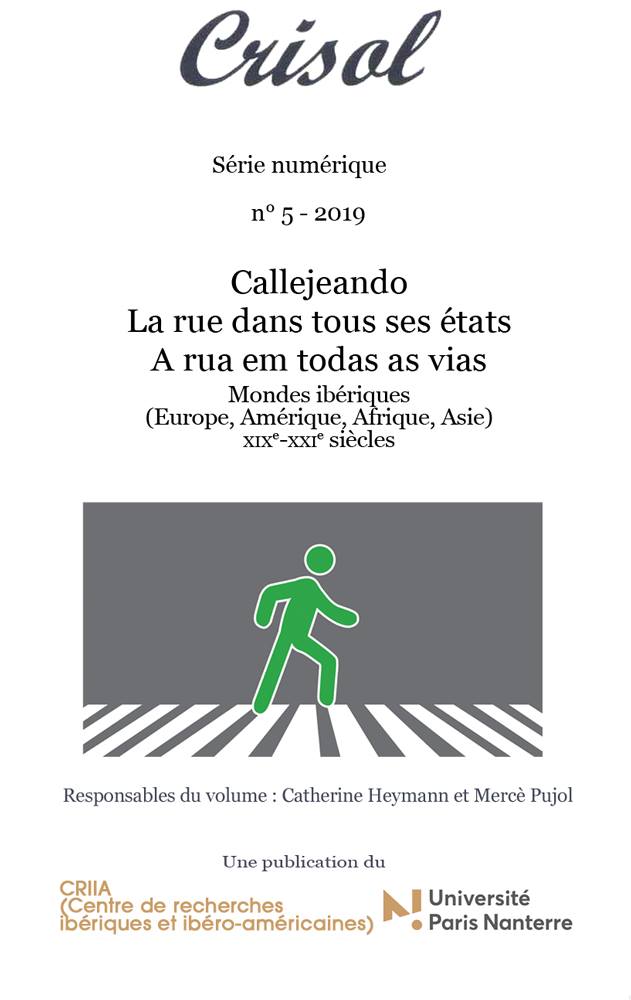
©Lorena Zaragoza / Kreata Estudio
Sommaire
Rubén Pallol Trigueros, «La lucha por la calle. Conflictos en la redefinición del espacio público en las ciudades de comienzos de siglo»
La « rue de l’urbaniste » : enjeux et conflits
Concepción Lopezosa Aparicio, «Funciones y valores adquiridos por el Paseo del Prado de Madrid en su proceso de conformación desde camino a calle»
Fernando Vicente Albarrán, «La calle del Ferrocarril. Desorden, conflicto y marginalidad en el proceso de modernización de Madrid (1850-1930)»
Carlos Hernández Quero, «Cuerpos bajo el metal, piedras contra el tranvía. Tráfico rodado, cultura de barrio y conflicto en los suburbios del Madrid de entreguerras»
Yara Reis, «Memórias e conflitos na formação da rua do porto de Belém»
Cristina de Pedro Álvarez, «La nueva sonrisa de cabaret. El impacto de la modernización urbana en los espacios de intercambio sexual de Madrid. La calle Santa Brígida, un estudio de caso (1870-1936)»
Fernando Curopos, «Cruising dans la Lisbonne fin-de-siècle»
Pouvoir politique et symbolique
Alexis Medina, «Discipliner la marginalité : le combat contre l’ébriété et la mendicité dans les rues des villes équatoriennes pendant la période progressiste (1883-1885)»
Sergio Sánchez Collantes, «Luchas simbólicas por el espacio público en el Sexenio Democrático : republicanos contra monárquicos en las calles españolas, 1868-1874»
Marie Angèle Orobon, «Prendre la rue en chantant : la proclamation de la IIe République en Espagne»
Aurelio Martí, «Las calles de la nación: socialismo y discursos de España durante la Segunda República»
Alicia Fernández García, «El nacionalismo español en las calles de Ceuta y Melilla»
Estelle Amilien, «Des murs et des rues. Quelle identité pour les villes d’Amazonie au Pérou?»
Espace social et espace économique
Nuria Rodríguez Martín, «El espectáculo está en la calle: la explosión de la publicidad exterior en Madrid durante el primer tercio del siglo XX»
Ivanne Galant, «"Cuando paso por el puente, Triana…”. Représentations du faubourg sévillan dans les guides de voyage (XIXe-XXIe siècles)»
Holmedo Peláez Grisales, «Estudio de caso: la dominación de los habitantes de la calle del Río Medellín en el control de las calles de la ciudad entre el terrorismo estatal y la narcoalianza»
Les arts et la rue, les arts dans la rue
Anne Laure Feuillastre, «La calle como escenario de protesta política en la España de los setenta»
Marina Ruiz Cano, «De "espectáculos" por Bilbao»
Catarina Firmo, «Marionnettes, corps actants et autres encombrants sur la voie publique»
Anne Puech, «L'espace public vu par les street artistes espagnols»
Pablo Malek, «Protestas, propuestas y proceso : un documentaire sur les initiatives contre-culturelles solidaires dans l’espace public de Lima»
Représentations
Yves Germain, «Les descriptions de la rue madrilène dans La desheredada de Galdós»
Caroline Lepage, «Présence et absence de la rue dans la tétralogie havanaise de Leonardo Padura Fuentes»
Gonçalo Cordeiro, «Em lugar de seguir a direito: Macau e o princípio de intransividade em Maria Ondina Braga»
João Carlos Vitorino Pereira, «La rue au service de la révolution : un enjeu majeur pour Álvaro Cunhal et Urbano Tavares Rodrigues»
Eurydice Da Silva, «Les rues lisboètes dans le cinéma portugais des années 60 : un espace de résistance pendant la dictature»
Camille Lamarque, «Rhizome fictionnel dans le micro-récit chilien. L’écriture réticulaire de la rue sous le régime dictatorial»
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
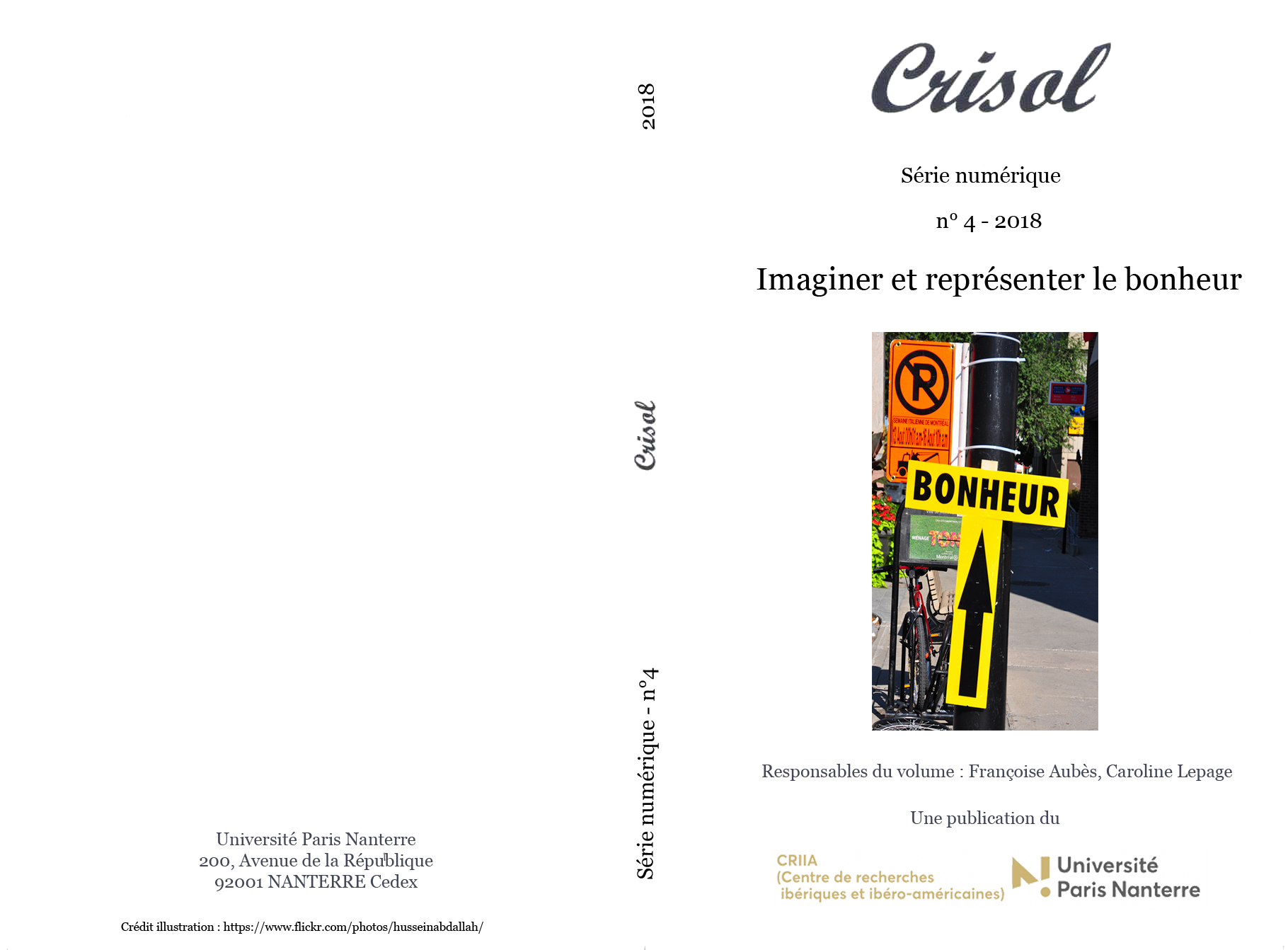 Imaginer et représenter le bonheur
No 4 (2019)
Imaginer et représenter le bonheur
No 4 (2019)Cette dernière livraison de CRISOL consacrée au Bonheur est le résultat du travail de recherche du GRELPP (Groupe de Recherche en Littérature, Philosophie et Psychanalyse) mené dans le cadre de séminaires puis d’une journée d’étude, qui se sont tenus à l'Université de Paris Nanterre.
La notion de bonheur, interrogation philosophique, par excellence, est devenue ces dernières années un sujet prioritaire, voire une véritable injonction dans nos sociétés postmodernes, où l'aspiration majeure est une sorte de nouvel hédonisme. Sa représentation prend diverses formes, lesquelles semblent tout particulièrement s'épanouir dans ces nouveaux espaces de communication que sont les réseaux sociaux ; ces derniers fonctionnent il est vrai comme une sorte de vitrine de ce qui pourrait être une certaine idée du bonheur pour quiconque poste sur son « mur » des images, des statuts, etc., toute une iconographie personnelle, croyant ainsi saisir cette notion si fuyante et nous dire : « Regardez comme je suis heureux ! ».
La recherche en littérature n'échappe pas à la grande rumeur du monde ; gageons d’ailleurs qu’elle l’accompagne, peut-être, parfois, qu’elle sait la précéder. Et les contributions de ce numéro 3 de la série numérique de CRISOL examinent une notion complexe et étonnement difficile à cerner, tant est riche le vaste spectre sémantique que le mot bonheur – en français – ou felicidad, dicha – en espagnol – recouvre, et cela dans des domaines variés : la littérature hispanophone et ses différents registres, la poésie, le théâtre, mais surtout la prose fictionnelle – roman, micro-récit, nouvelles, etc. – dans ses divers genres. Sans oublier le domaine historique ainsi que la peinture.
Le bonheur est d'abord une quête existentielle, utopique. Argument majeur de bien des romans, sa recherche exige d'entreprendre un voyage dans l'espace et dans le temps ; l'espace-temps des origines peut-être celui de la Selva, comme dans le roman d'Alejo Carpentier Los pasos perdidos (1953), qu'analyse David Barreiro Jiménez. Mais c'est aussi celui du retour vers l'enfance, ce topos habituellement lié au bonheur ou, du moins, à l'illusion d'un bonheur à jamais perdu. Illusion que l'Argentin Alan Pauls démonte dans deux de ses livres analysés par Graciela Villanueva. Le déplacement peut prendre des allures encore plus impressionnantes, comme celle du voyage intersidéral, quand on aborde la science fiction ; ce qu'explique Elena Geneau, en reprenant l'image des trous noirs, métaphore de la vertigineuse force d'attraction de cette quête universelle. Cheminement personnel vers Dieu, croyance en un monde harmonieux après la mort, pour le poète équatorien César Dávila Andrade, étudié par Caroline Berge, le bonheur est aussi indissociable du vivre en société, du vivre ensemble. C'est ce qui sous-tend l'univers romanesque du péruvien Edgardo Rivera Martínez dans País de Jauja (1993) ; pour Françoise Aubès, dans ce roman paradoxalement sans héros problématique, le bonheur se décline simplement au jour le jour pour l'adolescent Claudio, adolescent épris de musique, de culture grecque et andine à la fois. Le bonheur serait-il donc dans les Andes ? Hélène Roy interroge la figure de l'Inca à la tête d'un empire dont les sujets auraient vécu un bonheur collectif sans pareil. Elle montre comment s'élabore l'utopie andine selon une certaine lecture idéologique de l'Histoire. À Cuba, le point de fracture de 1989 marquant la fin d'un « passé parfait », la nostalgie d'une société égalitaire devient l'argument du roman noir Pasado Perfecto (1991) pour Caroline Lepage, qui décrit le désarroi de Mario Conde, héros de la série policière de Leonardo Padura.
De nombreuses contributions s'intéressent au bonheur au féminin, encore une fois indissociable d'un contexte socio-culturel. La jeune philippine Cándida, héroïne de La carrera de Cándida, roman de Guillermo Gómez Windham (1921), étudié par Emmanuelle Sinardet se laisse tromper par une certaine idée du bonheur au féminin, dont le modèle serait la femme américaine émancipée ; or, dans la société patriarcale philippine sous occupation étasunienne, ce chemin ne mène qu'au malheur. On retrouve le thème de l'utopie collective dans El país de las mujeres (2010) de la Nicaraguayenne Gioconda Belli. Le bonheur au féminin ou félicisme est une république des femmes où gouverne le PIE (Partido de la Izquierda Erótica), comme le montre Sophie Large. Contre-pied de cette république des femmes libres, tel est l'Ange du foyer, paradigme des vertus féminines à la fin du XIXe siècle, comme le rappelle la contribution de Sylvie Turc Zinopoulos dans sa lecture de Una vida sin mancha (1883), de María del Pilar Sinués.
Teresa Orecchia Havas, quant à elle, choisit d'explorer dans deux romans argentins contemporains ce double négatif du bonheur qu'est le malheur, comprendre la perte. Tandis qu’en analysant les excipit de poésies espagnoles contemporaines, Nuria Rodriguez Lázaro constate qu'il n'y a point de poésie « heureuse ». Claude Esteban, poète et traducteur y cherche pourtant le chemin qui mène à l’Arcadie, suivant la lecture qu’en fait Pascal Hermouet. Selon Béatrice Ménard, on retrouve le même cheminement vers le bonheur grâce à une sorte d’union cosmique avec la nature dans Todos mis poemas (1983) du poète espagnol Claudio Rodríguez. Si le bonheur relève d'une morale, il relève également d'une esthétique, celle du beau ; et pour le peintre Joaquin Sorolla, selon Lina Iglesias, c'est la fulgurance du blanc qui le traduit le mieux.
Ces communications offrent donc de multiples approches de la représentation du bonheur – amour, utopie, nostalgie. Individuel ou collectif, le bonheur serait donc cette ligne d'horizon inatteignable. Mais l'espoir de s'en approcher est ce qui caractérise le genre humain et donne naissance à ses plus belles expressions artistiques.
Françoise Aubès

________________________________
Sommaire du numéro
David Barreiro Jiménez
«Los pasos perdidos (1953) de Alejo Carpentier – “La selva y la búsqueda de la felicidad”»Graciela Villanueva
«La felicidad en La vida descalzo (2006) e Historia del llanto (2007) de Alain Pauls»Elena Geneau
«Los agujeros negros de la felicidad en relatos y microrrelatos de Marcial Souto, Eduardo Carletti y Ana María Shua»Caroline Berge
« Bonheur et mysticisme dans les œuvres de César Dávila Andrade »Françoise Aubès « L'écriture du bonheur dans País de Jauja (1993) de l'écrivain péruvien Edgardo Rivera Martínez »
Hélène Roy
« Le bonheur est dans les Andes : la figure inca aux frontières de l’histoire et de la fiction »Caroline Lepage
« Mario Conde à la recherche du bonheur perdu »Emmanuelle Sinardet
« Du bonheur américain au malheur philippin : La carrera de Cándida (1921) de Guillermo Gómez Windham (1880-1957) »Sophie Large
« Le “félicisme” dans El país de las mujeres de Gioconda Belli »Sylvie Turc-Zinopoulos
« Le bonheur possible dans le drame Una vida sin mancha (1883) de María del Pilar Sinués »Teresa Orecchia Havas
« La pérdida de la felicidad en dos novelas argentinas contemporáneas »Pascal Hermouet
« La question du bonheur chez Claude Esteban »Lina Iglesias
« Le blanc ou la fulgurance du bonheur dans l’œuvre de Joaquín Sorolla »Nuria Rodríguez Lázaro
«“El dulce lamentar de dos pastores”: apuntes sobre la felicidad en la poesía hispánica »Béatrice Ménard
« La búsqueda de la dicha en Desde mis poemas de Claudio Rodríguez »Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
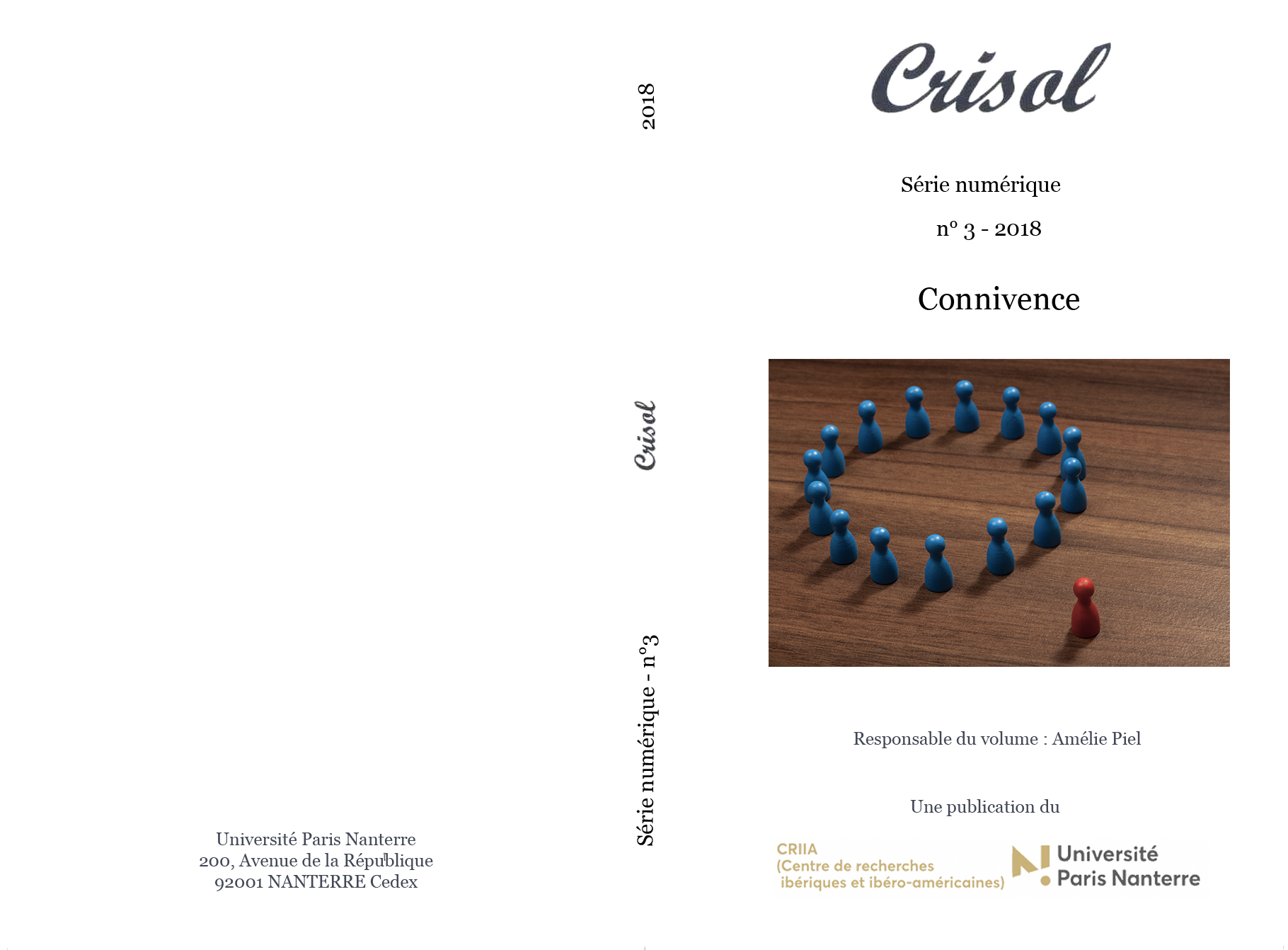 Connivence
No 3 (2018)
Connivence
No 3 (2018)Ce troisième volume de Crisol–série numérique est le fruit d’un travail collectif entrepris il y a plusieurs années à Toulouse lors d’une première journée d’étude organisée par l’IRIEC et prolongé lors d’une seconde journée organisée par le CRIIA de l’Université Paris Nanterre. Ces deux journées intitulées « La notion de connivence est-elle un concept opératoire en linguistique ? » se centraient pour la première sur les jeux de mots et traits d’esprit et la seconde sur l’extension du concept aux autres manifestations langagières. Le présent volume réunit 12 contributions de chercheurs français et espagnols, hispanistes ou spécialistes de littérature française, portant sur des domaines aussi divers que la lexicologie, la pragmatique, la parémiologie, la littérature ou la linguistique du signifiant.
Partant d’une analyse lexicographique du terme « connivence » et de son équivalent espagnol « connivencia », fonctionnant comme un étalon qui permet de mesurer la place qu’occupe ce terme dans les champs de la linguistique et de la didactique, l’ensemble du volume tend à montrer que la connivence est un mécanisme à l’oeuvre dans diverses manifestations langagières (calembour, trait d’esprit, langue de spécialité, mécanismes de censure) mais ne peut se résumer à ces dernières. L’objectif du volume est de déceler la connivence à l’œuvre à plusieurs niveaux d’analyse des manifestations langagières et d’en délimiter la place possible en tant que concept linguistique. Ces différents niveaux structurent le volume puisque les diverses contributions se centreront sur la connivence présente dans l’échange au niveau communicationnel dans un premier moment, au niveau discursif par la suite via l’étude de ses manifestations dans le discours, et enfin au niveau sémantique puisqu’elle apparaît comme un indispensable facteur des évolutions linguistiques observables dans tous les registres de langue. C’est ce concept polymorphe que le présent volume nous invite à observer.
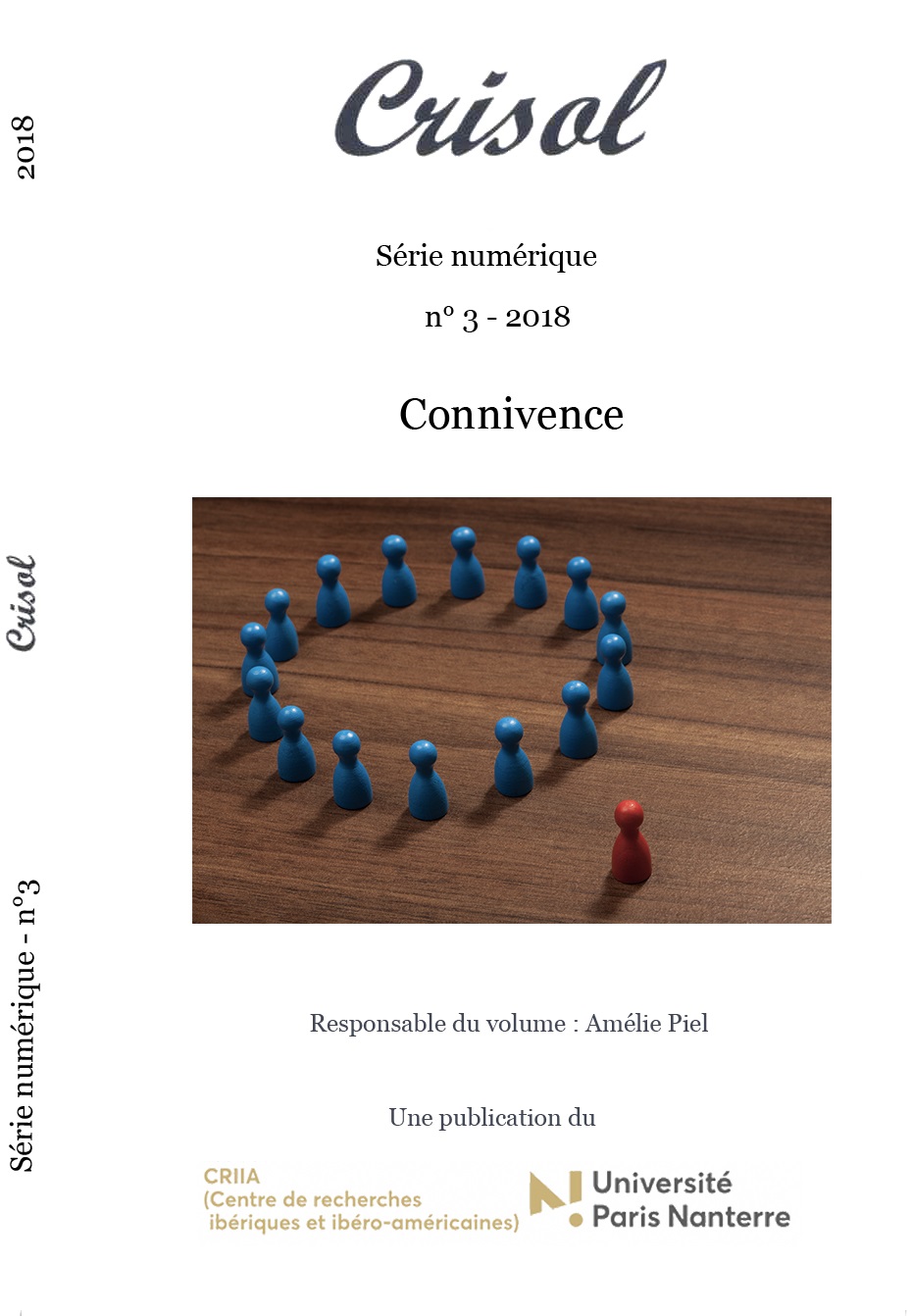
Sommaire
1- Philippe REYNÈS, « Du sens étymologique à l'émergence des acceptions actuelles en contexte d'analyse du discours et de didactique : comparaison lexicographique entre l'espagnol connivencia et le français connivence. »
2- Christophe DUBOIS, « Degrés de connivence avec le lecteur dans les textes mettant en contact plusieurs langues. »
3- Michel CAMPRUBI, « La connivence dans le discours. La « langue de bois » et la connivence. »
4- José PORTOLÉS LÁZARO, « Censura y connivencia. »
5- Isabelle GARNIER, « Un siècle de connivence confessionnelle de Marguerite de Navarre à Agrippa d’Aubigné (1515-1616) : contribution à l’étayage théorique de la notion. »
6- Patrick CHARAUDEAU, « Les eaux troubles de la connivence. »
7- Hélène FRETEL, « Les marqueurs du discours et la notion de « connivence » :
les cas de enfin, car, en fin et pues. »
8- Bernard DARBORD, « La connivence et son lexique. idiosyncrasies linguistiques, stéréotypes et spécificités culturelles. »
9- Antonia LOPEZ, Les proverbes tronqués établissent-ils une connivence d’un point de vue linguistique entre locuteur et récepteur?
10- Alexandra ODDO, « Sens compositionnel et sens formulaire des lexies complexes : de la convention à la connivence. »
11- Amélie PIEL, « Langue, Discours, Compétence du locuteur : à quel niveau d’analyse la connivence devient-elle un concept opérationnel en linguistique ? »
12- Renaud CAZALBOU, « La connivence comme concept opératoire global en linguistique. »Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
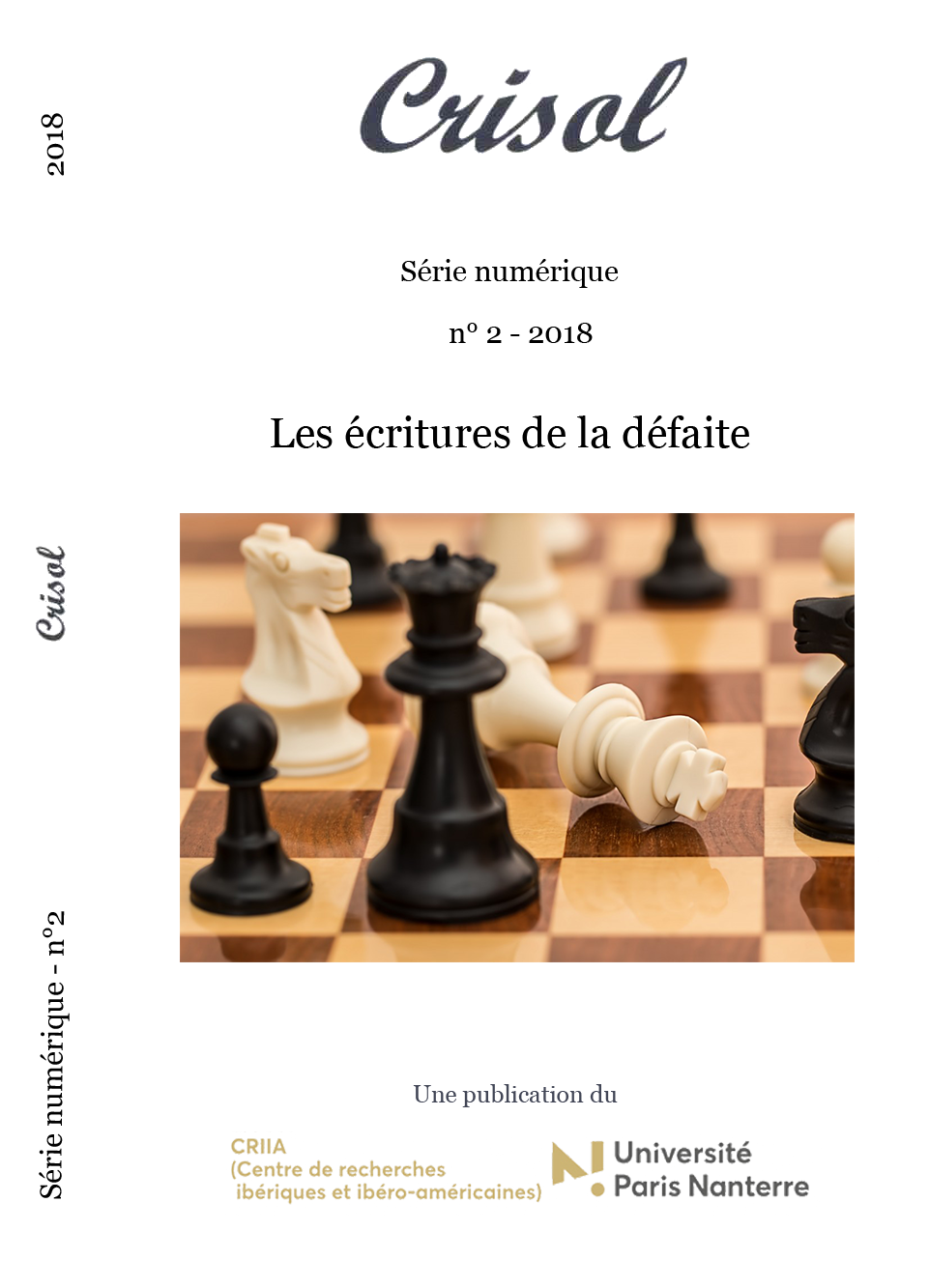 Les écritures de la défaite
No 2 (2018)
Les écritures de la défaite
No 2 (2018)Issu d’une journée d’étude organisée par le Groupe de Recherches en Littérature, Philosophie et Psychanalyse à l’Université Paris Nanterre sur « Les écritures de la défaite », ce volume 2 de Crisol–série numérique réunit 15 contributions de chercheurs français hispanistes et américanistes. Elles portent sur l’Espagne, le Pérou, Cuba, le Chili, le Mexique, la Colombie, l’Argentine et les Philippines. Les réflexions sont menées depuis des corpus, champs théoriques et disciplinaires variés – la peinture, la littérature, la linguistique, l’histoire – et couvrent un laps de temps allant des XVIe au XXIe siècles.
L’objectif est de s’interroger sur la palette thématique et, plus encore, sur les modalités et formes de la mise en écriture textuelle ou en écriture visuelle de la défaite, afin de découvrir et d’analyser ses éventuelles caractéristiques esthétiques (y a-t-il, par exemple, des scénographies propres à la description de la défaite ?), mais aussi, surtout, ses enjeux discursifs – plus ou moins conscients, plus ou moins avoués et plus ou moins assumés. C’est-à-dire qu’à terme, on cherchera à comprendre la façon dont ces récits rétrospectifs générés par / dans l’écriture et par / dans l’image re-représentaient et finalement re-racontaient l’événement malheureux et pourquoi.
Soit pour, à la manière d’une basique catharsis, clore ou aider à clore définitivement une page douloureuse d’une histoire personnelle (parfois autour de circonstances profondément intimes et prégnantes sur le façonnement du « je » – à la manière d’une scène primitive) ou d’une histoire collective. On sait le traumatisme que peut constituer pour un peuple et subséquemment le conditionnement de son imaginaire une déroute et une capitulation militaires ; on pense à l’exemple célèbre du fameux wagon de train où fut signé l’armistice du 11 novembre 1918 entre l'Allemagne, la France et ses alliés, et qui devint pour Hitler et nombre de ses compatriotes un véritable symbole de l’humiliation que les alliés ont, de leur point de vue, infligé à leur pays. Pour effacer cette tache et refermer cette cicatrice, le dirigeant allemand s’empressant non seulement d’y ramener les Français pour signer l’armistice du 22 juin 1940, avant de le faire envoyer en Allemagne pour l’exposer à Berlin, et finalement d’ordonner sa destruction par les SS en avril 1945, un mois avant la capitulation allemande.
Soit pour la resignifier, notamment quand le passage par le filtre et le prisme de la traduction via la ré-appropriation des souvenirs offre une perspective compensatoire dont le traitement, parfois itératif et parfois fort complaisant, peut donner la matière d’une œuvre ponctuelle (un tableau, un roman, une nouvelle, un recueil de nouvelles ou même un journal), voire d’une œuvre complète et en fin de parcours d’une identité d’artiste.
Soit, à l’autre extrême, pour sombrer dans une vraie (parfois clairement maladive) ou fausse dénégation de la réalité, quand la récupération, sous l’apparence de l’exemplarisation par exemple, est principalement destinée à poser les jalons de nouveaux combats – souvent purement symboliques – et qu’il est habile de se présenter sous les traits de telle ou telle figure de vaincu et de victime.
Les écritures de la défaite est organisé en deux parties : écrire la défaite personnelle et écrire la défaite collective.
Caroline Lepage
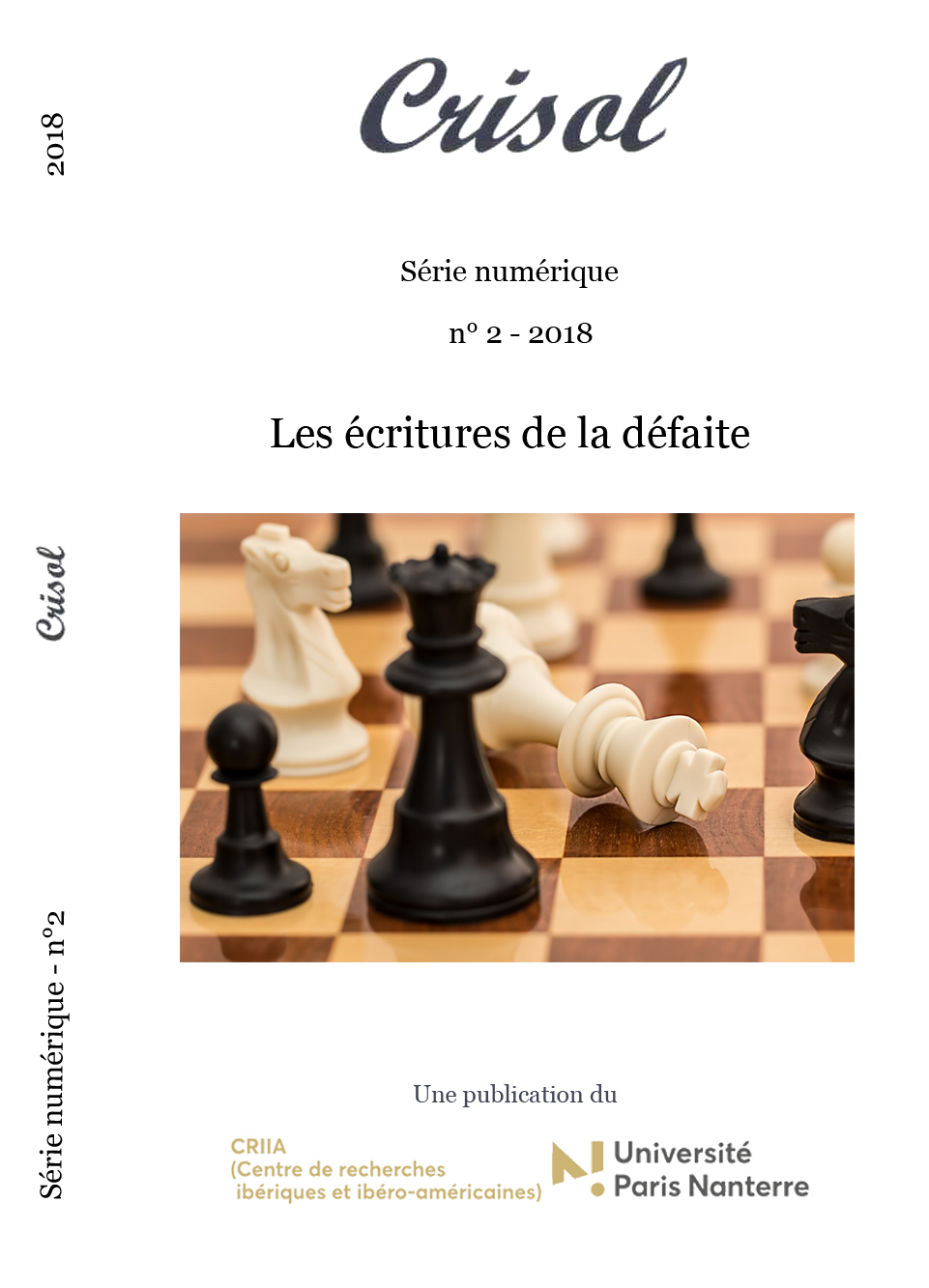
Sommaire
I- Écrire la défaite personnelle
Françoise Aubès, « Los geniecillos dominicales et la thématique de l’échec »
David Barreiro Jiménez, « Le journal intime de Julio Ramon Ribeyro : chronique d’une défaite annoncée »
Cécile Brochard, « Roberto Bolaño “entre les immenses déserts d’ennui et les oasis d’horreur” : l’abîme, un antidote à la défaite ? »
Marie-Madeleine Gladieu, « Défaite et punition littéraire de antihéros vargasllosiens »
Caroline Lepage, « Arrogantes victoires et défaites consenties de Borges : lecture croisée de Ficciones et El hacedor »
Liliana Riaboff, «El artificio de un triunfo sobre una vida de derrotas en Memoria de mis putas tristes»
II- Écrire la défaite collective
- Chloé Gauthier, « L'essai : témoigner la défaite, représenter l'insoutenable réalité mexicaine. Le cas de Cristina Rivera Garza et Sergio González Rodríguez »
Elena Geneau, «Indagación de los destinos: vicisitudes del fracaso en Las Repúblicas de Angélica Gorodischer»
Renée Clémentine Lucien, « Mondes, langages et corps brisés : la défaite de l’ordre colonial dans La ceiba de la memoria, de Roberto Burgos Cantor »
Amélie Piel, « La novlangue dans le discours administratif lié à l’enseignement : écriture de la défaite ou défaite de l’écriture ? »
Nuria Rodríguez Lázaro, « La poésie de l’après-guerre espagnol : la défaite des vaincus et la défaite des vainqueurs »
Hélène Roy, « Les écritures indigènes de la conquête du Pérou : recréation historique et résistance »
Emmanuelle Sinardet, «Allégories de la défaite chez deux peintres philippins : Spoliarium (1884) de Juan Luna et Las vírgenes cristianas expuestas al populacho (1884) de Félix Hidalgo»
Eva Touboul, « Chroniques d’une défaite annoncée ? La guerre civile espagnole racontée par des témoins européens »
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
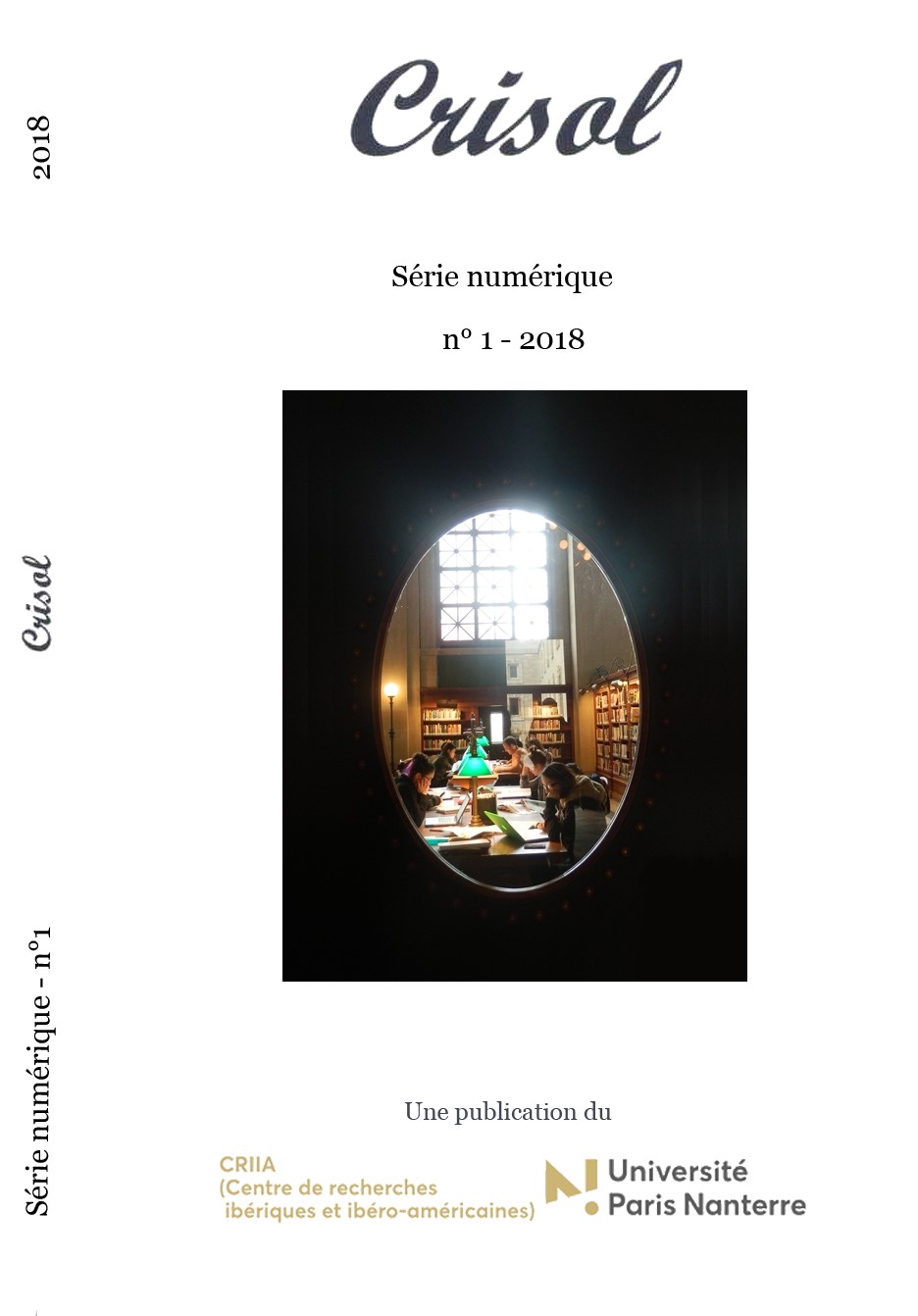 Nuevas perspectivas e investigaciones en la enseñanza del español para uso profesional
No 1 (2018)
Nuevas perspectivas e investigaciones en la enseñanza del español para uso profesional
No 1 (2018)Ce volume, le premier d’une nouvelle série -en ligne- de la revue Crisol, souhaite apporter quelques réponses aux questions posées par l’enseignement d’une langue, l’espagnol, dans un but professionnel. Les 11 contributions réparties en trois chapitres sont le fruit d’un travail de recherche mené dans les domaines de la linguistique et de la didactique, dans lesquels les auteurs adoptent un point de vue à la fois théorique, pratique et pragmatique. En effet, la perspective de la linguistique appliquée, tout en partant d’un aspect concret de la langue en tant que système, essaie, entre autres, d'expliquer la manière dont les traditions discursives propres à l’espagnol trouvent toute leur place dans ce que l’on désigne (de manière trop générale) comme l’espagnol des affaires. Pour sa part, la didactique, qui, la plupart du temps prend comme point de départ l’observation des classes, essaie d’améliorer l’enseignement de la langue, mais également son apprentissage de la part de l’apprenant.
Le lecteur trouvera ici à la fois des réflexions théoriques et des propositions pédagogiques. L’enseignant de langue de spécialité devenu, peut-être par hasard, professeur d’espagnol économique, juridique ou de l’ingénierie, trouvera aussi quelques points de repère qui lui permettront d’avancer dans sa pratique. Ce vaste secteur constitué par l’enseignement de l’espagnol à but professionnel est très hétérogène et très varié car, entre autres, les besoins du public et des institutions sont très larges et, souvent, malheureusement, peu explicites, ce qui rend le travail de l’enseignant davantage complexe, mais en même temps très stimulant.
Ni la linguistique appliquée ni la didactique ne peuvent faire l’impasse sur ce qu’on appelle les langues de spécialité dans leurs différentes déclinaisons : de spécialisation, de divulgation et de vulgarisation. Ni l’une ni l’autre des deux disciplines ne peuvent faire l’économie de se doter des notions théoriques capables de décrire et d’expliquer les genres discursifs, et des instruments méthodologiques pour avancer dans l’exploitation en cours de ces genres, par exemple.
Les articles ici réunis dans une perspective synchronique ont pour objectif d'offrir une vision élargie et novatrice de l’enseignement de l’espagnol langue étrangère dans un contexte professionnel.
Mercé Pujol.
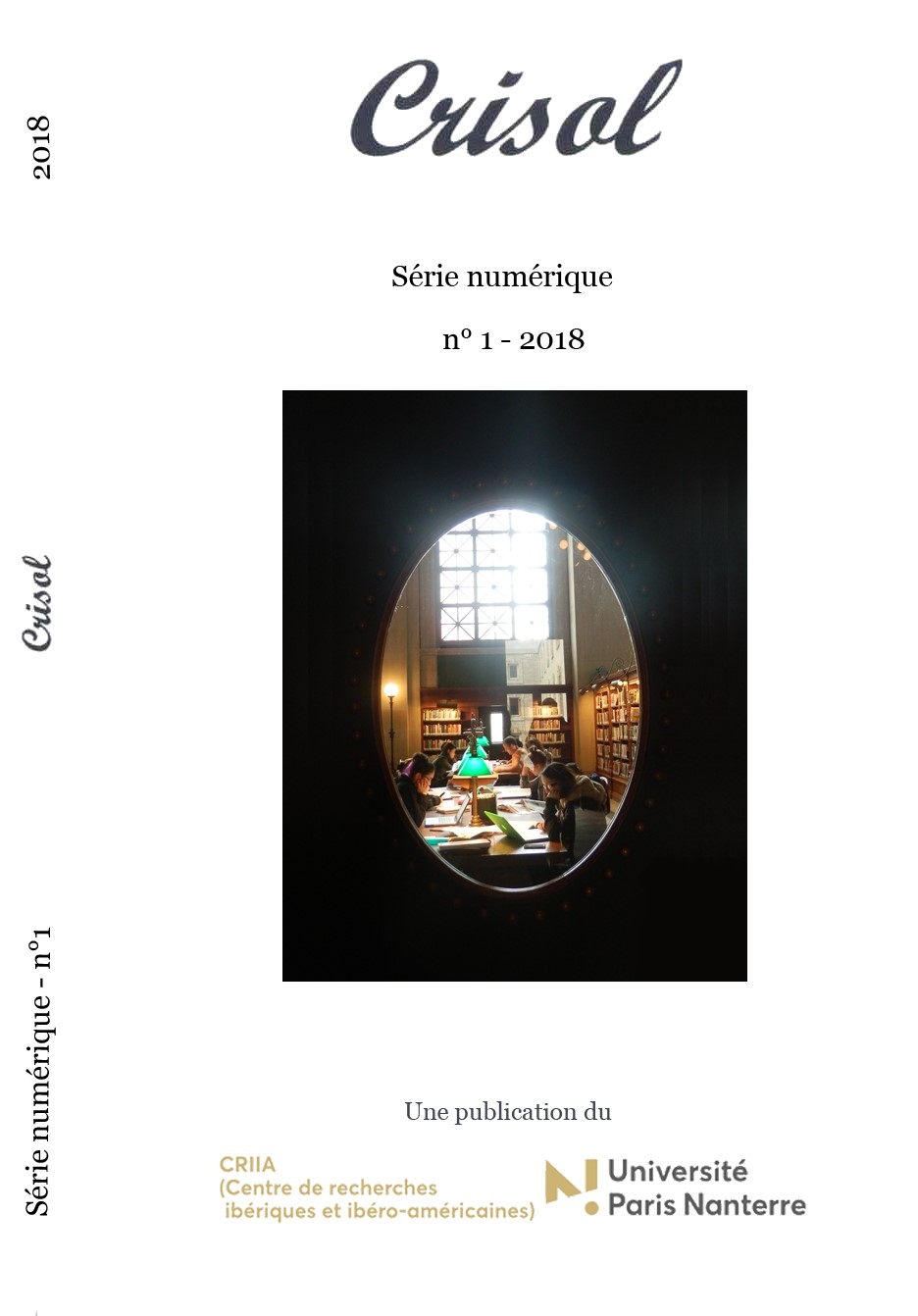
Mentions légales
Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190
Directrice de la publication : Caroline Lepage
200 avenue de la République
92000 Nanterre
c.lepage@parisnanterre.fr
-
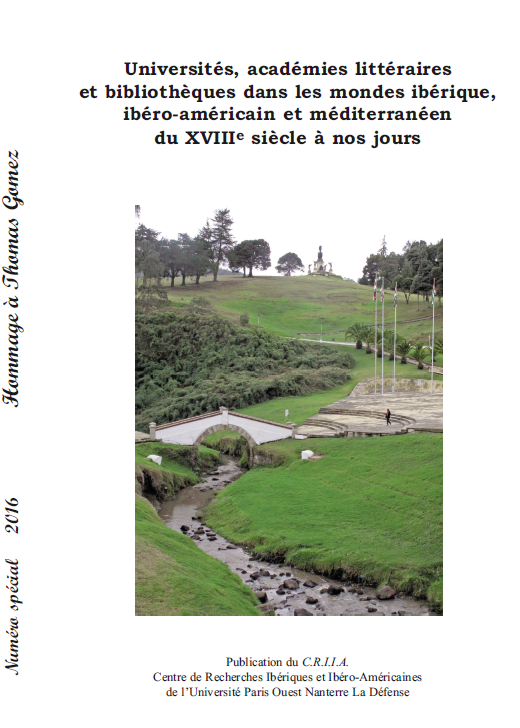 Crisol : numéro spécial en hommage à Thomas Gomez - Universités, académies littéraires et bibliothèques dans les mondes ibérique, ibéro-américain et méditerranéen du XVIIIe siècle à nos jours
No spécial (2016)
Crisol : numéro spécial en hommage à Thomas Gomez - Universités, académies littéraires et bibliothèques dans les mondes ibérique, ibéro-américain et méditerranéen du XVIIIe siècle à nos jours
No spécial (2016)Dans la première édition de L’invention de l’Amérique. Mythes et réalités de la Conquête (1992) qui ouvrit de nouveaux horizons et vivifia la recherche américaniste, dans le sillage d’un « marin connaisseur d’archives, expert en matière d’aventure américaine (intellectuelle et vécue) » ainsi que Jeanne Chenu définissait l’auteur de l’ouvrage dans le compte rendu qu’elle en fit alors, Thomas Gomez écrivait :
Ce livre doit beaucoup – tout devrais-je dire – aux maîtres de l’américanisme. Ils sont trop nombreux pour être cités tous et je ne voudrais porter ombrage à aucun d’eux en commettant quelque oubli. Cependant, ce que je dois à John H. Parry, Francisco Morales Padrón, Sergio Villalobos, Irving A. Leonard, Charles Verlinden, Pierre Chaunu et quelques autres, est trop important pour être passé sous silence. Mes anciens professeurs Jean-Pierre Berthe, Georges Baudot et Bartolomé Bennassar y trouveront aussi leur empreinte.
La curiosité de mes étudiants – ceux de première année comme ceux de l’université Inter-Âges – pendant le temps où j’ai moi-même enseigné à la Sorbonne m’a beaucoup stimulé dans la réalisation de cet ouvrage. Celui-ci n’a d’autre ambition que de répondre à certaines de leurs interrogations et de les aider à s’initier à la passionnante histoire de l’Amérique. Il voudrait aussi faire découvrir cette dernière à un vaste public à travers des aspects parfois insolites ou mal connus et grâce à un récit accessible à tous.Amour de la connaissance, goût de l’histoire, passion de la recherche qui ne l’a jamais éloigné de l’enseignement, à tous les niveaux et envers tous les publics, conscience de cette chaîne que constitue la transmission des savoirs et les indispensables maillons que sont les hommes qui en ont la charge.
Donnant corps à cette démarche, le 12 octobre 2001, Thomas Gomez a créé le GRECUN – Groupe École Culture, Nation dans le monde ibérique, ibéro-américain et méditerranéen – en tant qu’axe de recherche au sein du Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université de Paris Ouest Nanterre. Ce groupe, qui a réuni plusieurs dizaines de chercheurs provenant de différents domaines des sciences humaines, a développé une réflexion et des activités scientifiques autour de l’École primaire et secondaire, comme matrice possible de la Nation. De la fécondité de cette problématique qui déborde largement le cadre de l’Amérique ibérique témoignent les deux forts volumes publiés en 2005 et 2011 sous le titre École, culture et nation.
C’est dans la perspective de prolonger les travaux du GRECUN qu’une réflexion sur l’accumulation, la transmission, la récupération et la sauvegarde des savoirs par l’institution universitaire, par des groupements ou des associations – pistes moins explorées par les chercheurs jusqu’à maintenant – a été retenue pour rendre hommage au Professeur Thomas Gomez. Les 16 et 17 octobre 2014 s’est ainsi tenu à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense un colloque international intitulé Universités, académies littéraires et bibliothèques dans les mondes ibérique, ibéro-américain et méditerranéen du XVIIIe siècle à nos jours, organisé par le Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines (EA 369), sous la responsabilité de Catherine Heymann, Nathalie Jammet-Arias et Alvar de La Llosa, avec le soutien de l’UFR de Langues et Civilisations Étrangères et du Service des Relations Internationales. Le présent volume réunit l’ensemble des communications de ce colloque, enrichi de plusieurs contributions d’enseignants-chercheurs, désireux de témoigner leur amitié à Thomas Gomez.Reflet des échanges des deux côtés de l’océan Atlantique et de la circulation des savoirs ainsi que des circuits qui les permettent, l’introduction à l’ouvrage offre une magistrale synthèse sur le rôle de l’écrit et de l’imprimé dans la construction de l’espace culturel français en Amérique du Sud (J.Y. Mollier). S’y trouvent détaillées les spécificités de la France par rapport aux autres nations européennes, en particulier les activités éditoriales au XIXe siècle, époque où Paris se transforme en un véritable « carrefour des langues et des cultures ».
Les rapports, très fluctuants, entre le savoir et le pouvoir ou les savoirs et les pouvoirs font l’objet des trois premières études. Centre de rayonnement culturel à l’époque nasride, Grenade, qui à l’aube du xvie siècle connut une traversée du désert avant de se voir dotée d’une université, se transforma au fil du temps. Elle constitue un cas unique dans l’histoire de l’Espagne qui permet de dresser l’évolution des liens entre culture et politique sur une période longue (C. Gaignard). Les deux autres articles ont trait au domaine de prédilection de Thomas Gomez : la Nouvelle-Grenade. Ils dessinent les contours des interactions entre les individus et les contextes culturel, social, économique et politique. Dans le premier cas, il s’agit de mesurer le cheminement contrasté, dans l’espace et dans le temps, des nouveaux savoirs et des acteurs qui les portèrent dans la période qui précéda de peu les premières manifestations de résistance au pouvoir colonial mais aussi de rendre compte de la dimension « militante » de ce combat pour la science (J. Chenu). Dans le second cas, à travers l’évocation de la traduction/interprétation en espagnol par Antonio Nariño d’un texte dont la circulation était interdite dans les vice-royautés espagnoles – la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen – et à travers l’analyse de la défense qu’en fit le grand érudit néo-grenadin lors des poursuites pénales qui s’ensuivirent, il est donné au lecteur d’apprécier la portée d’un document essentiel dans la formation d’une identité créole (J.E. González).
La seconde section a trait aux rapports entre l’École – envisagée dans ses différents degrés – et l’État. Il s’agit d’analyser plus particulièrement les choix idéologiques et politiques dans lesquels le système éducatif s’est trouvé impliqué à l’époque de la construction ou de la consolidation des États-nations en Amérique espagnole. Tel fut le cas de la fondation de l’Université du Chili, dont le premier recteur fut le Vénézuélien Andrés Bello, illustre figure des lettres américaines. Dans son discours d’inauguration en novembre 1843, il soulignait l’importance de la construction des savoirs et de la supervision de l’enseignement primaire, insistant sur le lien entre université et société. L’analyse détaillée du contenu des Anales de la Universidad de Chile fournit nombre de renseignements sur les fonctions assignées à l’Université, son fonctionnement et sa production (N. Jammet-Arias). Un autre exemple est celui de l’Équateur avec la réouverture de l’Université Centrale par le régime progressiste (1883-1895), ambitieux projet de modernisation fondé sur l’amélioration des conditions matérielles de l’Université et la priorité donnée à l’enseignement scientifique et technique, en particulier en Agronomie. Cet élan modernisateur s’inscrit plus largement dans le projet de construction nationale visant à permettre une meilleure insertion du pays sur le marché international, en profitant de l’essor des exportations de cacao (A. Medina). L’Équateur encore avec l’apparition, en 1901, des « jardins d’enfants », réalisés grâce aux efforts de Luis Vicente Torre. L’introduction de ce modèle éducatif par un prêtre équatorien, en pleine Révolution libérale, permet de mieux cerner les relations qui se mirent en place entre l’État et l’Église à partir de 1895, période à partir de laquelle s’opéra la sécularisation des structures de l’État (E. Sinardet). D’« apôtres laïcs » du régime libéral, il est aussi question dans la Bolivie du début du XXe siècle qui s’employa, non sans rencontrer des difficultés et des résistances, à constituer, organiser et étatiser un corps enseignant professionnalisé avec la création d’instituts spécialisés, sur le modèle des Écoles normales européennes (F. Martinez). Enfin, pour l’époque contemporaine, une comparaison entre la Colombie et l’Espagne montre que ces deux pays, en dépit de différences notables, partagent des problématiques notamment sur les effets des politiques économiques, actuellement appliquées dans ces deux pays. Dans un contexte d’économie de marché et de la connaissance, les conséquences de ces politiques s’avèrent néfastes pour le service public en général et pour les systèmes éducatifs de ces nations en particulier (S. Ospina et M. Pujol).
La troisième section s’intéresse aux formes, aux acteurs et aux vecteurs de la transmission et de la diffusion de la culture en Espagne et au Mexique. Un article offre une synthèse des principaux éléments qui permettent de mieux comprendre comment le franquisme a utilisé l’enseignement de l’histoire pour légitimer et, ce faisant, consolider son pouvoir, lors de ses premières années d’existence : transformation du cadre et du système éducatif, élaboration de mythes servant à renforcer l’image et l’identité du régime, intégration de nouveaux professeurs d’histoire à l’Université, qui devaient suivre, ou feindre de suivre, les principes du régime (A. Román Antequera). Celui qui fut maire de Madrid de 1979 à 1986, Enrique Tierno Galván, fait l’objet d’une polémique qui renvoie à une période de la vie de cette figure emblématique de la Movida : celle où il était professeur de Droit politique à l’Université de Murcie, de 1948 à 1953. L’analyse met en évidence l’intérêt qu’il y aurait à envisager son autobiographie comme un « objet de discussion herméneutique » et un exercice rhétorique d’auto-mythification, réussi, par l’une des figures les plus populaires du franquisme tardif et de la Transition (J. Céspedes).
Le contrôle de la production et la diffusion de la connaissance, de la culture et l’instrumentalisation de l’histoire ne sont pas moindres dans le monde hispano-américain, en l’occurrence au Mexique. C’est ce qui ressort de la comparaison de deux institutions au XIXe siècle : une société savante et un établissement d’enseignement supérieur créé en 1781. Les recoupements entre les élites politiques, scientifiques et artistiques, ainsi que la vision de l’histoire mexicaine présentée par ces institutions et, dans le cas de l’Académie de San Carlos, la réception des propositions, sont ainsi mis en valeur (M. Lecouvey). Plus près de nous, l’introduction de nouveaux programmes scolaires en 1992 et la rédaction de nouveaux manuels d’histoire (1972-1989), confiée à un groupe d’édition privé, ont enflammé les esprits, mettant au cœur du débat l’écriture de l’histoire nationale. Faisant partie d’une nouvelle politique éducative, l’histoire du Mexique y était, en effet, construite au prisme des nouveaux enjeux du monde contemporain et de la doxa de l’économie libérale (D. Chine Lehmann).
Face à cette annexion de l’histoire par les pouvoirs officiels, des résistances et des contre-pouvoirs ont toujours existé. Ils font l’objet d’une quatrième section. Ainsi, en Colombie, en 1939, l’activiste nasa Manuel Quintín Lame rédigea-t-il Los pensamientos del Indio que se educó en las selvas colombianas dans lequel à travers un travail de recomposition historique il proclamait son droit à l’autoreprésentation et revendiquait la légitimité des luttes indigènes pour le territoire. Outre la remise en cause du projet national civilisateur des élites républicaines et du rôle des institutions chargées de sa diffusion, le texte de Lame engage aussi un processus de décolonisation épistémique (Ph. Colin). L’histoire de la Catalogne au XXe siècle, étudiée à travers l’existence d’associations privées et d’institutions officielles (ou clandestines dans les périodes de dictature de l’État espagnol) à finalité culturelle et à vocation éducative, l’analyse de leurs actions, de leur rôle et de leurs avatars sont un exemple de la permanence des résistances, notamment linguistiques (M. Camprubí). Toujours en Espagne, un regain d’intérêt pour les Missions pédagogiques de la Seconde République s’est manifesté, au début du XXIe siècle, à travers des documentaires, des expositions et des programmes radiophoniques. Il faut y ajouter, plus récemment, l’écriture de fictions (El club de la memoria et Todo lo que se llevó el diablo) qui revisitent cette aventure emblématique de la politique scolaire du premier bienio et veulent faire œuvre de pédagogie sociale dans l’Espagne contemporaine (Z. Carandell).
Une cinquième section est consacrée plus particulièrement à l’écrit, au livre et aux bibliothèques, tous termes chers à l’homme d’archives par excellence, à l’auteur de fictions et au directeur de collection que fut Thomas Gomez. Une enquête judiciaire réalisée en 2006 a révélé au grand public l’existence de plusieurs bibliothèques dans des lieux institutionnels ou dans des demeures personnelles appartenant au général Pinochet. Le questionnement sur l’origine, la nature et la quantité de livres réunis, parmi lesquels des ouvrages d’une grande valeur bibliographique – ce qui leur confère aujourd’hui un indiscutable intérêt économique – et l’étude des modes de financement éclairent d’un jour inédit la personnalité du général chilien (A. de la Llosa). Après avoir réalisé un état des lieux des initiatives éditoriales et du bilan des politiques culturelles (promotion du livre et de la lecture en particulier) dans le Chili post-dictatorial, l’analyse des discours qui les sous-tendaient permet de mesurer la portée et les limites de leur apport à la reconstruction démocratique du pays (S. Decante).
Comme en miroir à l’évocation initiale de la présence française en Amérique latine depuis le XIXe siècle, ce premier ensemble se ferme sur un très suggestif panorama du fonds bibliographique latino-américain (livres et manuscrits) de la Bibliothèque nationale de France depuis 1875 (année de l’entrée en vigueur d’une nouvelle classification) jusqu’au Boom de la seconde moitié du XXe siècle (F. Rodríguez López).Un second ensemble, organisé autour de deux thématiques, complète cet hommage. La première Espaces et cultures articule politique et culture appréhendées à travers l’évocation de figures littéraires, de pratiques associatives et de représentations historiques dans les mondes hispanique, hispano-américain et méditerranéen.
Trois contributions rendent compte du complexe processus d’adaptation des modèles européens aux réalités hispano-américaines. C’est ce que montre l’étude de la première génération d’intellectuels et, en particulier, des idéologues du Salon Littéraire de 1837, dans les premières décennies qui suivent l’indépendance du Río de la Plata. Les enjeux de l’époque sont alors la construction d’une nation, la lutte contre la dictature de Juan Manuel Rosas et le sentiment de l’urgence qu’il y avait à forger l’indépendance esthétique du pays (A. Gasquet). À la même période à Cuba, dans ce qui demeurait une possession de l’empire espagnol, une figure littéraire cristallisait tout à la fois les craintes et les préjugés d’une époque mais aussi les rêves et les idéaux d’une élite intellectuelle qui luttait pour la libération des Antilles : celle du poète mulâtre, Gabriel Concepción Valdés, dont la critique très contrastée de l’œuvre poétique et de la vie fournit un riche matériau pour l’étude des imaginaires antillais (M. Guicharnaud Tollis). Un autre exemple de la circulation des savoirs et des techniques en même temps qu’un indice de la vitalité des utopies (et de la difficulté à les adapter) est donné par le Brésil esclavagiste du XIXe siècle. Constituant un terrain fertile pour le débat d’idées en raison de l’existence d’un important réseau associatif, le Pernambouc vit, au milieu du siècle, la publication de O Progresso, une revue sociale, littéraire et scientifique, d’inspiration fouriériste qui occupe une place singulière dans l’histoire de la presse brésilienne, voire même latino-américaine (Cl. Poncioni).
De l’importance de l’existence de réseaux et d’espaces de sociabilités pour comprendre la réalité sociale, l’étude de la franc-maçonnerie à Cuba, en tant qu’élément constitutif de ce maillage vers lequel convergeaient les élites havanaises, et plus globalement cubaines, fournit une série d’éléments suggestifs. Ainsi les liens de l’espace maçonnique avec d’autres réseaux, notamment celui qui se développa autour de la construction du chemin de fer dont l’influence fut décisive pour la consolidation institutionnelle de la franc-maçonnerie dans la capitale cubaine, en offrent-ils un exemple probant (D. Soucy).
Deux articles témoignent de l’intérêt des regards croisés. Dans la perspective d’approfondir l’examen des représentations ayant trait au lien colonial qui a uni Philippins et Espagnols pendant trois siècles, et de mieux comprendre le processus de récupération du legs historique, le recours à des sources, peu sollicitées, est ainsi examiné. Il s’agit de s’intéresser, autant que la documentation le permet, au regard que les Philippins, installés en Espagne ou restés dans l’archipel, portaient sur les Espagnols qui vivaient dans les îles et plus largement sur la société péninsulaire de la seconde moitié du XIXe siècle (H. Goujat). Autre regard croisé faisant l’objet d’une analyse est celui que porte le poète cubain, Nicolás Guillén, sur la Caraïbe insulaire et continentale, au XXe siècle, témoignant de sa capacité à cerner l’espace-temps du continent latino-américain et à envisager les formes et les limites de son intégration (Y. Thiao).
Ancrées dans le monde contemporain, deux études analysent l’impact du monde médiatique, l’une sur le monde politique et l’autre sur le monde sportif et conduisent à un questionnement sur l’histoire, la mémoire et l’identité. L’évocation à travers la presse française et espagnole de l’itinéraire de Federica Montseny, militante anarchiste, importante figure de l’histoire espagnole de la Seconde République, morte “oubliée” en 1994, fait apparaître, en France, les ambiguïtés du discours sur la violence et en Espagne, l’effacement de pans entiers de l’histoire récente lors de la Transition (M.C. Chaput). Désignant un système défensif très rigoureux, le catenaccio (verrou ou cadenas en italien) connote une attitude mentale identitaire, migrée des schémas tactiques du football, dans la société italienne de l’après-guerre jusqu’à la fin de la Première République des années 1990. À partir de cette métaphore, il s’agit de retracer l’impact de la mentalité footballistique et de son fonctionnement médiatique en Italie, à travers le débat sportif, intellectuel et politique (G. Gargiulo).La seconde thématique porte sur Terres et productions. Une première contribution évoque le conflit social, opposant les titulaires du domaine direct et ceux du domaine utile pour la possession des terres, qui secoua le Nord et le Nord-Ouest de l’Espagne, dès la fin du XVIIe siècle et principalement durant les décennies centrales du XVIIIe siècle (P. Luna).
Les trois autres contributions ont trait, chacune, à l’utilisation et aux formes économiques et sociales de l’exploitation de certaines matières premières américaines du XVIe siècle au début du XXe. Les savoirs médicinaux européens furent ainsi confrontés à l’apparition de nouveaux remèdes d’origine américaine, à de nouvelles maladies et de nouvelles thérapeutiques. L’analyse des pratiques retracées dans les différents discours et traités des médecins d’Europe occidentale entre 1510 et 1580 fait apparaître des variations dans la réception et le degré d’incorporation selon les lieux d’expérimentation et l’expérience qu’en avaient les “médiateurs” (L. Bénat Tachot). Si l’insubordination d’esclaves fut toujours une source de tracas pour les propriétaires de plantations cacaoyères, les soulèvements à proprement parler semblent avoir été relativement rares au cours de la période qui suivit l’Indépendance, ce qui rend particulièrement significative l’analyse de deux révoltes, respectivement en 1837 et 1845, qui eurent lieu dans la région d’Ocumare de la Costa (Venezuela). Elles éclairent d’un jour nouveau le type très particulier du lien entre maîtres et esclaves dans le contexte de la production de cacao de l’après-Indépendance (N. Harwich). Si des politiques d’exploration et de colonisation de la Selva furent conduites dans le Pérou républicain dès les années 1840, ce fut l’explosion de la demande du caoutchouc qui permit à l’Oriente d’acquérir une visibilité nationale et internationale. La leyenda del caucho (1906) du Liménien Carlos Amézaga consacra la réalité du nouvel espace économique, le choix du mode épique soulignant le rôle de nouvel Eldorado assigné à la région nord-orientale dans l’imaginaire collectif (C. Heymann).Puisse cet ensemble d’articles refléter le respect de la communauté scientifique pour le travail de l’historien, les vertus du pédagogue, le talent de l’auteur et le brio de l’homme de conviction que fut Thomas Gomez.
Catherine HEYMANN
Nathalie JAMMET-ARIAS
Alvar de la LLOSASOMMAIRE
Alvar DE LA LLOSA et Itamar OLIVARES – Hommage
Catherine HEYMANN, Nathalie JAMMET-ARIAS et Alvar DE LA LLOSA – Présentation
Jean-Yves MOLLIER – Le rôle du livre et de l’imprimé dans la construction de l’espace culturel français en Amérique du sud
Savoirs et pouvoirs
Catherine GAIGNARD – La diffusion du savoir à Grenade, du règne de Charles Quint à l'avènement des Bourbons
Jeanne CHENU – Savoir et pouvoir en Nouvelle-Grenade (1760-1810) : une passion insatisfaite
Jorge E. GONZÁLEZ – La interpretación de Antonio Nariño sobre Los derechos del hombre y del ciudadano en los inicios de la emancipación de la Nueva Granada
École et État
Nathalie JAMMET-ARIAS – L'Université du Chili pendant le rectorat d'Andrés Bello (1842-1865) : un appareil idéologique de l’État chilien…
Alexis MEDINA – «Saldrá de esta Universidad una juventud honrada, inteligente y laboriosa» : le projet de modernisation de l’Université Centrale de l’Équateur pendant la période progressiste (1883-1895)
Emmanuelle SINARDET – L’introduction de la pensée fröbelienne en Équateur (1900-1908) : Révolution pédagogique et révolution libérale
Françoise MARTINEZ – Enseigner à enseigner : une histoire des « Écoles Normales » et de la formation enseignante en Bolivie
Mercè PUJOL et Santiago OSPINA – Globalización y transformación de la Universidad. Miradas cruzadas España-Colombia
Formes, acteurs et vecteurs de la transmission
Alejandro Román ANTEQUERA – L'enseignement de l'histoire dans les premières années du franquisme
Jaime CÉSPEDES – Enrique Tierno Galván en la Universidad de Murcia (1948-1953)
Marie LECOUVEY – Servir la nation, pas le gouvernement ? La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística et la Academia de San Carlos entre 1849 et 1876
Dalila CHINE LEHMANN – Quand les « spécialistes » mexicains s’emparent de l’Histoire : élaboration des manuels scolaires et enjeux nationaux
Résistances
Philippe COLIN – Territoire, mémoire et décolonisation des savoirs dans Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas de Manuel Quintín Lame
Zoraida CARANDELL – Les Missions Pédagogiques, du récit d’hier au roman espagnol d’aujourd’hui : transmettre et repenser l’héritage culturel républicain
Michel CAMPRUBI – Le cas catalan : associations et institutions de sauvegarde et récupération de la langue du pays (XXe siècle)
De l'usage des livres et des bibliothèques
Alvar DE LA LLOSA – De la Biblioteca a la Academia, o formación y uso de la biblioteca no tan secreta de un « augusto » general chileno que pretendía ser experto en Geopolítica 247 C1-2 Stéphanie Decante – Del Fondo del Libro a la Furia del Libro: de la función asignada al papel desempeñado (1989-2015)
Fabiola RODRÍGUEZ LÓPEZ – Presencia de la literatura latinoamericana en la Biblioteca nacional de Francia. Breve visión de conjunto de 1875 hasta el Boom
Varia
Espaces et cultures
Axel GASQUET – El pensamiento ilustrado y el romanticismo en el Río de la Plata: modernidad y vanguardia estética en el Salón Literario de 1837
Michèle GUICHARNAUD-TOLLIS – La invención de América: el poeta cubano Plácido en los imaginarios antillanos
Claude PONCIONI et Georges ORSONI – Fourier sous les tropiques : la revue O Progresso dans le Pernambouc du XIXe siècle
Dominique SOUCY – Logias sobre raíles. El impacto del ferrocarril en la disputa por la hegemonía masónica en la isla de Cuba (1850-1880)
Hélène GOUJAT – El desencuentro colonial entre españoles y filipinos en la segunda mitad del siglo XIX: entre realidad y representación
Yopane THIAO – La Caraïbe à travers les écrits de Nicolás Guillén
Marie-Claude CHAPUT – Federica Montseny (1905-1994) : vers la fin d’un oubli ?
Gius GARGIULO – Défendre le score. Vivre et raconter le foot comme tragédie
Terres et productions
Pablo LUNA – Terre et droit en Galice au milieu du XVIIIe siècle : entre le « manifiesto legal » et la « natural razón »
Louise BÉNAT-TACHOT – Entre tradición y experiencia: la emergencia del saber americano en la farmacopea europea
Nikita HARWICH – Tumulte dans la cacaoyère : révoltes d’esclaves à Ocumare de la Costa (Venezuela), 1837 et 1845
Catherine HEYMANN – Oriente péruvien et construction nationale dans La leyenda del caucho de Carlos Amézaga
-
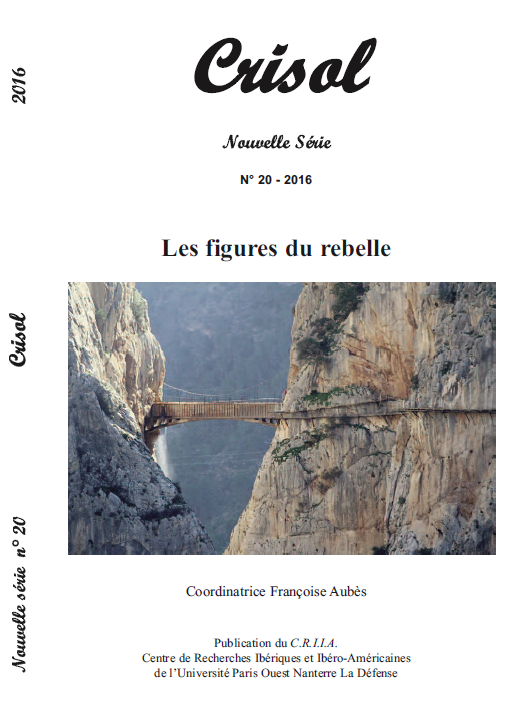 Crisol : Les figures du rebelle
No 20 (2016)
Crisol : Les figures du rebelle
No 20 (2016)Le numéro 20 de la revue Crisol, intitulé Les figures du rebelle, est un volume collectif qui rassemble les contributions des trois groupes de recherche de l’EA 369 Études romanes – le CRIIA, le CRIX et le CRILUS. Le choix de ce thème nous a semblé fédérateur car le rebelle – « celui qui déclenche la guerre », « qui relève la tête », « qui refuse de s’humilier », est une figure très représentative des pays issus de la romanité, socle fondateur de cultures qui peu à peu forgeront leur identité propre. Dès la conquête romaine, il y a une Hispania, qui résiste, et de nombreuses Numance jalonneront l’histoire de ces rébellions contre l’Empire. Rétrospectivement on constate que l’aire romane a fomenté des formes de résistance sui generis, rebelle, rebelde, ribelli…, au XIXe siècle, chemises rouges de Garibaldi, guérillas contre les troupes napoléoniennes, lesquelles deviendront ce type de guerre révolutionnaire qui embrasera l’Amérique latine. Avant même la Révolution russe, la Révolution mexicaine deviendra le paradigme en la matière jusqu’à ce que l’autre Révolution, la Cubaine lui succède.
On se rebelle contre tout pouvoir coercitif, politique, culturel, économique, religieux. On lutte contre le grand propriétaire terrien, contre le maître esclavagiste, dans le palenque ou quilombo, contre les différents régimes autoritaires – fascisme, franquisme, salazarisme – ou simplement contre les institutions d’un pays, d’une république dans laquelle un groupe humain, un clan, ne se reconnaît pas. Il s’agira de rébellion souvent menée par un chef charismatique qui précipitera la fin d’une société par la lutte clandestine, la guérilla, et annoncera un nouvel ordre révolutionnaire ; s’il triomphe, le rebelle entrera dans l’Histoire. Mais le héros vaincu sera oublié.
La constitution d’États Nations au XIXe siècle en Europe, mais aussi en Amérique Latine – quand le Brésil devient une République – réactivera des formes de résistances ancestrales : banditisme, bandes armés, sicarios dans les sociétés gangrénées par la drogue.
Les différentes contributions de cette nouvelle livraison de la revue CRISOL proposent ainsi une lecture des nombreuses et très variées figures iconiques que l’aire romane n’a cessé de secréter : guérilleros, milicianos, pasionarias, soldaderas, jusqu’aux Indignados qui depuis la Plaza Mayor de Madrid ont essaimé la contestation, à l’origine d’un vaste mouvement de protestation en Europe et aux Etats-Unis contre « l’horreur économique » que signifient les brutales politiques néolibérales du XXIe siècle et l’échec de la social-démocratie.
Dans la première partie « Le rebelle entre dans l’Histoire», les contributions s’interrogent sur la façon dont celui qui prend les armes contre l’envahisseur, qui conteste un pouvoir despotique, entre un jour dans l’Histoire, récupéré, iconisé, grandiose symbole identitaire, souvent redécouvert au gré des régimes politiques en cours. Il peut aussi tout en demeurant une figure « anonyme» aux yeux de l’Histoire officielle, être revendiqué par la mémoire collective, populaire. L’image du rebelle est médiatisée, réinterprétée, relayée, perpétuée par la littérature, la statuaire, la peinture, les arts visuels.
En ouverture de cette première partie, la communication de Bernard Darbord et de César Garcia de Lucas, consacrée à l’infant don Juan Manuel, auteur du Conde Lucanor rappelle combien de tout temps la figure du Monarque, doté d’un pouvoir absolu suscite chez le vassal, l’effroi, mais pousse aussi à la rébellion. Amélie Djondo s’intéresse au personnage de la reine rebelle dans la comedia du Siècle d‘Or ; directement inspirée des grandes reines de l’Histoire antique et moderne, entre regina justa et regina horrens, celle-ci s’insurge contre un rôle prédéfini.
Les communications suivantes questionnent la fabrique de l’Histoire. Marie Lecouvey analyse deux figures historiques mexicaines, Emiliano Zapata et Cuauhtémoc. L’une et l’autre incarnent la rébellion – Cuauhtémoc, martyr sacrifié par les Conquistadores et Zapata le héros révolutionnaire ; mais l’une et l’autre, dans la statuaire, dans l’iconographie, dans le discours identitaire, dans la célébration, seront différemment traitées. La figure de Zapata fluctue au gré de la Révolution officielle, celle du PRI qui l’aseptise et lui préfère comme accessoire l’épi de maïs au fusil… alors que l’ELNZ du subcomandante Marcos en 1994 revendique l’homme en armes. Étrangement, Cuauhtémoc le dernier empereur aztèque semble avoir une destinée ambiguë. En tant que héros national, il ne semble pas être revendiqué comme une figure de rébellion du peuple mexicain, la filiation identitaire restant au niveau de l’histoire officielle, difficile. La figure du rebelle oubliée délibérément par l’Histoire sous un régime autoritaire, peut retrouver son statut de personnage historique, enfin reconnu, quand revient la démocratie ; c’est le cas en Équateur de Luis Vargas Torres dans la communication d’Alexis Medina ; dirigeant libéral, il sera exécuté en 1887 sous le gouvernement autoritaire de Caamaño ; et c’est après le triomphe de la révolution libérale de 1895 que commencera la réhabilitation de celui qui depuis 2012 est devenu un « héros national ». José Carlos Janela Antunes retrace l’étonnante biographie d’Henrique Galvão (1895-1970), qui symbolise au Portugal le combat contre Salazar, mais aussi contre tous totalitarismes ; il sera d’ailleurs décoré à titre posthume par le président Mário Soares en 1991. Citons encore le cas du charismatique jeune communiste équatorien, Milton Reyes, opposant au régime de J. M. Velasco Ibarra et exécuté en 1970 ; sa fille, Natacha Reyes Salazar, tente de réhabiliter son souvenir dans un livre autobiographique, Los 60’s sin Rock (2011) qui est également un plaidoyer afin que la mort de son père soit reconnue comme un crime politique, comme on peut le lire dans la communication de Diana Sarrade Cobos. Mais qui mieux que Puig Antich pour incarner la figure du jeune rebelle, militant politique exécuté en 1975 ? Canela Llecha Llop, à partir du film Salvador de Manuel Huerga (2006), démontre comment la figure canonique, qui cristallise un passage charnière, celui de la fin du franquisme à l’avènement de la démocratie, devient dans le film une icône mercantilisable, qui ressortit davantage du mauvais garçon et du bandit ; c’est une figure hypersémantisée, car elle réunit sur sa personne tous les clichés et stéréotypes que l’on attribue en général au rebelle. Enfin cette dernière partie se termine par la communication de Marie Isabelle Viera sur le migrant portugais vu à travers deux récits : A noite e o riso de Nuno Braganca (1969) et la nouvelle de J. M. G. Le Clezio « Ô voleur, voleur, quelle vie est la tienne ? » (1982) ; héros anonyme, à la fois révolutionnaire et rebelle bandit, il conteste le système d’exploitation dont il est victime en tant qu’émigré portugais et grâce à la littérature, entre ainsi dans l’intrahistoire.
Si le rebelle prend les armes, il utilise aussi les idées, les mots, l’écriture pour résister et témoigner, tel est l’objet d’étude de notre deuxième partie intitulée « Résister, témoigner ». Ainsi dans les deux premières communications, on comprend l’importance du rôle de l’écriture, arme qu’il faut brandir pour s’affirmer, mais surtout combattre contre les inégalités d’une société injuste ou éthiquement scandaleuse. L’insoumission des « Trois femmes puissantes » dans l’article de Françoise Aubès témoigne d’un Pérou discriminatoire, violent, machiste, qu’il s’agisse de celui de la romancière pré-indigéniste Clorinda Matto de Turner, de la franco péruvienne Flora Tristan ou de celui de María Elena Moyano au XXe, qui en plein terrorisme de Sentier Lumineux tentera par son action militante de s’opposer au fanatisme de ce mouvement. Dans ces trois cas, il s’agit de passer de l’espace privé à l’espace public, de revendiquer sa place ailleurs que dans le confinement de la maison. Ce que font également des trois intellectuelles espagnoles – Concha Méndez Cuesta (1898-1986), Ernestina de Champourcin (1905-1999) et Carmen Conde (1907-1996) – auxquelles s’intéresse Allison Taillot ; le récits autobiographique de ces « rebelles à la plume », vise non pas l’évocation rétrospective de souvenirs privés, mais par l’acte d’écrire, la reconnaissance publique. Le genre autobiographique qui se prête donc parfaitement à un travail de réflexion sur la construction identitaire, prend un tour particulier dans le cas de celles « des frondistes de gauche » – Vittorini, Gambetti et Lajolo – qu’analyse Pierpaolo Naccarella. Ces jeunes intellectuels fascistes, qui contestèrent non pas l’idéal fasciste, mais sa pratique, deviendront pour deux d’entre eux des communistes déçus qui ne se rebelleront pas contre le PCI, auquel ils devaient leur « réhabilitation ». L’écriture est aussi l’essence même de la rébellion et tout particulièrement pour le poète : le poète est un hors-la-loi, comme le définit Béatrice Ménard en étudiant Altazor du chilien Vicente Huidobro (1893-1948), dont la rébellion est avant tout « mort et résurrection du langage », rupture, transgression, dégrammaticalisation ; il faut tout détruire pour créer un autre monde. On retrouve cette même rébellion chez le poète hispano-mexicain, Tomás Segovia (1927-2011), qui a fait de l’insoumission une manière d’être et d’écrire comme l’explique Judite Rodrigues à la lumière de son œuvre poétique, mais aussi de ses essais, dans lesquels il prône la sédition contre l’immonde monde de « l’homo consummens ». En conclusion de cette deuxième partie consacrée à l’écriture comme forme de résistance et de témoignage, la contribution de Graça Dos Santos montre comment le théâtre sous une dictature comme celle de l’Estado Novo de Salazar peut être un agent de contestation dans un pays opprimé ; c’est le cas de la compagnie du Teatro Moderno de Lisboa (1961-1965) quand elle représente L’encrier de Carlos Muñiz en deça des Pyrénées ; mais jouée à Paris, la pièce perdra de sa ferveur protestaire.
Dans la troisième partie « Héros et mythes populaires », les contributeurs s’intéressent aux formes délictueuses de la rébellion. Quand les états modernes se constituent au XIXe siècle, sont réactivées alors des formes de résistance culturellement présentes depuis des siècles, en la personne du bandit et de son code d’honneur « la balentia» en Sardaigne ; les bandits sardes du Mezzogiorno de l’état italien, incarnent la rébellion conte l’autorité locale, puis contre un nouvel ordre social, économique. C’est l’évolution de la figure du bandit sarde qu’analyse Giuliana Pias à travers les romans de G. Deledda, S. Atzeni, et M. Fois, montrant comment cette figure permet une relecture de l’histoire de la Sardaigne. La rébellion se décline aussi au féminin comme on peut le lire dans plusieurs communications. Dans celle de Ramona Onnis, sont étudiés dans une perspective postcoloniale les personnages féminins de deux romans de Sergio Atzeni : Juanica dans le roman historique La fable du juge bandit, et Cate dans Bellas mariposas dans la Cagliari d’aujourd’hui. La rébellion des femmes n’est pas exempte d’ambigüité, celles-ci s’arrogent en effet le droit d’être aussi sanguinaires et cruelles que leur compagnon ou que ces hommes machos, leurs ennemis qui les asservissent et les maltraitent. Ainsi au Brésil Maria Déia, devient sous le nom de Maria Bonita une figure légendaire comme l’explique Véronique Le Dû, évoquant la compagne de Limpião, célèbre cangaceiro dans le sertão reculé du début du XXe ou les bandes de cangaceiros font la loi, s’insurgeant contre une république dont la devise est Ordre et Progrès. Maria Bonita, n’est pas une soldadera, elle combat, pille, manie les armes en véritable cangaceira. Et elle subira le même sort que les hommes de la bande de Lampião, exécutés le 28 juillet 1938 par la police. La délinquance au féminin se développe aussi dans le contexte urbain de sociétés où à l’autorité de l’État s’est substituée celle de groupe maffieux, comme le met en scène dans son roman 9 mm parabellum (2008) l’écrivain équatorien Alfredo Noriega dont Emmanuelle Sinardet propose l’analyse. Solitaire tueuse à gages, sanguinaire, mue par la haine des hommes, Esther échappe cependant au stéréotype de la sicaria car sa rébellion passe aussi par son amour de la poésie et de Borges ; figure complexe, le personnage d’Esther devient ainsi comme « l’étoile brillante d’un roman noir ». Dans une autre Amérique, celle des afro-descendants, le marronnage de fait (quilombo, palenque) qui est une manière de survivre à l’ordre colonial esclavagiste, s’accompagne aussi d’un marronnage discursif. C’est ce qu’étudient Sébastien Lefèvre et Paul Mvengou Cruzmerino à travers deux chansons mexicaines, forme de résistance à l’invisibilisation imposée aux afro-descendants en Amérique Latine. Se rebeller contre une société discriminatoire pour trouver enfin sa place, telle est la trajectoire de Cusumbo, le métis, symbole d’une nation en devenir dans la lecture proposée par Caroline Berge de Don Goyo, roman de l’Équatorien Demetrio Aguilera Malta (1933). Enfin la communication de Manuella Spinelli réfléchit sur cette autre forme de rébellion sans rébellion comme celle que met en scène le romancier italien Giuseppe Montesano dans deux romans, Dans le corps de Naples (2002) et Cette vie mensongère (2005) ; les protagonistes sont de jeunes trentenaires, sorte d’Oblomov modernes, et contrairement au précepte selon lequel « la valeur n’attend pas le nombre des années », ils refusent une société de gagnants ; rétifs à toute forme d’adhésion à une quelconque idéologie politique, ils sont convaincus de l’impossibilité de la rébellion aujourd’hui.
Nous espérons que la lecture de cet ouvrage collectif permettra de mieux comprendre combien la figure du rebelle peut être paradoxale et complexe comme la liberté qu’il renvendique. Que ces collaborations permettent aussi au lecteur de s’interroger sur d’autres réalités non fictionnelles, celles d’une actualité qui montre, toutes aires géographiques confondues, que la condition humaine est et se doit d’être, celle de l’Homme révolté.
Françoise Aubès avec la collaboration du comité scientifique :
Zoraida Carandell, Graça Dos Santos, Lina Iglesias, Manuelle Peloille, Lucia Quaquarelli, Emmanuelle Sinardet
SOMMAIRE
Françoise AUBÈS – Avant-propos
I. Première partie : Le rebelle entre dans l’Histoire
Bernard DARBORD et César GARCÍA DE LUCAS – Don Juan Manuel en rébellion contre son roi (Espagne, XIVe siècle) : Poema de Alfonso Onceno et Conde Lucanor
Amélie DJONDO– Le personnage de la reine rebelle dans le théâtre du siècle d’or
Marie LECOUVEY – De Cuauhtémoc à Zapata : le double usage des figures de rebelles mexicains (XIXe-XXIe siècles)
Alexis MEDINA – Luis Vargas Torres, martyr du libéralisme équatorien : la naissance d’un mythe
Diana SARRADE COBOS – La construction de l’image du père rebelle dans le roman Los 60’s sin Rock de Natacha Reyes
Canela LLECHA LLOP – Rebelle et tais-toi ! La représentation cinématographique de Salvador Puig Antich
José Carlos JANELA-ANTUNES – Henrique Galvão : rebelle au nom de la justice et pour la liberté
Marie-Isabelle VIERA – Le migrant portugais rebelle : figure marginale ?
Deuxième partie : Résister, témoigner
Françoise AUBÈS – Trois femmes puissantes
Allison TAILLOT – L’écriture comme attribut de la rébellion dans les écrits personnels des « modernes de Madrid »
Pierpaolo NACCARELLA – La rébellion contre le fascisme des « frondistes de gauche » dans leurs ouvrages autobiographiques (1944-1946)
Béatrice MÉNARD – Altazor de Vicente Huidobro ou la rébellion du langage poétique
Judite RODRIGUES – «La rebeldía cabal» : éthique et poétique du rebelle dans l’œuvre de Tomás Segovia
Graça DOS SANTOS – Être ou ne pas être rebelle : L’encrier de Carlos Muñiz par le Teatro Moderno de Lisboa au Théâtre des Nations en 1962
Troisième partie : Héros et mythes populaires
Giuliana PIAS – Du bandit armé à la « balentìa » sans armes. L’évolution de la figure du rebelle dans le roman sarde contemporain
Véronique LE DÜ DA SILVA-SEMIK – Représentation de Maria Bonita dans la littérature de cordel brésilienne
Ramona Onnis – Le rebelle au féminin dans l’œuvre romanesque de Sergio Atzeni
Emmanuelle SINARDET – La figure de la rebelle dans 9 mm parabellum d’Alfredo Noriega (2008) : de la sédition de la sicaria à la subversion de la lectrice
Sébastien LEFÈVRE et Paul Raoul MVENGOU CRUZMERINO – Stratégie de résistance : figures rebelles dissonantes dans les Afro-Amériques
Caroline BERGE – Cusumbo : un rebelle exemplaire dans le roman réaliste social équatorien Don Goyo de Demetrio Aguilera Malta
Manuella SPINELLI – Une rébellion sans rebelle. Formes de représentation de l’antihéros dans les romans de Giuseppe Montano
-
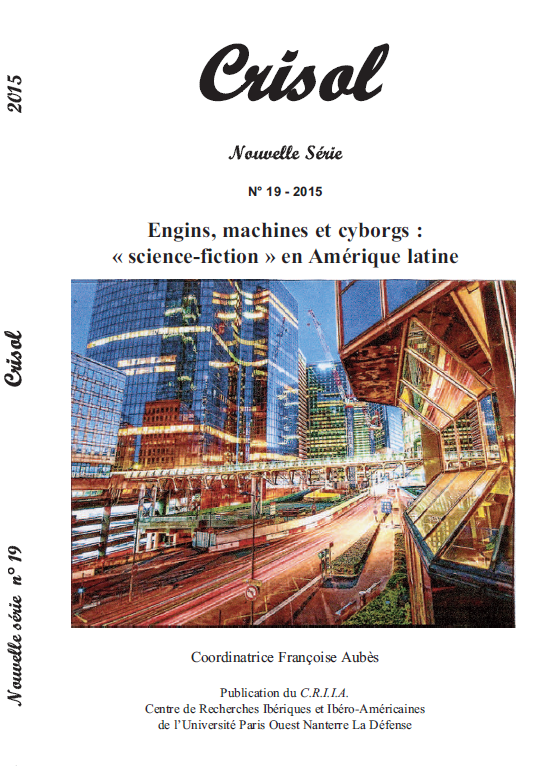 Crisol : Engins, machines et cyborgs : « science-fiction » en Amérique latine
No 19 (2015)
Crisol : Engins, machines et cyborgs : « science-fiction » en Amérique latine
No 19 (2015)Ce volume dont le titre Engins, machines et cyborgs : « science-fiction » en Amérique latine laisse entendre l’évolution d’un genre dont la spécificité originelle tient dans toute une machinerie technique qui ne cessera de muter, se propose d’étudier la représentation de cet imaginaire scientifique principalement dans la littérature. La première partie de l’ouvrage est consacrée aux contributions de plusieurs enseignants chercheurs dont la spécialité couvre des aires géoculturelles variées du Mexique au Cône Sud, en passant par les Caraïbes et le monde andin. La seconde partie est une anthologie de 15 nouvelles de science-fiction traduites par les membres du Collectif de Lectures d’ailleurs (http:/fr.calameo.com/accounts/261779) ; ces nouvelles complètent les études plus théoriques de la première partie, montrant le dynamisme et le renouveau du genre. Enfin il nous a semblé utile d’ajouter un index des œuvres les plus mentionnées dans les divers articles de la première partie de ce volume, donnant ainsi l’occasion au lecteur de tenter l’aventure d’une autre représentation de l’Amérique latine.
Si la science-fiction naît en tant que genre avec l’avènement des machines, des technologies qui vont révolutionner l’avenir de l’humanité tout entière, génératrices de nouvelles utopies, celle d’un monde meilleur, il est d’usage de déclarer que l’Amérique latine, ayant connu historiquement un retard « technologique » ralentissant ainsi son accès à la modernité, n’a pu développer ce type de littérature. Or c’est tomber dans des généralités erronées qui supposent une vision globale et homogène de pays très différents. Comment comparer l’Argentine du début du XXe siècle, dont la capitale Buenos Aires est la New York de l’Amérique du Sud, avec le Pérou dont la capitale Lima, ressemble à une petite ville de province ? Ces considérations sur le développement inégal des villes ou plutôt de la « Modernité » questionnent l’existence ou la non-existence d’un lectorat potentiel et la fondation d’une tradition. Mais on peut néanmoins considérer qu’un imaginaire scientifique se développe, certes à des degrés divers, dans les fictions latino-américaines et ce dès la fin du XIXe siècle. S’inspirant des modèles européens et nord-américains, des avant-gardes, des mouvements futuristes, et de leurs propres rêves prospectifs et prédictifs, les écrivains latino-américains créeront des histoires où les machines et leurs inventeurs seront le moteur diégétique du récit (M. Tapia), mais à la lisière d’autres genres comme le genre fantastique (A. Linck). Selon les aires analysées, on peut retracer la naissance et l’évolution d’un genre fictionnel, genre ancillaire d’abord, inspiré de ce qui se fait en Europe, mais capable aussi de s’enraciner dans des sociétés dont le substrat mythique des cultures autochtones est la voie royale vers les mondes imaginaires. Les contributions sur Cuba (C. Lepage) et le Chili (M. Areco, F. Moreno), deux pays fondateurs du genre, montrent l’usage politique divergent de la science-fiction au gré de l’Histoire. En ce qui concerne les pays de tradition moindre ou invisible éditorialement, les contributions de E. Sinardet sur l’Equateur et de F. Aubès sur le Pérou, attestent néanmoins de la présence constante d’une littérature que l’on pourrait qualifier de périphérique. En inventant des mondes imaginaires, miroir déformant du présent, en prenant les chemins de traverse de l’Histoire, les écrivains lisent leur époque, imaginant des utopies possibles ou réinventant l’histoire de la Conquête (S. Rutès) dans le cas du Mexique. Il nous semblait indispensable de ne pas négliger l’apport du cinéma, présent dans la communication sur le film México 2000 de Rogelio González (E. Vincenot). Certains espaces plus que d’autres semblent propices à l’élaboration d’un monde science-fictionnel, c’est le cas de la Basse-Californie, pour Gabriel Trujillo Muñoz (A. Fabriol). Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’époque n’est plus aux utopies, mais plutôt au constat d’un monde désenchanté, car les extraordinaires voyages intersidéraux ont montré que le ciel est vide… La très violente conjoncture politique (dictature, régime totalitaire, guerres) trouvera dans le genre post-apocalyptique les outils adéquats pour dire un monde en ruines. (T. Orecchia-Havas, E. Delafosse). L’utopie des premiers temps a donc été remplacée par l’uchronie, la dystopie, le cyberpunk (J. García Romeu).
Cette littérature que l’on dit « sans cesse périmée », car toujours dépassée par de nouvelles inventions technologiques, a traité ou traite de façon visionnaire tout ce qui aujourd’hui est devenu réalité. Et loin d’être réduite à une gadgetisation futuriste, elle pose les grands problèmes existentiels que toute société humaine tente de résoudre depuis la nuit des temps. La littérature science-fictionnelle latino-américaine n’est donc pas un genre rétrograde et confiné dans un registre codé, un peu méprisé. De grands noms ont contribué à en enrichir le registre ; les limites génériques dans lesquelles les modèles extérieurs auraient pu l’enfermer sont ainsi dépassées. Car, la spécificité de l’Amérique latine n’est-elle pas d’avoir été dès la Découverte, cet espace inimaginable, qui semblait déjà propice aux rencontres de troisième type, comme l’attestent bien des chroniqueurs du Nouveau Monde.
Tout particulièrement présente aujourd’hui dans les revues électroniques, dans les blogs, transgénérique et transfictionnelle, elle semble résister de plus à plus à toute définition précise et afin de brouiller davantage encore les pistes, rappelons ce qu’énonce l’énigmatique et malicieux narrateur de «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius» :
«La metafísica es una rama de la literatura fantástica»…
Françoise Aubès (coordinatrice)
SOMMAIRE
Françoise AUBÈS – Avant-propos
Première partie : la science-fiction latino-américaine
1-Poétique d’un genre ou le « merveilleux scientifique »
Anouck LINCK – Les chemins non conformes de la raison :fantastique et science-fiction
Miguel TAPIA – Las máquinas más allá de la ciencia. Tecnologías del saber en Juan José Arreola y Adolfo Bioy Casares
2-Chili et Cuba : tradition et enjeux politiques de la littérature science-fictionnelle
Macarena ARECO, Fernando MORENO – Políticas de la ciencia ficción en Chile: el porvenir hecho presenteok
Caroline LEPAGE – Des Martiens, des OVNIS… et des Spoutniks sous les tropiques : la littérature science-fictionnelle cubaine
3-Utopies mexicaines
Sébastien RUTÉS – Dieu, la Conquête et l’espace : trois nouvelles mexicaines de science-fiction métaphysique (Fuentes, Porcayo, Zárate)
Anaïs FABRIOL – Le récit de science-fiction comme représentation du monde frontalierdans l’œuvre de Gabriel Trujillo Muñoz
Emmanuel VINCENOT – Satire et utopie dans México 2000 [Rogelio González, 1983]
4-Le monde andin
Emmanuelle SINARDET – Le monde désenchanté de la science-fiction équatorienne ? : «Viaje imprevisto» d’Alicia Yánez Cossío(1975) et «El analista» de Santiago Páez (1994)
Françoise AUBÈS – Demain. Quelques réflexions sur le genre SF au Pérou
5-Dystopie et écriture des ruines
José GARCÍA-ROMEU – Del posmodernismo al ciberpunk, algunas vicisitudes de laanticipación en el Cono Sur
Teresa ORECCHIA HAVAS – Arquitecturas apocalípticas: Una torre futurista en el borde de la ciudad
Émilie DELAFOSSE – Plop de Rafael Pinedo: «ciencia rudimentaria y ficción de las ruinas»
Deuxième partie : Anthologie de nouvelles de science-fiction d’Amérique latine
Traductions dirigées par Caroline Lepage
Gustavo COURAULT (Argentine) – hWord
Claudia DE BELLA (Argentine) – Rédemption
RPACOC (Pérou) – Le Rêve du robot
Hugo AQUEVEQUE (Chili) – Bleu
Daína CHAVIANO (Cuba) – L’Annonciation / Amoroso planeta (1983)
Ricardo CANALES (Mexique) – Réveil
Ronald DELGADO (Venezuela) – Réplique
Claudio G. DE CASTILLO (Cuba) – Les pionniers de l’espace
M.C. CARPER (Argentine) – Continuum Pi
Eduardo CARLETTI (Argentine) – Cycles
Eduardo M. LAENS AGUIAR (Uruguay) – DT
Melanie TAYLOR (Panamá) – Graines
Jorge Valentín MINO (Équateur) – Les Boutons noirs
Mauricio DEL CASTILLO (Mexique) – Commerce de Répliques
Juan Diego GÓMEZ VÉLEZ (Colombie) – Notre-Dame des Donneurs
-
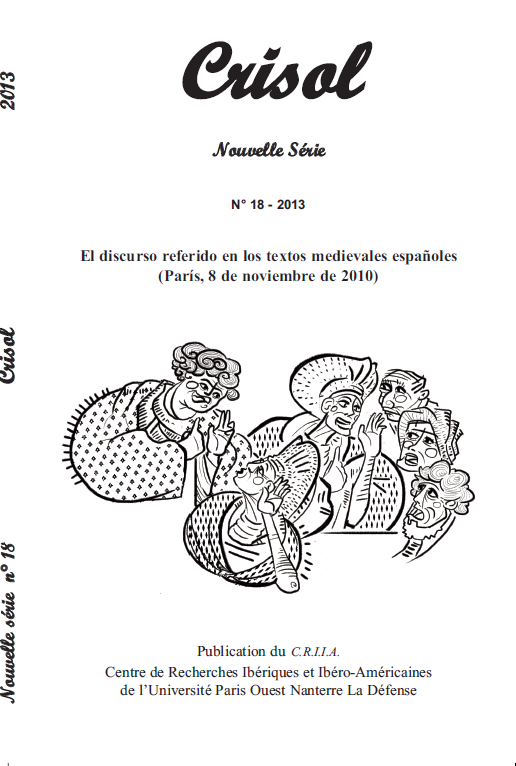 Crisol : El discurso referido en los textos medievales españoles
No 18 (2013)
Crisol : El discurso referido en los textos medievales españoles
No 18 (2013)Numéro 18 de la revue Crisol - El discurso referido en los textos medievales españoles
Discurso Referido
Luz VALLE VIDELA, coordinadora del número - IntroducciónI. Aspectos lingüísticos del discurso referido
Marta LÓPEZ IZQUIERDO – Según y como. Su origen y función como introductores de discurso referidoII. El discurso referido en las formas narrativas breves
Marcello BARBATO – «Pues, yo arrebataría, por Dios, sy non lo dixiese». La intemperancia verbal del Arcipreste de Talavera
Olivier BIAGGINI – Discurso directo y discurso indirecto en El conde Lucanor de Don Juan Manuel
José Luis GIRÓN ALCONCHEL –El discurso indirecto y sus variantes en el texto del SendebarIII. El discurso referido en textos historiográficos y jurídicos
Sophie HIREL – «Y si quiça me dixeredes». Réflexions sur le discours rapporté dans la chronique de Vagad (1499).
Luz VALLE VIDELA – El discurso referido en los fueros anecdóticos del Libro de los fueros de CastiellaCreación
- Sam GOTE MOZ – Rameras y remeros
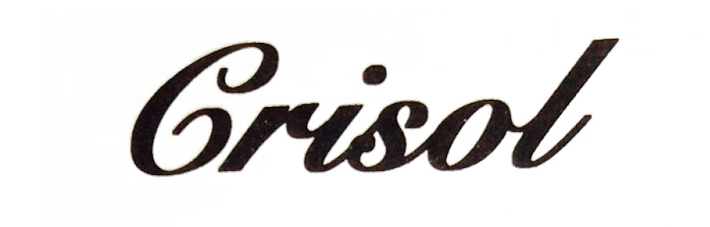
Une revue universitaire...

... au service de la recherche